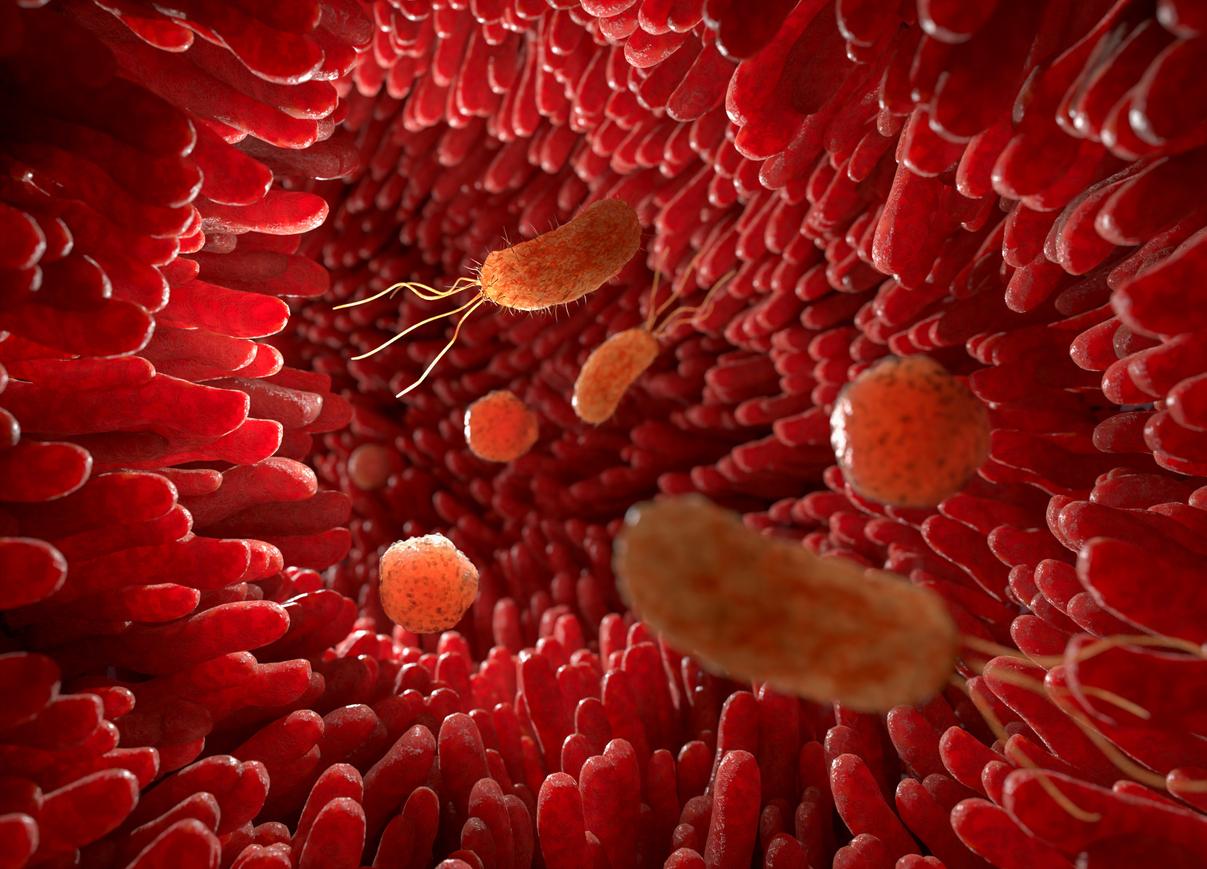Dépistage
Bégaiement : des marqueurs génétiques identifiés
Le bégaiement, longtemps mal compris, trouve une explication génétique grâce à une étude menée sur plus d’un million de personnes. Une avancée majeure qui pourrait améliorer le dépistage précoce.

- Par Stanislas Deve
- Commenting
- fizkes / istock
Souvent mal compris et stigmatisé, le bégaiement pourrait enfin livrer certains de ses secrets. Une étude inédite, la plus grande menée à ce jour sur le sujet, a permis d’identifier, pour la première fois, une série de marqueurs génétiques associés à ce trouble moteur de la parole qui toucherait 1 % de la population, souvent dès l’enfance. Publiée dans la revue Nature Genetics et basée sur les données ADN de plus d'un million de personnes fournies par la société 23andMe, elle met en évidence 57 régions génomiques liées au bégaiement.
L’origine génétique du bégaiement
"Personne ne comprend vraiment pourquoi quelqu'un bégaye. C'était un véritable mystère. Et c'est vrai pour la plupart des pathologies de la parole et du langage", explique Jennifer Below, professeure de médecine et directrice de l'Institut de génétique de Vanderbilt (Etats-Unis), dans un communiqué. "Et c’est vrai pour la plupart des pathologies du langage et de la parole, qui restent peu étudiées car elles ne mènent pas à une hospitalisation, mais elles peuvent avoir des conséquences considérables sur la qualité de vie."Contrairement aux idées reçues liées à l'éducation, au stress ou à la volonté, l'étude montre que ce trouble du langage, caractérisé par des répétitions de syllabes et de mots, des allongements sonores ou encore des pauses entre les mots, a une origine génétique bien réelle. En analysant près de 100.000 cas de bégaiement autodéclarés, comparés à plus d’un million de participants sans trouble, les chercheurs ont en effet pu identifier des signatures génétiques correspondant à 48 gènes distincts.
Autre enseignement de l’étude : les gènes associés au bégaiement présentent des points communs avec ceux impliqués dans l’autisme, la dépression ou encore la musicalité. L'un des gènes les plus fortement identifiés, VRK2, est ainsi lié à la capacité à suivre un rythme musical et au déclin du langage chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. "Cela suggère que la musicalité, le langage et la parole partagent une architecture cérébrale commune", note Jennifer Below, alors qu’"historiquement, on considérait la musicalité, la parole et le langage comme trois compétences distinctes".
Une santé mentale dégradée chez les enfants bègues
Le bégaiement touche environ 400 millions de personnes dans le monde. Il se manifeste souvent entre 2 et 5 ans, et 80 % des enfants récupèrent spontanément, avec ou sans orthophonie. Mais pour les autres, les impacts peuvent être lourds : moindres opportunités professionnelles, harcèlement, repli social, perte de confiance en soi... "Les jeunes qui bégaient rapportent une plus faible participation en classe, des expériences scolaires négatives et une santé mentale dégradée", rappelle la chercheuse.
Pour Dillon Pruett, co-auteur de l’étude et lui-même concerné : "Il reste beaucoup de zones d’ombre autour du bégaiement. En tant que personne directement touchée, je voulais apporter ma contribution. Nous espérons que ces résultats aideront à faire tomber les préjugés et à ouvrir la voie à de nouveaux traitements."