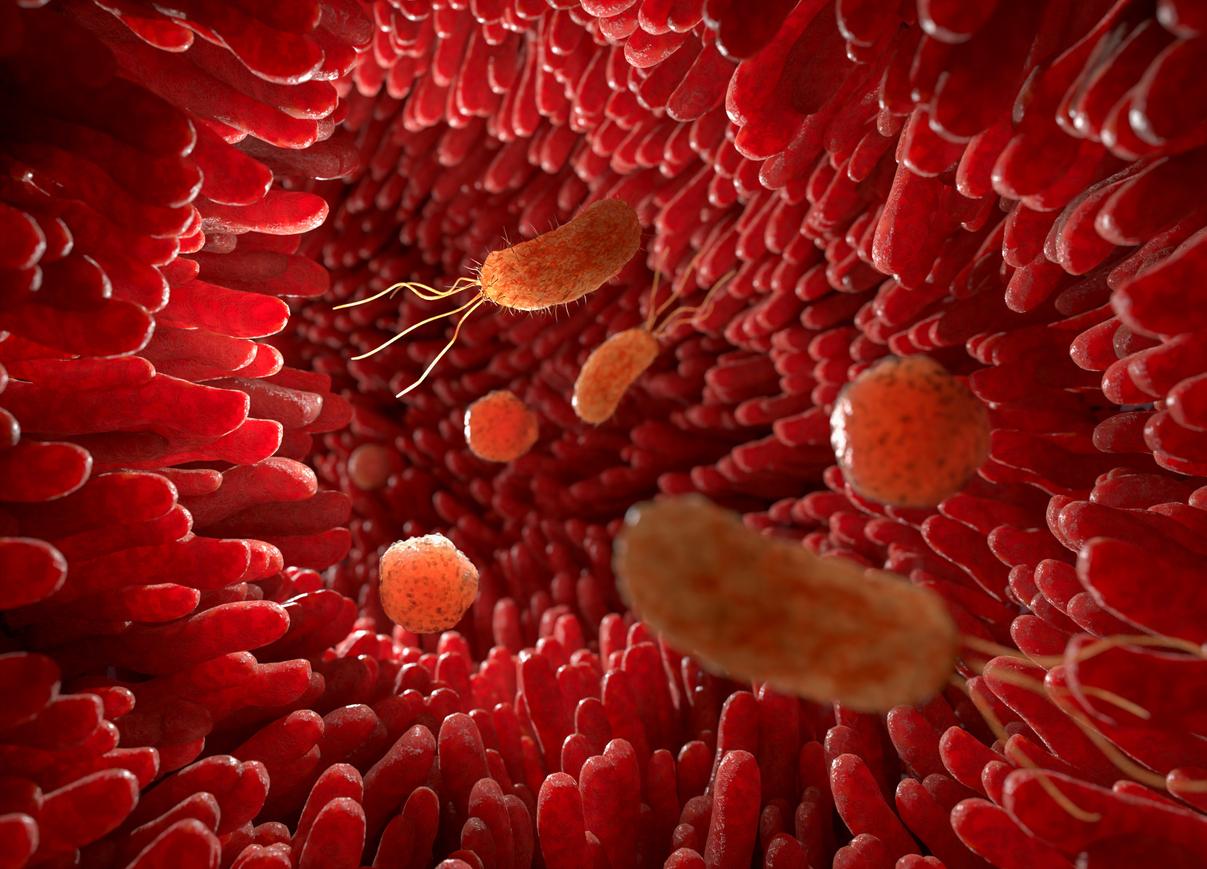Interview du week-end
Alzheimer : "Le patient détient le secret de sa maladie, c'est là qu'il faut chercher "
Le projet d’un Centre d’Excellence et de Recherche sur la Maladie d’Alzheimer (CERMAD) a pour objectif d’associer les biomarqueurs, l’IA et des essais thérapeutiques pour une prise en charge précoce de la maladie. Aux commandes de ce projet, le Pr Buno Dubois qui répond aux questions de Pourquoi Docteur.

- Par Thierry Borsa
- Commenting
- iStock/lucigerma
- Pourquoi Docteur : Vous avez lancé le projet du CERMAD, Centre de Recherche de Pointe sur les Maladies du Cerveau, à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer le 21 septembre. A partir de quels constats est née cette initiative ?
Pr Bruno Dubois : C’est le poids de ces maladies neurodégénératives, une sorte de tsunami, un nouveau problème de santé publique auquel nos sociétés modernes sont confrontées. L’arrivée de ces maladies, c’est un peu la conséquence du succès de la médecine qui a rallongé l’espérance de vie. On maîtrise mieux aujourd’hui beaucoup des causes qui faisaient que les gens mouraient jeunes et désormais nous pouvons tous espérer parvenir à ces âges auxquels ces maladies sont naturellement fréquentes. Une petite fille qui nait aujourd’hui va vivre jusqu’à 90 ans… et à 90 ans elle aura 4 chances sur 10 d’avoir la maladie d’Alzheimer !
On se rend compte que cela va peser énormément dans la prise en charge de la santé. Un chiffre qui vient d’être proposé par le Haut Conseil de Santé Publique indique que le coût global de la prise en charge de la seule maladie d’Alzheimer est de 32 milliards d’euros ! Cela donne une idée de l’ampleur du problème de santé publique auquel nous sommes confrontés.
- Les connaissances déjà acquises sur la maladie changent-elles quelque chose sur la façon d’aborder ce problème de santé publique ?
Depuis une vingtaine d’années on assiste à une véritable révolution dans la connaissance de cette maladie. Avant, on ne pouvait pas diagnostiquer avec certitude la maladie d’Alzheimer puisque les lésions dans le cerveau qui la caractérisent n’étaient accessibles qu’en examen post-mortem. Depuis vingt ans on peut accéder à la connaissance des lésions dans le cerveau du vivant des patients, à travers le PET-Scan et l’analyse des marqueurs des lésions amyloïdes et tau. On peut aussi évaluer indirectement la présence de ces lésions par une ponction lombaire mais surtout, on peut désormais, dans le sang, repérer des modifications qui sont associées à la présence des lésions cérébrales qui caractérisent Alzheimer.
"Accueillir des patients pas pour des soins mais pour de la recherche"
Cela change totalement l’approche de ces maladies qui, jusque-là, se faisait dans des centres de recherche fondamentale où l’on travaillait sur des modèles animaux ou cellulaires. Or aujourd’hui on peut accéder aux informations concernant la maladie chez les patients eux-mêmes. Car le patient détient le secret de sa maladie et c’est là qu’il faut chercher. Il faut donc pouvoir explorer ces patients mais, sachant qu'il s'agit de patients fragiles, il faut pouvoir les accueillir dans une structure hospitalière mais pas pour des soins, pour de la recherche !
- Pourtant, lorsque l’on va à l’hôpital, c’est pour y être soigné …
C’est pour cela qu’il faut disposer d'un bâtiment spécial, uniquement composé de locaux, de bâtiments spéciaux dédiés à la recherche clinique sur les patients. Au CERMAD, les patients et les sujets d'intérêt seront accueillis certes dans un cadre hospitalier non pas par des médecins mais par des chercheurs. Cela permettra de recueillir des informations, des données cognitives, de l’imagerie cérébrale, des données biologiques, génétiques, des signaux faibles fournis par des marqueurs digitaux comme la mobilité physique, la mesure de l’élocution, toutes informations qu’il faut extraire chez les sujets soit à risque soit déjà malades mais au tout début de leur affection. L’intérêt de ces biomarqueurs est en effet de pouvoir repérer des personnes qui ont déjà des lésions dans le cerveau mais qui n’ont pas encore les symptômes de la maladie et de pouvoir les suivre.
- Précisément, comment seront utilisées des données ?
Tout cela doit permettre de générer des algorithmes afin de voir quels sont les sujets à haut risque de développer la maladie, ceux qui sont à faible risque, ceux qui n’ont aucun risque, de définir des algorithmes prédictifs et d’évolution, de prédiction de réponse thérapeutique.
"Une pharmacologie préventive en espérant retarder l'entrée dans la maladie"
Toutes ces connaissances rendront aussi possible le fait de prévenir, de conseiller, éventuellement de proposer des traitements puisqu’il existe aujourd’hui des médicaments qui nettoient les lésions du cerveau, même s’ils sont peu efficaces sur les symptômes. Ainsi, si on repère des personnes qui ont des lésions mais pas encore des symptômes on pourrait faire une sorte de pharmacologie préventive en espérant retarder l’entrée dans la maladie.
- La présence de lésions indique-t-elle systématiquement la maladie ?
Non ! A la Salpêtrière il y a quelques années, nous avons suivi une série de 320 sujets âgés normaux sans aucun trouble cognitif ni de mémoire mais dont 88 avaient les lésions de la maladie. Ils avaient 76 ans quand ils sont entrés dans cette cohorte et nous les avons suivis pendant 7 ans jusqu’à ce qu’ils atteignent 83 ans. Sur les 88 ayant des lésions à l’entrée dans l’étude, seuls 16 ont évolué vers la maladie d’Alzheimer. Ce qui signifie que le fait d’avoir des lésions est un des éléments pouvant déclencher la maladie mais cet élément seul ne suffit pas. D’où l’intérêt de disposer d’une base de données très exhaustive pour inclure tous les autres facteurs.
"Faire bénéficier le patient de médicaments en développement"
Ce sont tous ces process qui sont prévus dans le CERMAD où il y aura à la fois l’accueil de patients « informatifs » -des personnes à risque, en début de maladie, même parfois des personnes en bonne santé mais qui veulent être suivies par crainte d’être un jour atteintes par cette maladie- desquels nous extrairons des données et, en retour, nous pourrons pour ceux dont l’état le justifie, les faire bénéficier de médicaments en développement dans un centre d’essais thérapeutiques qui sera associé.
- L’accès plus aisé à ces traitements innovants est souhaité par beaucoup de ceux qui travaillent sur la maladie d’Alzheimer, or l’un d’entre-eux vient d’être bloqué par les autorités de santé. Quelle est votre réaction ?
Non seulement il faut que l’on ait des médicaments innovants en développement dans des structures comme le CERMAD mais il faut aussi qu’une fois que ces médicaments ont montré leur efficacité qu’ils soient autorisés par les autorités de santé. Et la France vient en effet de refuser l’accès précoce au lécanémab et nous sommes très déçus que nos patients en soient privés alors que l’autorisation a été accordée par l’Europe.
- Les « plans Alzheimer » ont disparu, remplacés par une « stratégie nationale des maladies neurodégénératives ». Quel impact cela a-t-il sur la recherche, la prise en charge des patients, les moyens pour lutter contre cette maladie ?
Le plan Alzheimer se justifiait par l’ampleur de la maladie et il a permis de mettre en lumière sa problématique. Mais d’autres maladies moins fréquentes étaient en déshérence et certains se sont demandés si ces maladies ne pouvaient pas bénéficier de tous ce dont avait bénéficié la maladie d’Alzheimer. Donc il y avait une certaine cohérence à élargir, mais Alzheimer doit rester une vraie priorité en matière de santé publique.
- Comment le projet CERMAD va s’articuler avec cette « stratégie nationale des maladies neurodégénératives » ?
Le CERMAD sera un centre de recherche indépendant et nous allons créer, en parallèle et associé à ce centre de recherche, un centre de prise en charge des malades et également une structure clinique de prévention. C’est là que nous appliquerons les algorithmes qui auront été développés dans le centre de recherche pour évaluer le risque chez tout un chacun et définir des stratégies de prévention et de prise en charge. L’ouverture de ce centre est prévue pour le milieu de l’année 2027.
- Quels espoirs peut-on avoir aujourd’hui pour une meilleure prise en charge d’Alzheimer ?
Aujourd’hui, on a montré que l’on peut retarder l’entrée dans le déclin cognitif avec des mesures relativement simple, une bonne prise en charge cardiovasculaire, un régime alimentaire de qualité, de l’activité physique et des interactions sociales. Une fois que l’on est entré dans la maladie, il y a des possibilités avec des médicaments, malheureusement déremboursés mais pourtant efficaces, de stabiliser pendant un temps son évolution. Et puis il y a toutes les aides qui permettent le maintien à domicile, le soutien aux aidants. Grâce à tout cela, on arrive à tout de même à ralentir le processus et à faciliter la vie des patients.
"Quand les gens sont malades, c'est trop tard !"
La vraie question est de savoir quand nous parviendrons à maîtriser l’évolution de la maladie, éventuellement à la bloquer, voire à empêcher l’entrée dans la maladie. C’est là toute l’idée du CERMAD qui est en fait de se dire à propos d’Alzheimer : "Quand les gens sont malades, c’est trop tard !".
On le voit bien avec le problème des autorisations pour les médicaments innovants : s’ils ne sont pas autorisés c’est parce que leur efficacité n’est pas jugée assez suffisante face aux risques d’effet secondaires et aux coûts. Mais même s’ils étaient disponibles, le fait de prendre ces médicaments n’empêcherait pas la maladie de continuer à s’aggraver. On a montré en effet que lorsque les symptômes sont là, les lésions dans le cerveau sont déjà à leur maximum !
"Traiter la maladie avant qu'elle soit là"
L’avenir est donc dans une approche complètement nouvelle de cette maladie : il faudra probablement la traiter avant qu’elle soit là ! Et nous avons cette "chance" que cette maladie nous donne des signaux avant d’apparaître. A nous de mettre en place des structures qui permettent de repérer ces signaux avant-coureurs, de mettre à disposition les médicaments qui sont efficaces sur les lésions, afin de retarder le plus possible l’entrée dans la maladie.
- Quand cette nouvelle approche sera pleinement intégrée dans la prise en charge d’Alzheimer ?
Il faudra que l’on ait suffisamment de recul sur les algorithmes de prévision pour identifier les patients sur lesquels on pourra agir avec efficacité et que l’on ait démontré qu’en traitant plus tôt on retarde l’entrée dans la maladie. Et cela va être difficile, cela devra reposer sur des études incluant de grandes populations de sujets normaux que l’on pourra suivre suffisamment longtemps pour que l’on puisse évaluer l’impact sur l’entre dans la maladie par rapport à ceux qui ne sont pas traités.
En ce qui concerne ces études indispensables, on ne peut pas imaginer avoir des réponses avant un délai de 5 ans. C’est aussi le temps qu’il faudra pour affiner les algorithmes construits à partir des données extraites des patients. L’hypothèse sur laquelle nous travaillons pour le CERMAD table sur 6 ou 7 ans… mais il reste dans ce domaine, comme pour toute la recherche, une part de science-fictioon dont je suis parfaitement conscient !