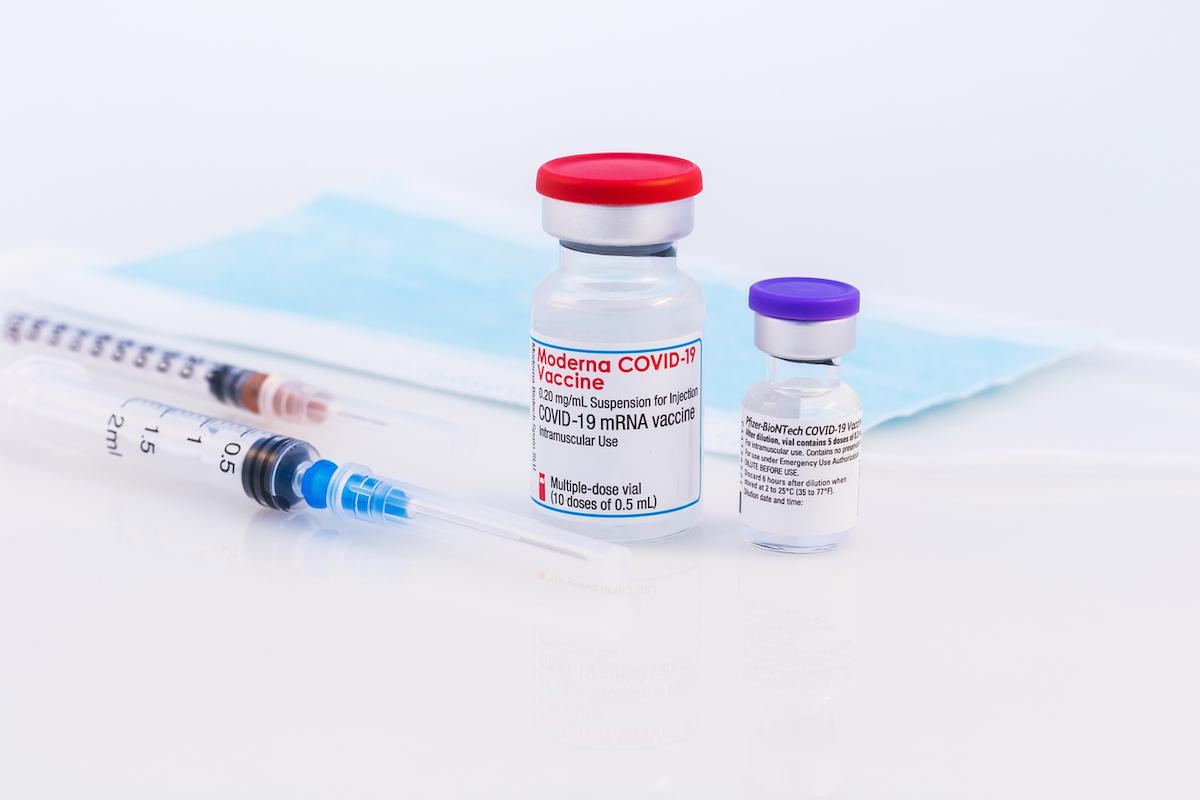Infectiologie
Covid-19 : un vaccin « universel » en cours de développement
Le risque de voir apparaître de nouveaux variants du SARS-CoV-2 pendant encore quelques temps fait que nous aurons besoin d’un « vaccin anti-covid universel », capable de bloquer le SARS-CoV-2 quel que soit le variant. C’est peut-être en train d’arriver.
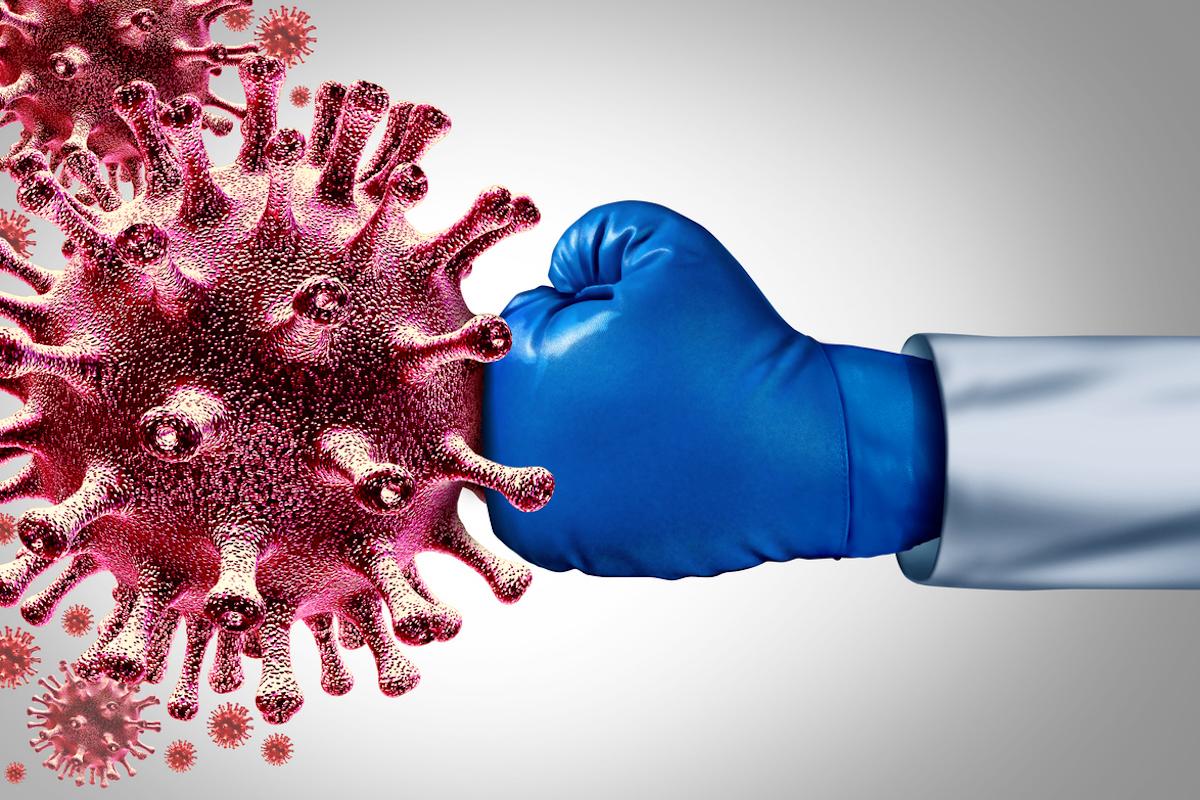
- wildpixel/istock
L'émergence régulière de variants du SARS-CoV-2 souligne le besoin de vaccins de nouvelle génération conférant une protection élargie contre le coronavirus quel que soit son variant. Sinon, la Covid-19 pourra se prolonger indéfiniment et nous aurons besoin de mises à jour régulières des vaccins.
La revue Science Translational Medicine publie les résultats des travaux des chercheurs du département « Emerging Infectious Diseases », du Walter Reed Army Institute of Research (États-Unis) qui développe actuellement un vaccin anti-covid basé sur la technologie des « protéines de fusion dérivée des protéines recombinantes », un vaccin sinon « universel », du moins ciblant une séquence plus étendue de la protéine S, et donc à même de ne pas être obsolète à la moindre mutation.
Une technologie de vaccin de nouvelle génération
La technologie des protéines de fusion dérivée des protéines recombinantes permet en effet de « greffer » une partie plus importante de la séquence de la protéine Spike du SARS-CoV-2 sur une protéine humaine qui lui sert de « véhicule », la ferritine dans le cas particulier de ce vaccin, une protéine ubiquitaire du corps humain. Les vaccins à base de nanoparticules protéiques auto-assemblées offrent donc l'avantage d'une présentation multivalente de l'antigène, une propriété dont il a déjà été démontré qu'elle augmente l'immunogénicité par rapport aux immunogènes monovalents.
L'autre avantage majeur de cette technologie réside dans la capacité du vaccin de présenter un plus grand nombre de sites de la protéine S potentiellement antigéniques, alors que les vaccins actuellement disponibles ne concernent que des séquences partielles de la protéine S, le plus souvent autour de la région dite « RBD », ou zone de liaison au récepteur à la surface des cellules (le récepteur ACE2). Leur efficacité serait donc moins susceptible d’être réduite par une mutation isolée.
Une étude prometteuse mais pré-clinique
Cette étude pré-clinique a été réalisée chez des macaques rhésus (primates non-humains qui ont été utilisés lors des tests de concept pour les vaccins à ARNm) avec un vaccin à la dose de 50 microgrammes basé sur la protéine S de la souche historique Wuhan-1 et incluant un adjuvant liposomal.
Deux injections du vaccin administrées à 28 jours d'intervalle induisent une réponse immunitaire humorale et cellulaire robuste avec des taux d'anticorps neutralisants très élevés (par comparaison, le taux d'anticorps neutralisants chez les patients convalescents serait 10 fois inférieur). La production d'anticorps chez les singes vaccinés est par ailleurs accompagnée d'une réponse cellulaire sous la forme de de lymphocytes CD4 dits « helper » (Th1) spécifiques.
Ces puissantes réponses immunitaires humorales et à médiation cellulaire se seraient traduites par une élimination rapide du virus en réplication dans les voies respiratoires supérieures et inférieures et dans le parenchyme pulmonaire des primates non humains lors d’un « challenge respiratoire » avec une forte dose de SARS-CoV-2.
Ce vaccin pourrait donc avoir un effet partiellement stérilisant et réduirait la contagiosité, et sa durée, chez les personnes vaccinées.
Par ailleurs, les analyses histologiques effectuées sur les pièces de tissu pulmonaire montrent que le vaccin réduirait drastiquement la sévérité des lésions pulmonaires, et aucun antigène viral n'a pu être mis en évidence dans les fragments de tissu alvéolaire des animaux vaccinés.
Un vaccin universel ?
En plus de son caractère économique et thermostable, la révolution majeure que cette nouvelle technologie de vaccin pourrait apporter dans la gestion mondiale de la pandémie réside dans l'induction d'une large gamme d'anticorps neutralisants, ciblant de nombreuses régions de la protéine S et capables de contrôler la totalité des variants d'intérêt étudiés jusqu'au variant Delta, ainsi que le SARS-CoV-1 !
Il faut bien sûr rester prudents et prendre du recul par rapport à ces résultats. D’autres études doivent être encore être réalisées avant d'envisager une 1ère étude chez l’homme, il faut notamment évaluer l'impact de l'adjuvant sur l'efficacité relative du vaccin et tester de nouvelles constructions basées sur la protéine S des variants les plus récents, dont le variant Omicron.