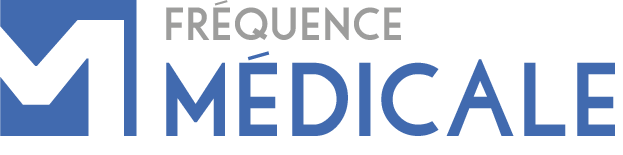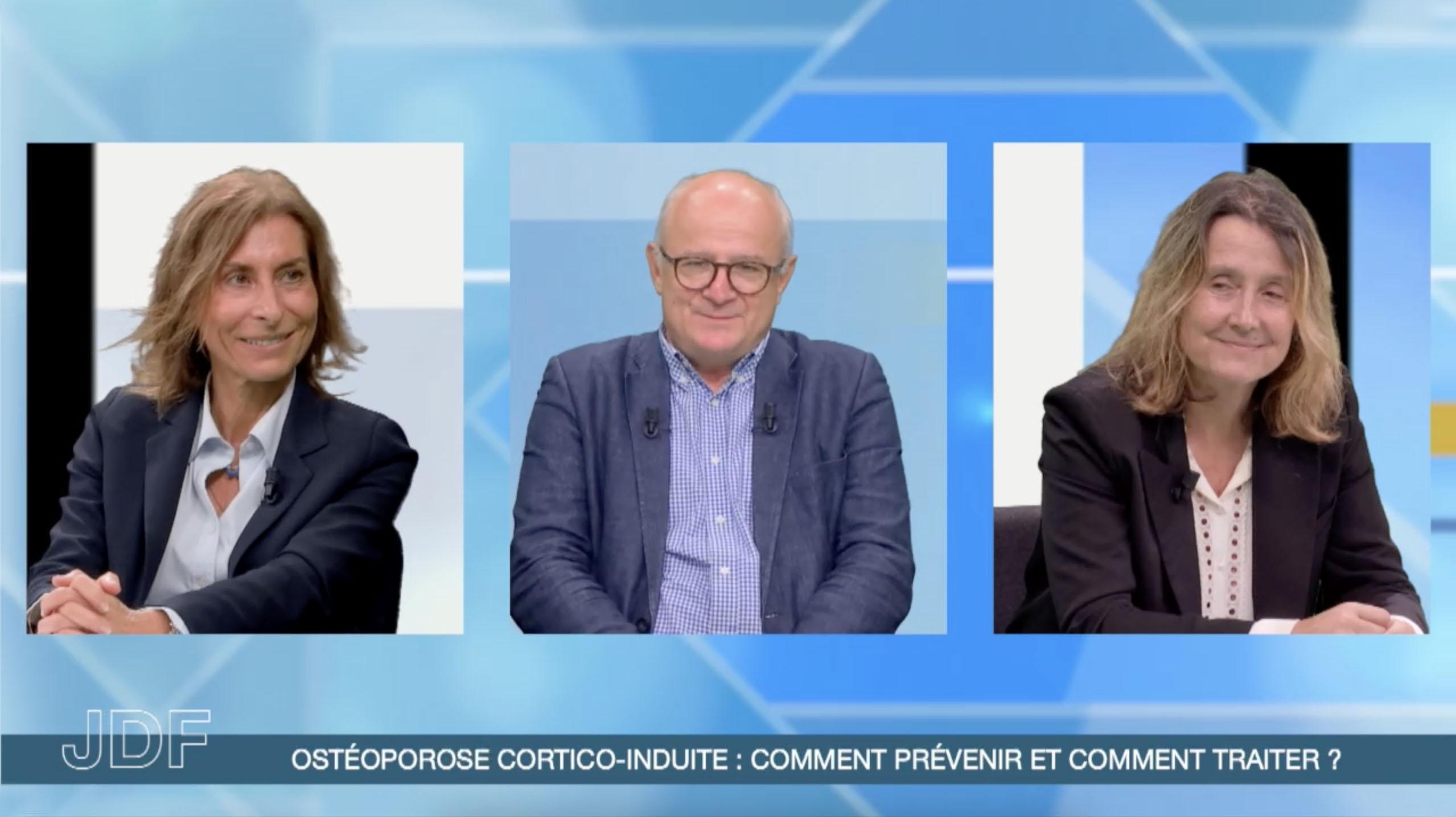Elections et débat national
Santé et Présidentielle : territorialisation, renationalisation et rémunération
La campagne présidentielle a commencé et, après la crise de l’hôpital et la pandémie Covid-19, nous avons interrogé les candidats et des représentants de la société civile sur leurs propositions de réforme de la Santé. Aujourd’hui, l’interview du Dr Philippe Cuq, coprésident du Bloc.

- sefa ozel/istock
Le Dr Philippe Cuq est chirurgien vasculaire, installé en établissement privé à Toulouse et syndicaliste : il est aujourd’hui coprésident du Bloc, et président de l'Union des chirurgiens de France.
On a eu crise après crise, et la Covid-19 en prime. Quelle est votre analyse sur ce qui ne va pas et ce qu'il faut vraiment changer dans le système de santé actuel ?
Alors que l’on vient de vivre une crise sanitaire historique, que l’on n’espère vivre qu’une fois dans une génération, on est contrarié par le peu de débats sur la santé dans cette campagne présidentielle. Par contre, le Bloc a beaucoup de retours d'expérience de ses correspondants médecins spécialistes libéraux et nous voulons travailler à partir de ce retour d'expérience sur l’après-crise et l’avenir.
La première chose que l’on va mener dans certaines régions, avec les URPS, les médecins libéraux, ce sont des projets pour modifier les plans blancs élaborés en réponse à ce genre de crise sanitaire, parce qu'on a très mal vécu cette crise avec des situations dramatiques, de médecins libéraux et d’infirmières décédées, et de malades qui ont été abandonnés avec une perte de chance manifeste. On a très mal vécu les épisodes des masques et des équipements de protection manquants. On a très mal vécu dans les établissements, la problématique des médicaments qui ont été réquisitionnées parce que cela a généré de très grandes difficultés. Et puis surtout, cette déprogrammation, imposée uniformément sur tout le territoire, par le plan blanc de niveau quatre, a probablement coûté la vie à beaucoup de patients, avec des retards de diagnostic et de prise en charge catastrophiques, qui ont conduit à des situations humaines extrêmement difficiles.
Dès le 28 mars 2020, c'est-à-dire quelques jours après le début du confinement, nous avons alerté sur les risques des déprogrammations imposées pour les populations. On a encore aujourd’hui des séquelles de cette déprogrammations. On en verra, je pense, les conséquences dans les années qui vont venir, en particulier en cancérologie, mais dans d'autres pathologies. Et donc ça, on a tous dit de façon unanime qu’on ne veut pas le revivre.
Et quelles sont vos propositions face à cette crise de déprogrammation au cours de la Covid-19 ?
C’est la territorialisation et la renationalisation. On a élaboré un certain nombre de propositions qui seront publiées et qui donneront même lieu à des travaux scientifiques, pour essayer de modéliser la gestion d'une crise sanitaire au niveau territorial. Quand je dis crise sanitaire, l'actualité internationale nous fait aussi réfléchir au-delà du virus, sur le risque nucléaire, le risque d'empoisonnement, le risque toxique sur l’eau, le risque peut-être de conflit, mais toujours à partir d’une gestion territoriale sanitaire qui nous paraît beaucoup plus adaptée. Et on regrette que les pouvoirs publics, en dépit de tout ce que l’on a vécu, n'aient pas pris de décision très claire après cette crise et que globalement, l'actualité actuelle fait oublier la crise alors que nous avons sûrement beaucoup de choses à faire.
Je suis chirurgien et nous utilisons dans le bloc opératoire encore des masques qui viennent de Chine. C'est quelque chose qui m'insupporte parce que nous devrions en produire en France ou en Europe. Nous devrions avoir une autonomie sanitaire pour les médicaments. Il faut qu'on ait vraiment la R&D et les circuits de production en France ou en Europe. Ce sont des décisions très importantes. On parle de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie militaire, mais il ne faut pas oublier l'autonomie sanitaire parce qu'on est extrêmement dépendants. Pendant cette crise, quand on nous a dit que cinq drogues et les curares étaient réquisitionnés parce que l’on risquait de manquer, ça nous a fait froid dans le dos.
Donc la priorité, c'est tirer les conclusions du retour d'expériences pour des décisions pragmatiques qui doivent être prises. Ce ne sont pas des décisions de droite ou de gauche, ce sont des décisions de bon sens, pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. C'est le premier point qui nous paraît important dans ce débat santé.
Et que proposez-vous face à la crise des déserts médicaux ?
Aujourd'hui, on a une pénurie de personnel soignant et des déserts médicaux au sens large du terme. À partir de là, le premier message, c'est que contraindre les gens, contraindre les installations de médecins, etc, ça n'a jamais fait et ça ne fera jamais la preuve de son efficacité. De même qu’augmenter l'administration dans un système de santé ou un hôpital n'a jamais amélioré la qualité des soins. Donc, nous avons un message très clair : c'est place aux soignants ! Et quand je dis soignants, je n'oublie personne, de l'aide-soignant à l'infirmière en passant par les professions paramédicales, etc. Dans un service, quand vous êtes malade, celui qui vous tient à main, qui est proche de vous, c'est l'aide-soignante, c'est l'infirmière et on doit avoir une valorisation de ces métiers et c'est pour nous une priorité. Quand on a dit ça, indiscutablement, il faut redonner envie aux jeunes de se lancer dans ces carrières. Et on voit bien aujourd'hui le découragement, on voit la démission quotidienne des infirmières qui vont changer de métier. L'effet Ségur n'a pas été au niveau et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un vrai problème d'attractivité de nos métiers et il faut, en urgence, mettre le paquet.
Les déserts médicaux sont bien sûr liés au numerus clausus, mais ils sont sûrement dû aussi au fait que le temps médical a diminué et que les générations plus jeunes n'ont pas le même temps médical à proposer pour l'offre de soins. Probablement aussi que la féminisation de notre profession fait que le corps médical s'est aussi un peu modifié. Là, on a deux propositions très simples. Il faut conserver au maximum les médecins qui vont partir à la retraite. Parce qu'il y a des vieux médecins qui sont en forme, qui peuvent encore rendre service, qui répondent aux attentes de la clientèle, qui répondent à une demande de soins sur un territoire et il faut leur permettre de continuer en leur enlevant toutes leurs charges professionnelles. Ils ont fait leur carrière, ils ont rempli leur temps officiel de travail, ils rendent service en restant sur le territoire pour prolonger leur activité un an ou deux ou trois ans… Alors il faut « défiscaliser » : ça veut dire enlever les charges professionnelles pour cet exercice. Et là, on va pouvoir maintenir dans chaque territoire probablement une offre de soins avec des médecins qui n’ont pas de charges professionnelles à payer et qui continuent leur exercice pendant un an, deux ans, trois ans, en fonction de leur souhait, voire à temps partiel.
À l'inverse, à l'autre bout de la chaîne, les jeunes installés, ou ceux qui sont en tout début de carrière et qui ne sont pas encore installés, il faut simplifier les aides et les incitations. Moi qui suis dans une formation signataire de la convention médicale, je suis incapable de vous dire le nombre de mesures que l'Assurance maladie et les pouvoirs publics ont mis en place pour favoriser les installations, dans les zones en difficulté, avec du saupoudrage de différentes allocations et aides. Nous pensons que là, il ne faut pas faire petit bras. Il faut arrêter ce saupoudrage et définir les zones les moins denses en médecins par rapport à la population. On peut définir, peut-être 500 zones en France où on a besoin d'installation,s et sur ces 500 zones, il y a qu’un seul message : les jeunes qui vont s'installer là ou qui y vont faire une partie de leur carrière, ils ont des aides franches. On met le paquet et on ne saupoudre pas à droite, à gauche. Personne n'est capable de définir aujourd'hui qu'est-ce qui existe comme aide.
Dans notre région Occitanie, on propose aussi des « plateformes de santé ambulantes » qui se déplacent et qui répondent à un besoin très précis en urgence, sans gêner une installation future. On peut très bien définir des plateformes de santé qui se déplacent avec des infirmières, des médecins, un peu de radiologie, un peu de biologie, pour répondre aux besoins urgents d'une population. Elles sont bien sûr soumises à des conditions précises parce qu'on ne fait pas de la médecine foraine et on ne veut pas concurrencer les éventuels projets d’installation. On fait de l'organisation urgente sur des déserts médicaux bien définis pour répondre immédiatement à des besoins précis.
Entre les seniors qui resteront quelques années de plus, les jeunes qui iront quelques années dans les zones sous-dotées et les plateformes médicales ambulatoires, on peut résoudre quand même aujourd'hui pas mal de situations difficiles.
Quelles solutions proposez-vous pour améliorer la crise des urgences et les rapports entre la ville et l'hôpital ?
On dit depuis des années que 70% des patients qui se présentent aux urgences hospitalières n'ont rien à y faire. Tout le monde est d'accord : l’Igas, les sénateurs, les députés, les médecins, tout le monde. Mais il n’est pas question de faire que quand un malade se présentent aux urgences hospitalières, on le renvoie en ville en facturant un forfait de 80 €. On marche sur la tête !
Donc là aussi, soyons simples et précis. Une partie du budget colossal, représenté par 70% des urgences, peut être affecté à la prise en charge de proximité par les médecins traitants ou par des « équipes de proximité externes ». On transfère ce volume financier et on organise en ville ce qu'on a appelé des « centres de soins non programmés », en collaboration avec la médecine libérale. Le problème principal est, en effet, entre 19 h et 24 h, où il faut pouvoir répondre à la maman qui récupère son gamin à l'école avec une angine ou de la fièvre, et aux soins non programmés. Plus tard, la nuit, c’est généralement plus grave et cela peut aller aux urgences de l’hôpital. Et les centres de soins non programmés, si on met les moyens en fonction de la géographie, de l’immobilier, des soignants, infirmières, médecins, mais aussi un peu d'accueil, un peu de sécurité, parce que malheureusement c'est la vie aujourd'hui, on pourrait résoudre ce problème.
Mais il faut une volonté politique et des territoires de santé, où cela s'organise. À Toulouse, il y a une maison de soins non programmée avec un numéro de téléphone unique. Si on a un problème médical simple, on ne va pas au CHU attendre 6 h. Mais il faut rémunérer les gens pour faire ce travail qui est un travail pénible, et on va résoudre le problème comme ça. Alors qu'aujourd'hui ça ne marche pas et les gens vont aux urgences parce que les médecins traitants, à 19 h, mettent le rideau de fer et le répondeur avec le téléphone du Samu. Donc, oui, on a besoin de l'organiser et il faut transférer les moyens financiers sur le secteur libéral.
Quel est votre message final ?
Je pense qu'aujourd'hui on manque de réalité, mais on sait pourquoi. C’est parce que l'on a une administration très lourde et qui a du mal à résoudre les problèmes. On est contraint sur des textes légaux comme, par exemple, la convention médicale, qui est un texte illisible et incompréhensible pour la plupart des confrères. Donc il faut simplifier et il faut mieux organiser au niveau territorial.
Tant qu'on n'aura pas des gens à l'aise et heureux de faire ces métiers de l'aide-soignant, du brancardier, de l'infirmière et du médecin, on aura des difficultés et pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Il faut rendre le travail attractif, c'est-à-dire l'ambiance.
Et la première composante de l’ambiance, ce n'est pas l'argent, c'est le bien-être au travail. Quand vous avez des équipes à flux tendu, s’il manque quelqu'un, c'est celui qui est là, qui reste, et qui fait le boulot. Dans les services hospitaliers, cliniques ou hôpitaux, quand une infirmière ne se présente pas la nuit, c'est l'infirmière du jour qui reste. Vous voyez un peu la pénibilité, les contraintes. Donc, c'est le premier point qu’il faut résoudre. Et la deuxième composante, c’est la juste rémunération des efforts. C'est sûr qu'il faut rémunérer le travail pénible, que ce soit dans les Epad ou dans les hôpitaux, même si c'est plutôt un métier valorisant.
Une société qui va prendre en charge correctement ses jeunes et vieux, qui va être bienveillante, cela marche mieux. Aujourd'hui, les tensions font partir les soignants et c'est dramatique.