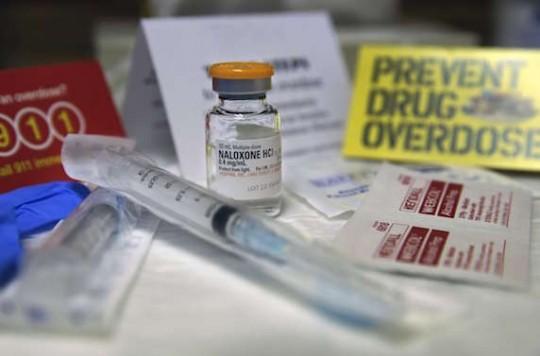Addictologie
20 ans de traitement des addictions aux opioïdes : de la controverse au consensus
A l’occasion des 20 ans du traitement des addictions aux opioïdes en France, la rédaction a eu l’occasion d’interviewer le Dr Bernard Kouchner, ancien Ministre de la Santé, qui a largement participé à la mise en place des politiques de réduction des risques aux addictions en France.

Quelle est la genèse du concept de réduction des risques ?
Pour nous la période était commune au SIDA et aux addictions. Les gens comprenaient très bien que si les toxicomanes se passaient des seringues sans certaines précautions, les gens qui s’injectaient ces produits pouvaient attraper le SIDA aussi.
C’est autour du SIDA, et parce qu’il y a eu des associations de malades et des Organisations Non-Gouvernementales qui les prenaient en charge, que nous avons pu évoluer. Le SIDA nous a fait « bénéficier », si l’on peut dire, de cet élan des ONG et des associations, pour que l’on prenne aussi en charge la toxicomanie, car évidemment les 2 choses étaient liées, en particulier au début.
Le public le comprenait très bien, mais après il a fallu passer, non seulement à la France, qui « allait plan-plan », mais aussi à l’ensemble du monde, car la pandémie était mondiale. Il a fallu créer une réserve d’argent, c’est-à-dire le fond global, une démarche internationale (…) donc c’est tout un contexte, c’est un « internationalisme » qui est nécessaire mais qui, au début, a pu choquer un peu.
Comment ont été mises en place les politiques de réduction des risques ?
Lorsque je suis arrivé comme Ministre de la Santé en 1988, j’ai été confronté à des attitudes que je qualifierais de conservatistes. Et d’ailleurs c’est toujours la même chose maintenant, 30 ans après. C’est-à-dire, qu’en France, on ne veut pas bouger les choses et on considère que ce ne sont pas des malades et que ce sont des délinquants !
Je vous rappelle que je suis arrivé après que Michèle Barzac ait obtenu de haute lutte la vente libre des seringues (…), alors même qu’on était en pleine épidémie de SIDA, et ceci afin de réduire les contaminations par échange de seringues. Je décide alors et j’essaye de convaincre (le gouvernement, ndl) que tous les appareils répressifs ne serviraient à rien et qu’il fallait considérer que la réduction des risques était la seule attitude médicale raisonnable, tant en termes de santé publique, qu’en terme d’éthique médicale.
Alors ce fut un long parcours, avec Médecins du Monde, en essayant de faire accepter par le gouvernement que la réduction des risques devienne une doctrine médicale officielle. (…) Je me souviens, que l’on m’avait demandé que l’on prouve qu’il était possible de prendre en charge médicalement, comme c’était notre devoir, les personnes dépendantes. (…) Donc il a fallu montrer que dans des pays raisonnables, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, la prise en charge par la méthadone, par la buprénorphine, cela marchait. Cela s’est passé sur une longue période, mais cela a donné de bons résultats.
Comment les traitements de substitution ont-ils pu être prescrits ?
Cela a été fait par les gouvernements successifs, et en particulier par Simone Weil et Philippe Douste-Blazy, qui ont accepté d’assumer cette décision politique lourde. Mais cela a permis de grands succès en France parce qu’en France, les médecins généralistes ont pris en charge un certain nombre de patients qui n’allaient pas à l’hôpital et qui ne voulaient pas aller à l’hôpital.
En effet, initialement et dans beaucoup de pays, on réservait les traitements de substitution à des médecins hospitalier et à des services d’addictologie. C’était très bien pour commencer, mais cela réduisait considérablement le nombre de patients traités. Et c’est grâce à un certain nombre de courageux médecins généralistes, car c’était un sacrifice personnel, que des centaines et des centaines de consommateurs d’opioïdes ont pu être aidés.
Quelle était l’implication du Ministère de la Santé ?
Tout ceci a été soutenu par le Ministère de la santé. Nous avons fait des rencontres scientifiques très importantes, comme par exemple le colloque « Trivilles », pour stimuler le débat public en France. « Trivilles » c’était comment New-York, Londres et Paris réagissaient à la prise en charge des personnes dépendantes des drogues. Nous avons commencé à faire travailler les pharmacologues. Nous avons également édité des livres. Il y a eu Bernard Roque qui a fait un livre tout à fait important sur le circuit du plaisir, sur la comparaison avec l’alcool et le tabac, parce qu’en France, il est clair que nous avons « nos » drogues, nous avons « nos » toxiques. « Quand c’est français, c’est bien » alors que le nombre des morts du tabac, c’est au moins 70 000 par an. Ce n’est pas le cas avec le cannabis. Mais comme le tabac est cultivé par les paysans français, cela va. Quant à l’alcool, on va dire que c’est un sport national !
Donc vous voyez, c’est très difficile de faire comprendre comment ce raisonnement politique, qui est un raisonnement nationaliste, est en même temps un raisonnement conservateur. C’était le pire de ce que l’on pouvait faire, mais l’habitude en France c’est d’être très en retard sur ces sujets.
Quelles sont les perspectives de la lutte contre les toxicomanies en France ?
La prise en charge de l’addiction évolue, même si je pense que nous sommes désormais en retard. Maintenant, le vrai problème, ce sont les jeunes gens qui ont encore moins de possibilités d’accéder à un monde qu’ils espéraient. Le rêve ne fait plus partie de cette génération et cela explique aussi que les toxiques se répandent autant.
Si l’on ne prend que l’exemple du cannabis, car c’est l’exemple que tout le monde comprend : chaque année le nombre des usagers du cannabis augmente de 300 000 en gros. Donc les politiques actuelles ne marchent pas ! Mais pour faire comprendre cela, c’est très difficile, alors que même la police qui est en première ligne pense qu’il faut changer de stratégie et de politique.
Et cela nourrit les trafics ! Lorsque l’on est jeune et que l’on est dans un environnement pas très gai avec peu de perspectives, on comprend que s’il leur est possible de faire vivre sa famille en vendant 3 grammes de cannabis, cela va se faire naturellement. Et donc on comprend bien qu’il y a là une espèce de pression sociale.
Des gens très sérieux disent qu’il faut changer de politique de lutte contre la toxicomanie. Cela s’entend de plus en plus. Mais si quelqu’un pendant la campagne présidentielle actuelle disait : « je suis pour la libéralisation ou je suis pour la contraventionalisation du cannabis », tout le monde pousserait des cris d’orfraie et le considérerait comme un laxiste. C’est comme cela la France. C’est un peu rétif au changement.
Il faut se souvenir qu’avant la dernière guerre, on vendait de l’opium de façon tout à fait légale dans les colonies et que cela représentait 25% des bénéfices que la France retirait de ces colonies. Alors, je ne dis pas qu’il faut faire exactement la même chose, mais je dis que l’on ne peut pas en rester à cette espèce de répression féroce, dès lors qu’elle procure encore plus d’appétit.
On ne peut pas non plus augmenter encore la répression : elle est à son maximum, alors même que la consommation augmente caque année. Or, on a vu récemment que les gens qui profitent de ces trafics étaient prêts à tout, y compris à tuer. C’est ce qui s’est également passé aux Etats-Unis pendant la période de la prohibition où il y avait des meurtres en permanence. Je ne suis pas sûr que l’on n’en arrive pas à cela ici.
Donc il faut évoluer, c’est évident. C’est problème de santé publique, mais également un enjeu de sécurité publique.