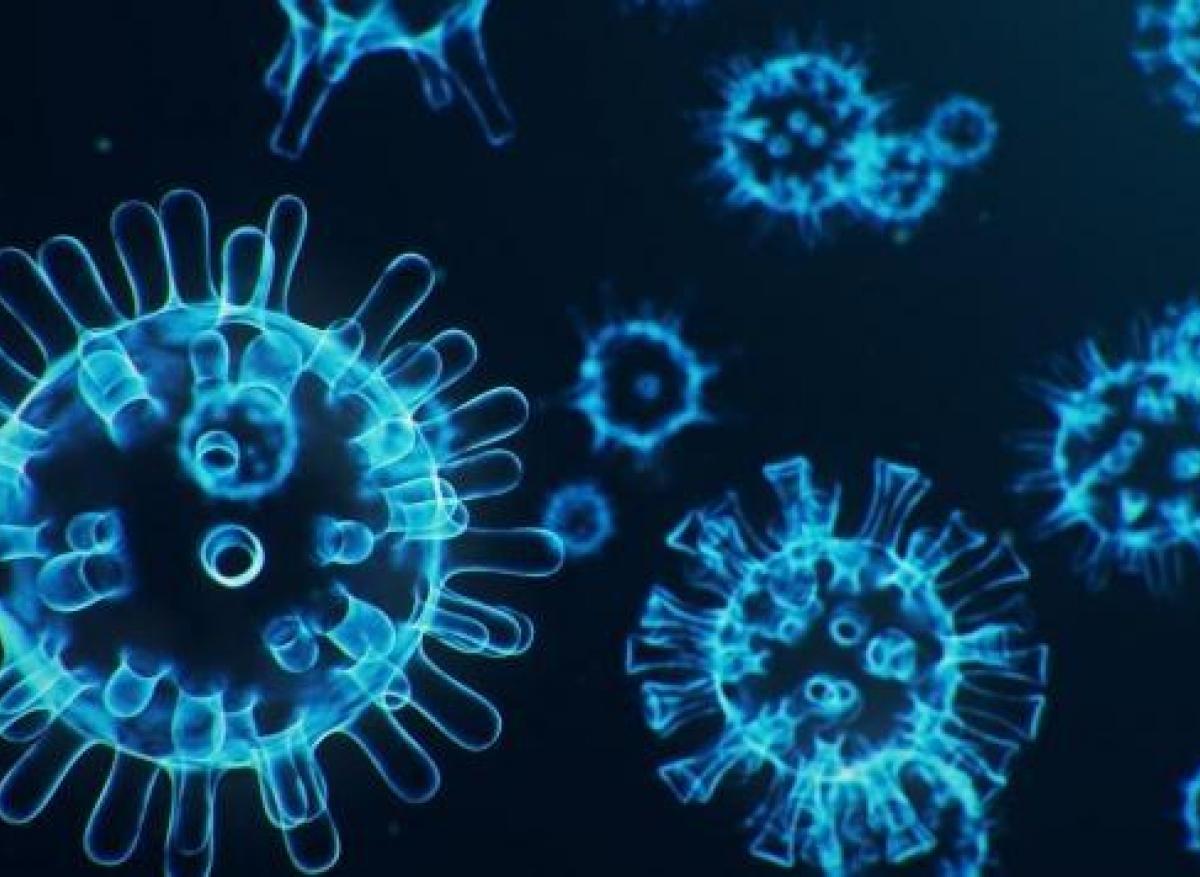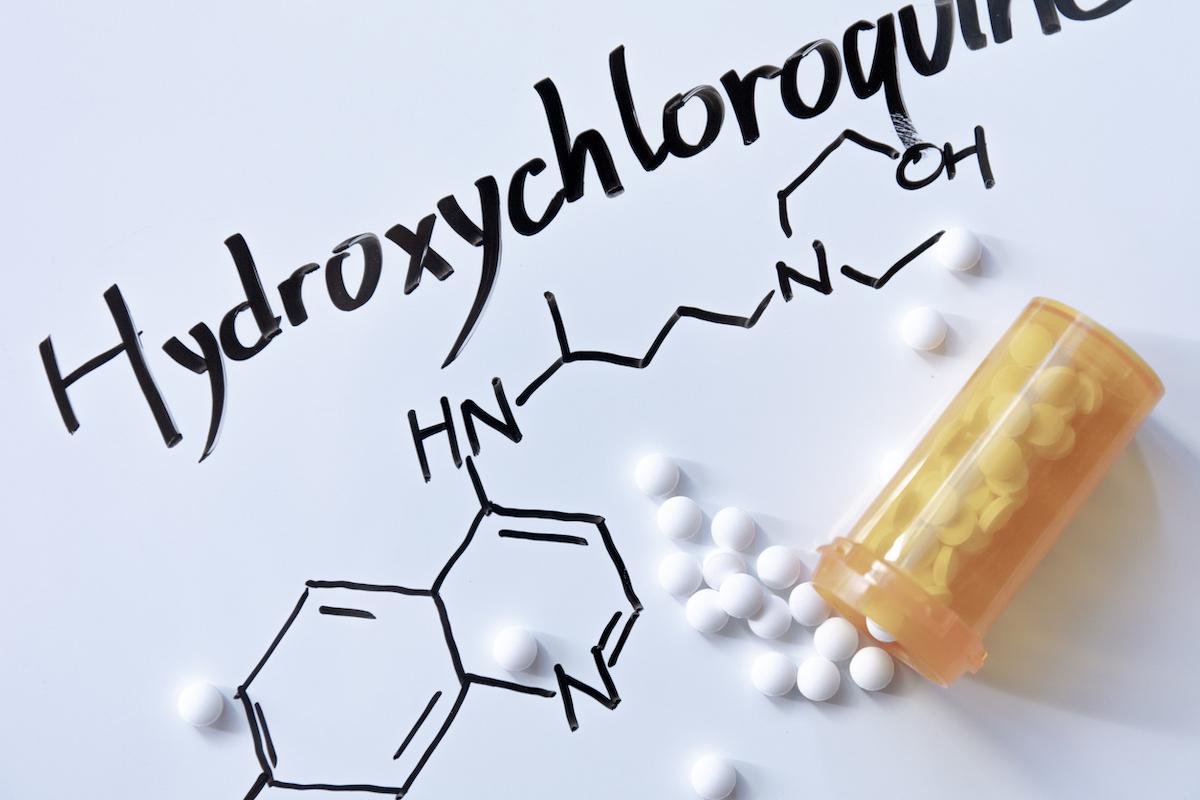Infectiologie
Covid-19 : cette épidémie va-t-elle devenir récurrente et saisonnière ?
Avec la vaccination et le retour des beaux jours en France, on peut espérer voir une amélioration de la situation dans les hôpitaux. Pour autant, serons-nous débarrassés de ce virus ? Rien n’est moins sûr si l’on en croit le point de vue de 2 experts dans le JAMA.

- MarianVejcik/istock
Les expériences publiées des pays les plus avancés dans la vaccination (Israël, Ecosse) peuvent nous rendre optimistes vis-à-vis de la baisse des hospitalisations et des décès liés à la Covid-19 d’ici quelques semaines, surtout si l’on associe l’impact de cette vaccination, à l’effet de la saisonnalité et de l'immunité acquise après infection (10 à 15% de la population en France).
Cependant, cet optimisme doit être tempéré, car la probabilité d'obtenir une immunité collective contre le SARS-CoV-2 est faible en France, comme dans d’autres pays occidentaux : tout le monde n’est pas éligible à la vaccination (en particuliers les enfants de moins de 16 ans) et entre un quart et la moitié des personnes refuseront probablement d'être vaccinés.
De plus, les vaccins ne procurent pas une immunité totale contre l'infection, et ceux qui sont actuellement disponibles sont en particulier moins efficaces contre certains variants qui apparaissent régulièrement (réduction des hospitalisations mais pas des contaminations). D’après 2 experts, anglais et américain, qui signent un article très intéressant dans le JAMA, les gouvernements et les systèmes de santé doivent donc dès maintenant envisager la possibilité que la Covid-19 persiste et devienne une maladie saisonnière récurrente. Ils enjoignent aux différents gouvernements de s’y préparer et de prévoir les moyens d’y faire face.
Le leurre de l’immunité collective fin 2021
L'immunité de groupe (ou protection indirecte) est basée sur une modélisation des maladies infectieuses qui postule que dans une population où chaque personne a une probabilité égale de rencontrer toutes les autres personnes, la transmission n’est plus possible lorsque l'immunité acquise, via une infection passée ou une vaccination (ou les deux), atteint un certain seuil… qui dépend du degré de contagiosité du virus.
La réalité diffère bien sûr de cette notion simple et théorique et de nombreuses variables peuvent rendre la prédiction plus hasardeuse. Certains experts de santé publique suggèrent que pour obtenir l'immunité de groupe contre la Covid-19 ce prochain hiver, avec de nouveaux variants en circulation, il faudrait que plus de 70 à 80% des personnes soient immunisées. Mais pour les auteurs de l'article, il n’est pas sûr que ce soit suffisant et ce pour 3 raisons.
Premièrement, les vaccins actuels pourraient avoir un effet moindre sur la prévention de l'infection, comme c’est le cas actuellement avec le variant sud-africain B.1.351. Ensuite, le nombre de personnes qui auront reçu le vaccin pourrait être insuffisant car les vaccins n'étant pas autorisés chez les enfants de moins de 16 ans, seulement trois-quarts de la population environ peut être vaccinée au maximum. Surtout, toutes les personnes éligibles à la vaccination ne sont pas prêtes à être vaccinées et c’est le facteur probablement le plus important sur le long terme.
Troisièmement, il n’est pas sûr que l’immunité acquise contre les infections antérieures à coronavirus protègent les personnes guéries contre une réinfection par un nouveau variant : différents modèles suggèrent qu’une poussée épidémique avec dominance du variant sud-africain B.1.351 pourrait se produire dès cet hiver 2021-2022. On peut toutefois espérer que les taux d'hospitalisation et de décès soient plus faibles si les vaccins restent efficaces pour prévenir les maladies symptomatiques graves et les décès, comme c’est encore le cas à ce jour.
Les comportements humains comptent beaucoup
Si la transmission reste similaire à ce qui s'est passé cet hiver, les hospitalisations et les décès devraient être moins nombreux pendant l'hiver 2021-2022. Mais l'ampleur de la poussée de contaminations hivernales dépend également du comportement de la population. Avec le port de masques et la distanciation sociale, on estime que seuls 10 à 15% de la population a été infectée jusqu'à présent.
Si de nouveaux variants continuent à apparaître, les épidémies de contaminations hivernales pourraient devenir la norme. On devrait avoir la réponse à cette question de façon expérimentale en observant ce qui va se passer au Texas et en Louisiane où les gouverneurs de ces 2 états américains viennent de lever les restrictions et l’obligation de port du masque alors que l’épidémie n’y est pas terminée et que la vaccination y est faible.
Anticiper de possibles épidémies hivernales
La possibilité du retour chaque année d’épidémies hivernales à SARS-CoV-2 devrait donc faire envisager une série de stratégies visant à atténuer leur impact sur les systèmes de santé. La première des mesures serait bien sûr d’intensifier les efforts de vaccination, au niveau national et mondial, afin de réduire le risque d’émergence de nouveaux variants, qui peuvent apparaître n'importe où : une transmission accrue augmente mathématiquement la probabilité de leur apparition.
De la même façon, les 2 experts recommandent de mieux surveiller l'émergence de nouveaux variants afin de pouvoir accélérer l’adaptation éventuelle des vaccins pour améliorer leur efficacité sur de nouveaux variants à haut risque de réduction de la protection. Si des variants continuent à apparaître, il est même possible qu'une vaccination annuelle soit nécessaire, comme pour la grippe saisonnière.
Il convient également de se préparer matériellement et financièrement à ces surchauffes hospitalières hivernales. Les hôpitaux français ont à l’évidence besoin de développer une plus grande capacité en lits et en personnels de réanimation pour répondre à ces poussées hivernales sans léser les autres malades.
Des modifications sociétales hivernales ?
Il faut peut-être également envisager toutes les actions permettant réduire la transmission du SARS-CoV-2, quel qu’en soit le variant, pendant les mois d’hiver grâce à des mesures de distanciation, tolérables pour la société. Il pourrait s’agir, par exemple pendant les mois de forte transmission, de garder le port du masque dans les transports en commun, d’imposer une vaccination obligatoire des personnels soignants et des personnes à risque, ainsi que d’annuler les événements de diffusion massive potentielle du SARS-CoV-2 en déplaçant les réunions ou les cours dont la fréquentation dépasse un certain seuil vers des plateformes numériques.
Le risque accru de décès lors d'une poussée hivernale chez les personnes à risque pourrait même motiver ces dernières à modifier leur comportement. Les personnes à haut risque (par exemple, âgées de plus de 65 ans, obèses ou avec des comorbidités) pourraient envisager de modifier leur comportement en hiver, par exemple en portant un masque et en évitant les lieux de rassemblement tels que les bars, les repas en salle, les concerts et les événements sportifs, ainsi que tout lieu où le risque de transmission est élevé.
Essayer enfin d’anticiper
Pour ces 2 experts, il n'est pas certain que la Covid-19 devienne une maladie récurrente saisonnière. Il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à la probabilité et la fréquence d'apparition de nouveaux variants, la réduction d'efficacité des vaccins pour chaque variant, la question de l'immunité croisée et la prédictibilité des comportements humains. Cependant, la perspective d'une Covid-19 persistante et saisonnière est réelle.
Si l'immunité acquise contre l'infection à SARS-CoV-2 ou si l'immunité liée au vaccin diminuent, ce risque s'accroîtra encore. Une Covid-19 saisonnière récurrente pourrait nécessiter un changement du système de santé, voire une adaptation culturelle profonde pour la vie des personnes à haut risque, pendant les mois d'hiver. Il serait urgent d’après les experts de commencer dès maintenant à se préparer à un tel scénario.