Pneumologie
Azithromycine dans l’asthme sévère : 60% de diminution de risque d’exacerbation
Devant un asthme mal contrôlé, un traitement additionnel avec l’azithromycine à faible dose diminue de 60% le nombre d’exacerbations selon une étude parue dans le Lancet. Un entretien avec Arnaud Bourdin, CHU de Montpellier.
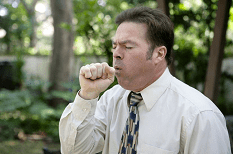
- © 123RF-Lisa Young
Les résultats n’étaient pas acquis si on se réfère à deux études précédentes : l’une était rétrospectivement positive, mais uniquement dans un sous-groupe de patients avec une inflammation de type neutrophilique et l’autre prospective était franchement négative. Donc refaire un essai se justifiait parfaitement avec des critères d’inclusion un peu différents.
Cette nouvelle étude publiée dans le Lancet, est randomisée, contrôlée, double aveugle contre placebo ; elle a inclus 420 patients sur une année. Ces patients souffrent d’asthme sévère mal contrôlé malgré un traitement par corticoïdes inhalé et béta 2 LD ; leur ACQ devait être supérieur à 1.5 ; ils avaient fait au moins une exacerbation dans l’année qui a précédé l’étude ; ils ont reçu 500 mg d’azithromycine, 3 fois par semaine pendant 48 semaines.
Diminution de 60%
Les résultats sont assez surprenants parce que très positifs : le groupe azithromycine a bénéficié d’une réduction significative du risque d’exacerbation de 60% : les auteurs retrouvent 1,07 exacerbations dans le groupe traité versus 1,86 pour le placebo. 44% des patients dans le groupe azithromycine a fait au moins une exacerbation, contre 61% dans le groupe placebo. Quant à la qualité de vie liée à l’asthme, l’AQLQ est largement améliorée par le traitement.
Neutrophile comme éosinophile
Ces résultats sont particulièrement intéressants et sont indépendants du type d’inflammation neutrophile ou éosinophile, la sélection des patients se basant uniquement sur leurs symptômes et le nombre d’exacerbations dans l’année précédente.
Des hypothèses sont proposées dans l’éditorial de G. Brusselle pour endre compte de ces résultats. On sait maintenant un peu mieux comment fonctionnent dans les voies aériennes les macrolides à ces faibles doses (3 fois 500 mg/semaine) : ce n’est pas l’effet antibiotique qui est impliqué, mais un mécanisme anti-inflammatoire en particulier sur l’épithélium bronchique qui est alors moins hyper-réactif, moins enclin à engendrer une réponse immunitaire exagérée caractéristique de l’asthme.
De là à utiliser ces macrolides larga manu dans cette indication, il n'en est pas question : outre l'attrait du coût, l’impact sur l’écologie bactérienne n’est pas anodin et on voit maintenant apparaître des germes intermédiaires ou résistants aux macrolides, par exemple dans la mucoviscidose, la BPCO ou la DDB, pathologies pour lesquelles ce traitement est parfois indiqué au long cours et à faible dose.
Il faut rester vigilant aussi sur les effets secondaires : l’ECG de référence est indispensable avec la mesure de l’espace QT congénital car l’azithromycine peut engendrer des torsades de pointe, comme est nécessaire un audiogramme de base et un suivi annuel. Des troubles digestifs sont également possibles. Donc cette prescription n’est pas anodine et doit être monitorée par quelqu’un qui en a l’habitude.
Pour Arnaud Bourdin il est difficile de recommander à partir d’une seule étude positive l’utilisation des macrolides dans l’asthme non contrôlé même s’ils ont déjà été expérimentés dans la BPCO, la DDB, ou la mucoviscidose. Des confirmations s’imposent et actuellement ce choix thérapeutique ne peut de faire que dans des centres experts et dans le cadre d’études randomisées.






























