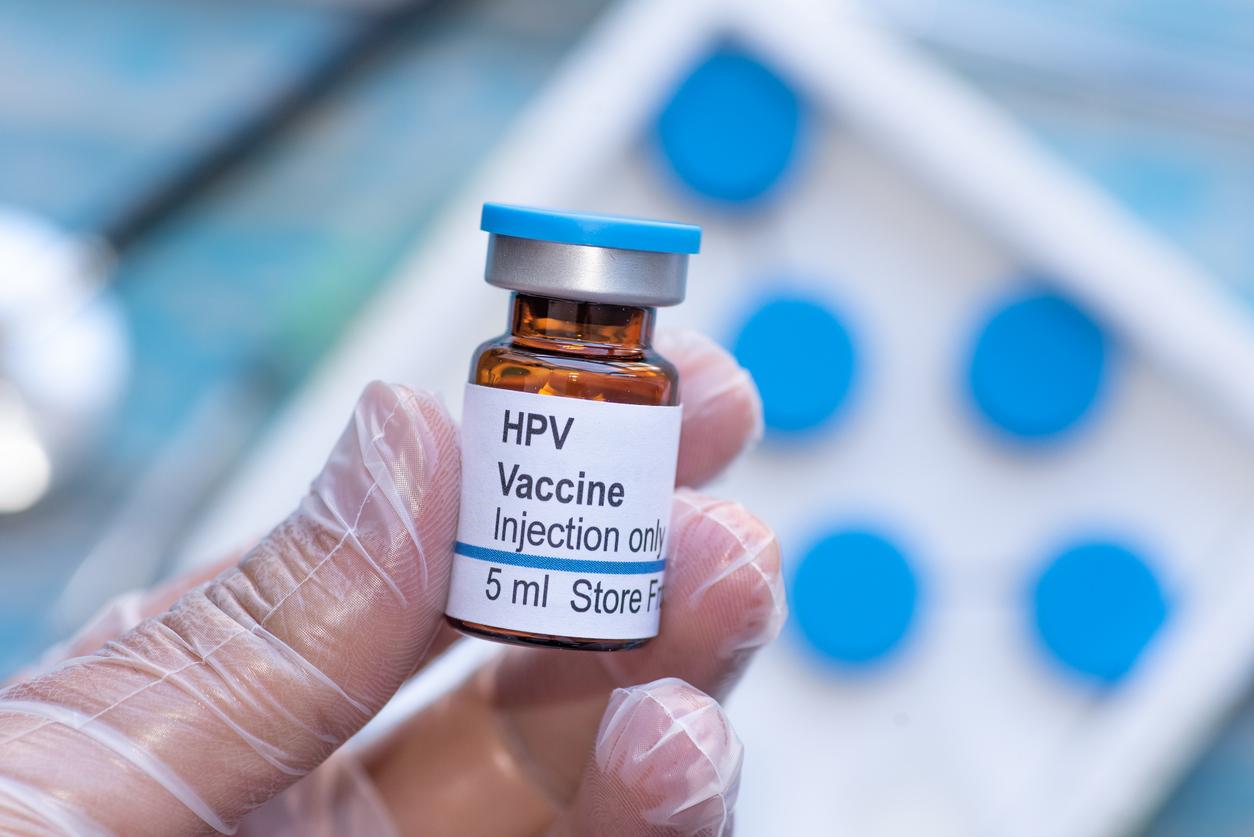Pédiatrie
HPV : il existe une immunité de groupe en vraie vie depuis l’introduction du vaccin
Chez des adolescentes et jeunes femmes sexuellement actives à haut risque, la vaccination contre la papillomavirus humain (anti-HPV) réduit fortement la prévalence des sérotypes HPV à risque, avec un effet indirect notable chez les non-vaccinées. Les baisses observées concernent les valences 2v/4v et, quoique plus modestement, la 9v, confortant l’impact réel du vaccin au-delà des essais cliniques et plaidant pour des stratégies de couverture élevées.

- KTStock/istock
Le HPV cause environ 4,5 % de l’ensemble des cancers, avec une part majeure des types 16/18 dans les cancers du col et de l’anus. Si l’efficacité des vaccins 2v, 4v et 9v est démontrée en essais, la question-clé est leur performance en conditions réelles, notamment chez des jeunes femmes déjà exposées sexuellement, parfois incomplètement vaccinées et socialement vulnérables. Cette étude transversale agrège 6 vagues de surveillance (2006–2023) en structures de soins, incluant 2 335 participantes de 13 à 26 ans (65,4 % Afro-Américaines ; 78,9 % ≥2 partenaires masculins ; 51,2 % avec antécédent d’IST).
Selon les résultats publiés dans le JAMA Pediatrics, la couverture vaccinale en Amérique du nord est passée de 0 % à 82,1 %. Chez les vaccinées, la positivité pour au moins un type vaccinal a chuté de 98,4 % pour 2v (de 27,7 % à 0,4 %), de 94,2 % pour 4v (35,4 % à 2,1 %) et de 75,7 % pour 9v (48,6 % à 11,8 %). Les régressions logistiques pondérées confirment ces diminutions : aOR 0,01–0,05 pour 2v, 0,04 (0,02–0,08) pour 4v et 0,14 (0,09–0,21) pour 9v chez les vaccinées.
Immunité de groupe : une protection directe et indirecte
Chez les non-vaccinées, un effet de « herd protection » (protection de groupe) est observé avec une baisse ajustée de 71,6 % pour 2v (25,8 % à 7,3 %) et 75,8 % pour 4v (25,3 % à 6,1 %), avec des aOR significatifs (2v 0,23 ; 0,08–0,63 ; 4v 0,19 ; 0,07–0,52). Pour 9v, la réduction chez les non vaccinées est plus modeste (27,2 %) et non significative en modèle ajusté, vraisemblablement du fait d’une adoption encore incomplète de la 9v (<30 % des vaccinées l’ayant reçue) et de faibles effectifs positifs.
À l’échelle globale de l’échantillon, les odds ratio d’infection par des types vaccinaux diminuent nettement pour 2v (aOR 0,03 ; 0,01–0,07) et 4v (0,06 ; 0,03–0,10) et pour 9v (0,22 ; 0,16–0,31). Le signal d’efficacité élevée persiste malgré des comportements sexuels à risque et des schémas vaccinaux parfois incomplets, soutenant l’intérêt de stratégies de doses réduites en santé publique. La tolérance n’était pas l’objet de ce travail populationnel ; aucune analyse d’événements indésirables n’est rapportée, l’accent portant sur la prévalence virologique.
De la surveillance locale aux politiques de prévention
Le dispositif repose sur 6 études de surveillance successives en vraie vie, avec classification par statut vaccinal (≥1 dose) et comparaison des prévalences de types cibles 2v/4v/9v entre vagues. Pour limiter les biais de structure, une pondération par score de propension (avec inverse probability weighting) a équilibré les différences inter-vagues (démographie, comportements sexuels, antécédents d’IST), et la validité du statut vaccinal a été renforcée par confirmation via dossier médical. La généralisation est toutefois limitée par un recrutement régional unique, la diminution du nombre de non vaccinées au fil du temps et un changement de méthode de typage HPV (Linear Array vers TypeSeq2) bien que jugé performant par des essais d’aptitude internationaux.
Selon les auteurs, ces données fournissent un argument robuste, en vie réelle, pour viser des couvertures vaccinales élevées et mixtes (filles et garçons), intégrer l’option de schémas à dose réduite lorsque cela est pertinent, et maintenir des stratégies de dépistage du col adaptées. Les priorités de recherche incluent la documentation de l’impact clinique (lésions précancéreuses et cancers) chez les garçons et jeunes hommes, l’évaluation de la protection collective 9v à mesure que sa diffusion progresse, et des études en contextes à faible couverture afin d’orienter les politiques de rattrapage et de réduction des inégalités.
Au total, l’efficacité populationnelle et l’immunité de groupe observées sur un suivi de 17 ans, y compris dans des profils à haut risque et partiellement vaccinés, confortent l’objectif d’élimination des cancers liés au HPV sous réserve d’une montée en charge mondiale de la vaccination et d’un accès équitable au dépistage et au traitement.