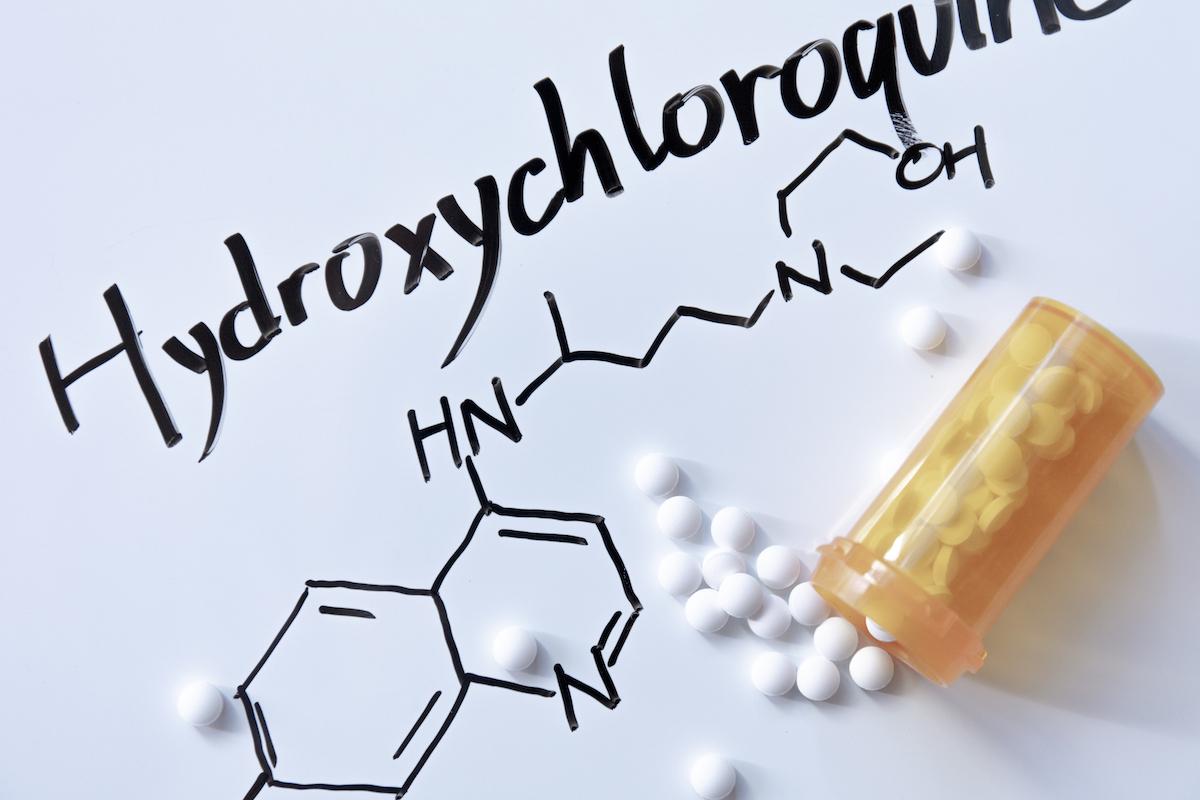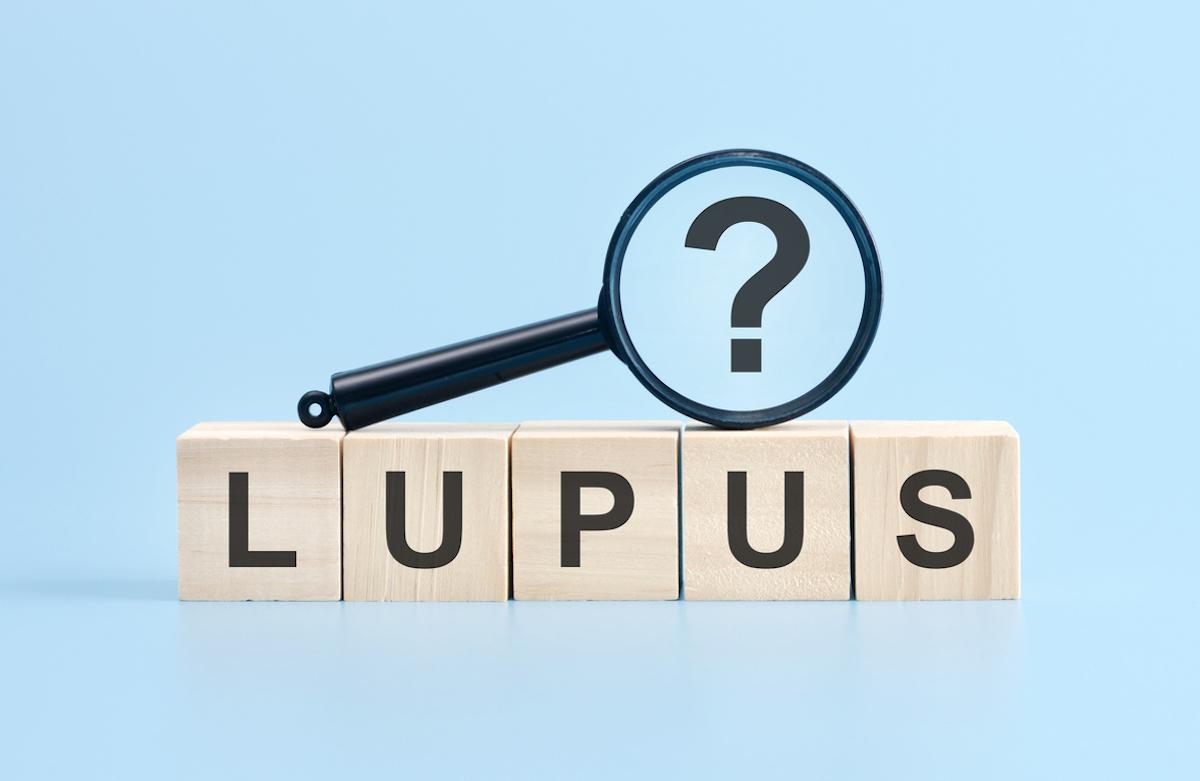Rhumatologie
Lupus érythémateux disséminé : un anti-interféron réduirait les lésions d'organes
L’ajout d’anifrolumab en add-on au traitement standard réduirait significativement les lésions des organes cibles chez des patients atteints de lupus érythémateux disséminé (LED) modéré à sévère. Cette stratégie pourrait prolonger la durée de vie sans défaillance d’organe dans cette population.
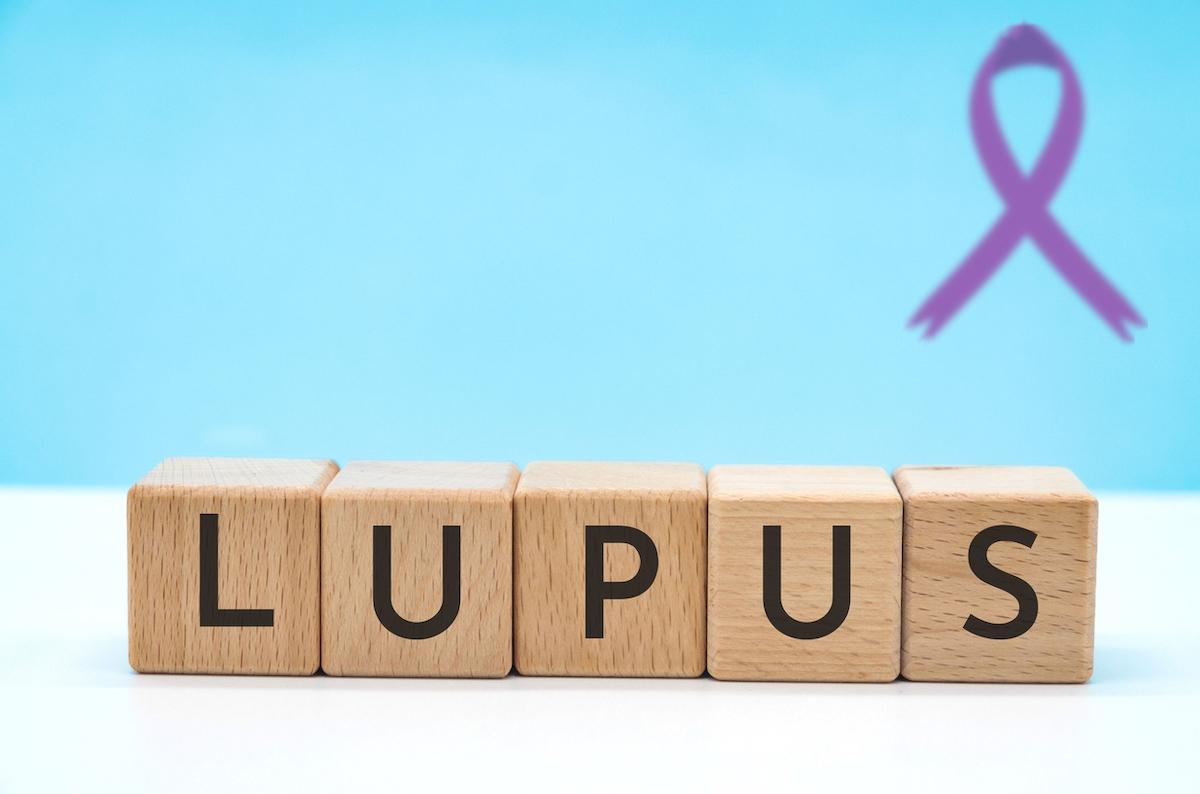
- Alex Aviles/istock
Le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie auto-immune multisystémique qui peut engendrer une inflammation chronique diffuse et des lésions tissulaires au niveau de nombreux organes. Malgré des traitements classiques (antimalariques, corticoïdes, immunosuppresseurs, AINS), une part importante de la morbidité est liée à l’accumulation de dommages irréversibles, favorisée par une maladie mal contrôlée, des poussées répétées et l’exposition prolongée aux corticoïdes. Dans cette optique, des traitements avancés ciblant les interférons de type I (IFN-T1) ont démontré une efficacité pour réduire l’activité de la maladie et la dépendance aux corticoïdes. L’anifrolumab, un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur commun des IFN-T1, a déjà prouvé son efficacité dans les essais de phase 3 TULIP-1 et TULIP-2, sur 52 semaines, pour des patients ayant un LED modéré à sévère.
Cependant, la persistance de son bénéfice sur l’accumulation des dommages organiques restait à préciser. Le protocole TULIP incluait un essai d’extension à long terme (LTE), mais le fort taux de sortie d’étude dans le groupe placebo (contre un taux plus faible dans le groupe anifrolumab) a compliqué l’évaluation directe de l’impact de l’anifrolumab sur ce critère. Pour combler cette lacune, une nouvelle analyse a comparé, sur quatre ans, les données des patients recevant anifrolumab dans TULIP (300 mg) à celles d’un groupe contrôle issu du registre de la University of Toronto Lupus Clinic (UTLC), recevant exclusivement le traitement standard (SOC) en conditions réelles (real-world).
Les résultats de cette émulation d’étude randomisée, publiés dans Annals of the Rheumatic Diseases, indiquent une différence de progression du Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage Index (SDI) en faveur de l’anifrolumab : +0,162 point d’augmentation moyenne en quatre ans vs +0,587 point pour le groupe contrôle, soit un différentiel de −0,416 point (IC 95 % : −0,582 ; −0,249 ; p < 0,001). Parallèlement, le risque d’augmentation du SDI était réduit de 59,9 % (HR = 0,401 ; IC 95 % : 0,213–0,753 ; p = 0,005) chez les patients ayant reçu l’anifrolumab.
Une utilisation précoce retarderait le développement des lésions
Au-delà de la diminution globale du score de dommages (SDI), les investigateurs ont examiné la dynamique du temps jusqu’à l’aggravation de ces dommages. Les patients sous anifrolumab plus SOC montrent un délai nettement prolongé avant la première augmentation du SDI. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ce bénéfice : un meilleur contrôle de l’activité de la maladie, une baisse des corticoïdes favorisée par l’anifrolumab, et la restriction d’autres immunosuppresseurs, imposée par le protocole TULIP.
Les études antérieures avaient déjà mis en évidence un effet positif d’anifrolumab sur l’atteinte d’un faible niveau d’activité de la maladie (LLDAS), la rémission, et la réduction de la dose de corticoïdes. Dans ces nouveaux résultats comparatifs, on observe par exemple une augmentation marquée de complications typiquement liées aux corticoïdes (nécrose avasculaire, cataracte) dans le groupe « vraie vie » sous traitement standard seul, suggérant le rôle clef de l’effet d’épargne cortisonique. Par ailleurs, aucun signal spécifique n’a été rapporté pour la tolérance à long terme de l’anifrolumab, déjà jugée satisfaisante dans les phases précédentes. Les résultats demeurent robustes à travers différentes approches d’analyse et après prise en compte du biais potentiel d’attrition.
Un essai d’émulation qui ne permet pas d’être affirmatif
Pour évaluer l’efficacité d’anifrolumab à long terme, les auteurs ont eu recours à un protocole dit de « target trial emulation », couplant les données randomisées TULIP-1 et -2 (et leur extension) à un bras contrôle de vie réelle extrait de la cohorte UTLC, un registre de référence pour le LED. Après application de critères d’inclusion comparables et d’un appariement par score de propension (pondérations pour la confusion initiale et la censure), les groupes étaient suffisamment homogènes à l’inclusion pour mesurer le paramètre central : l’accumulation de dommages au fil du temps. Cette démarche méthodologique, rigoureuse et de plus en plus reconnue, vise à pallier certaines limites qu’imposent des taux de sortie d’étude inégaux entre bras randomisés.
Selon les auteurs, ces données confirment qu’en plus du contrôle de l’activité et de la réduction de la corticothérapie, l’ajout d’anifrolumab au traitement standard pourrait se traduire par une diminution tangible de la progression des lésions organiques en quatre ans. Cette observation renforce l’intérêt d’un traitement ciblant l’axe de l’interféron de type I, au même titre que d’autres biomédicaments déjà validés dans le LED. Pour la pratique, cette étude plaide en faveur d’un recours plus précoce à des traitements avancés chez les patients dont la maladie reste active, afin de préserver le capital des organes-cibles sur le long terme.
En résumé, ces travaux suggèrent qu’un protocole associant anifrolumab et traitement standard réduit l’accumulation de dommages irréversibles liés au LED modéré à sévère, tout en repoussant la survenue d’une progression des lésions organiques pendant au moins quatre ans.