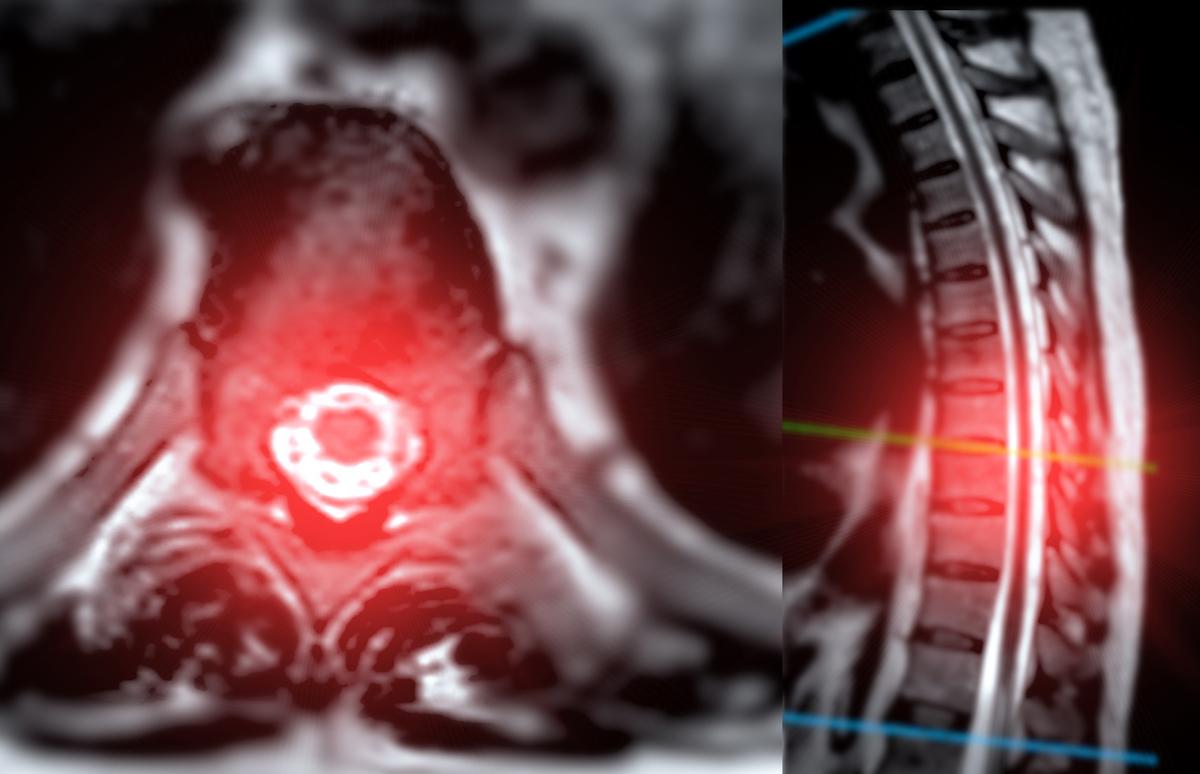Neurologie
Sclérose en plaques : évaluation d’un iBTK dans les formes rémittentes et secondairement progressives non actives
Le tolérutinib, un inhibiteur oral de la tyrosine-kinase de Bruton pénétrant le SNC, ne réduit pas le taux de rechute vs tériflunomide dans les formes rémittentes. Dans les formes secondairement progressives non active, il diminue de 31 % le risque de progression du handicap, avec un profil de tolérance globalement satisfaisant.

- Makhbubakhon Ismatova/istock
Le tolébrutinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton, oral, pénétrant le cerveau et bioactif, qui module l'inflammation périphérique et l'activation immunitaire persistante au sein du système nerveux central, y compris la microglie et les lymphocytes B associés à la maladie. Des données supplémentaires sont nécessaires sur son efficacité et son innocuité dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente.
Récemment, une étude sur l’evobrutinib, un autre inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton n’avait pas démontré de supériorité par rapport à une molécule de référence (Teriflunomide) dans les formes évoluant par poussées. Dans ce numéro d’Avril du New England Journal of Medicine, 3 études ont été publiées (2 études jumelles sur la forme rémittente, Gemini 1 et 2) et une sur la forme secondairement progressive non active (Hercules).
Etudes Gemini 1 et 2
Il s’agissait de deux essais de phase III, en double aveugle, versus placebo menées chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente. Ils ont été répartis aléatoirement, selon un rapport de 1:1, pour recevoir du tolébrutinib (60 mg une fois par jour) ou du tériflunomide (14 mg une fois par jour). Le critère d'évaluation principal était le taux annualisé de rechute. Le critère d'évaluation secondaire clé était l'aggravation confirmée de l'invalidité, maintenue pendant au moins 6 mois, évaluée dans une analyse du délai jusqu'à l'événement regroupée entre les essais.
974 participants ont été inclus dans l’étude GEMINI 1 et 899 dans l’étude GEMINI 2. Le suivi médian était de 139 semaines. Le taux annualisé de rechute dans les groupes tolébrutinib et tériflunomide est respectivement de 0,13 et 0,12 dans GEMINI 1 (rapport de taux, 1,06 ; intervalle de confiance [IC] à 95 %, 0,81 à 1,39 ; p = 0,67) et de 0,11 et 0,11 dans GEMINI 2 (rapport de taux, 1,00 ; IC à 95 %, 0,75 à 1,32 ; p = 0,98). Le pourcentage combiné de participants avec une aggravation confirmée de leur invalidité pendant au moins 6 mois est de 8,3 % avec le tolébrutinib et de 11,3 % avec le tériflunomide Le pourcentage de participants ayant présenté des événements indésirables est similaire dans les deux groupes de traitement, bien que le pourcentage de saignements mineurs ait été plus élevé dans le groupe tolébrutinib que dans le groupe tériflunomide (des pétéchies sont survenues chez 4,5 % contre 0,3 %, et des règles abondantes chez 2,6 % contre 1,0 %).
Conclusion : le tolébrutinib n’est pas supérieur au tériflunomide pour réduire les taux annualisés de rechute chez les participants atteints de sclérose en plaques récurrente avec cependant une diminution du risque de progression de la maladie confirmée à 6 mois. Le profil de tolérance semble bon.
Etude Hercules
Il s’agissait d’un essai de phase III, en double aveugle, contrôlé évaluant le tolebrutinib (60mg/j) versus placebo répartis aléatoirement, selon un ratio de 2:1, chez des patients atteints de sclérose en plaques secondairement progressive non active. Le critère d'évaluation principal est la progression confirmée du handicap, maintenue pendant au moins 6 mois.
Au total, 1 131 participants ont été randomisés : 754 ont reçu du tolébrutinib et 377 du placebo. La durée médiane de suivi était de 133 semaines. Un pourcentage plus faible de participants du groupe tolébrutinib que du groupe placebo a eu une progression confirmée de leur handicap pendant au moins 6 mois (22,6 % contre 30,7 % ; rapport de risque : 0,69 ; IC à 95 % : 0,55 à 0,88 ; p = 0,003). Des effets indésirables graves sont survenus chez 15 % des participants du groupe tolébrutinib et 10,4 % de ceux du groupe placebo. Au total, 4 % des participants du groupe tolébrutinib et 1,6 % de ceux du groupe placebo ont eu une augmentation de leur taux d’alanine aminotransférase supérieure à trois fois la limite supérieure de la normale avec un décès dans le groupe tolébrutinib.
Conclusion : Chez les participants atteints de sclérose en plaques secondaire progressive non récurrente, le risque de progression du handicap est plus faible chez ceux qui avaient reçu un traitement par tolébrutinib que chez ceux qui avaient reçu un placebo avec une réduction de 31% du risque de progression de la maladie. Le profil de tolérance semble bon avec cependant un point d’attention particulier sur les transaminases notamment en début de maladie.
Conclusion générale
Si les inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton en général, et le tolébrutinib en particulier, ne semblent pas apporter un bénéfice supplémentaire aux traitements existants sur la partie inflammatoire focale de la maladie et notamment dans les formes rémittentes pures, un intérêt dans les formes progressives semble se dessiner avec des éléments cliniques montrant un effet sur la progression aussi bien dans les formes par poussées que progressives. L’action sur l’inflammation chronique et la microglie explique possiblement cet effet particulier. D’autres études sont en cours dans les formes rémittentes avec le fenebrutib et le remibrutinib et dans les formes progressives primaires avec le tolebrutinib et le fenebrutinib. Une attention particulière devra être apportée à la fonction hépatique et, à moindre degré, aux microsaignements.