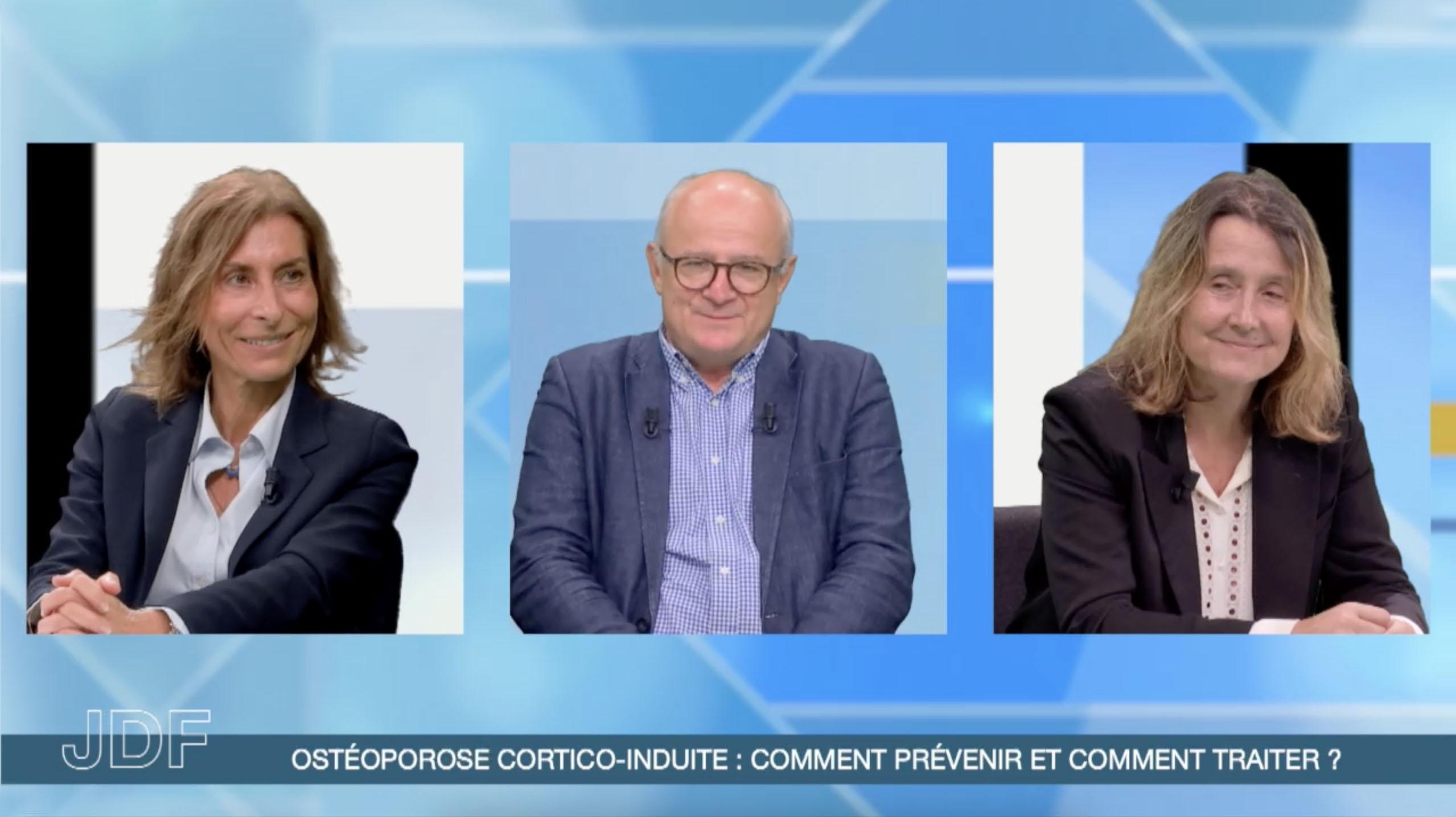Elections et débat national
Santé et Présidentielle : les 3 maladies de l’hôpital public (diagnostic, traitement)
Après la crise de l’hôpital et la pandémie Covid-19, dans le cadre de la campagne présidentielle, nous avons interrogé les candidats et des représentants de la société civile sur leurs propositions de réforme de la Santé. Aujourd’hui, le texte du Pr André Grimaldi, diabétologue et infatigable animateur d’une réflexion collective sur l’hôpital public.

- sefa ozel/istock
Le Pr André Grimaldi, est diabétologue, professeur émérite au CHU Pitié-Salpêtrière, à Paris. Il est cofondateur du Collectif Inter-Hôpitaux et animateur d’une réflexion collective sur la réforme de l’hôpital publique. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la santé, les médicaments et les maladies chroniques, dont le Manifeste pour la santé 2022 (Editions Odile Jacob)
Tout le monde est d’accord sur le constat - l’hôpital est malade - même si les gestionnaires administratifs le trouvent moins malade que les professionnels ne le rapportent dans les media. Quant aux responsables politiques au pouvoir, ils renvoient systématiquement la responsabilité à leurs prédécesseurs. A les écouter, le mal est si profond et vient de si loin qu’il faut au moins deux quinquennats pour retrouver « les jours heureux ».
Diagnostic
Pour mettre en œuvre un traitement efficace, encore faut-il être d’accord sur le diagnostic. Or l’hôpital public cumule trois maladies temporellement datées, mais aux effets cumulatifs : 1. il est malade des défaillances de la médecine de ville, 2. il est malade des défauts de la grande réforme de 1958, et 3. Il est malade de la politique de l’hôpital-entreprise sous contrainte budgétaire, suivie depuis quinze ans.
1. L’hôpital est en effet malade de la médecine libérale « canal historique » se réclamant de la charte de 1927, revendiquant le travail solitaire en cabinet, le paiement à l’acte et la liberté d’installation. Jusqu’à la fin des années 1990, les syndicats médicaux majoritaires feront obstacle à la construction d’un service public de la médecine de proximité, dite de premier recours, où les professionnels médicaux et paramédicaux travaillent en équipe et acceptent des rémunérations forfaitaires, mettant fin au « tout paiement à l’acte ». C’est une petite révolution qu’il faut mettre au crédit, pour l’essentiel, du syndicat MG-France, car le travail en équipe était jusque-là, suspect de « compérage ».
Ce service de la médecine de proximité se construit laborieusement depuis une quinzaine d’années à partir des centres de santé (au nombre de 500), des maisons médicales pluri-professionnelles (au nombre de 2000) et des Communautés professionnels de territoire de santé CPTS qui sont à ce jour moins de 200. Sa construction est ralentie par la lourdeur bureaucratique. Depuis 2005, la participation des médecins libéraux à la permanence des soins n’est plus obligatoire, si bien que l’hôpital est devenu pour beaucoup de patients, le médecin traitant de premier recours. Plus de dix millions de personnes (représentant environ 50% des passages aux Urgences) viennent chaque année faire la queue pendant plusieurs heures dans les services d’urgences hospitaliers, faute d’avoir trouvé une réponse médicale adaptée en ville.
Par ailleurs la logique inflationniste du paiement à l’acte, parallèlement aux progrès des examens de biologie et d’imagerie, explique la multiplication de prescriptions et d’actes inutiles souvent inutilement répétés (d’après plusieurs enquêtes 20 à 30% seraient injustifiés), en réponse à la demande accrue de la population vieillissante. La progression rapide des dépenses qui s’en suit, est à l’origine d’une double régulation visant à limiter la dépense publique : augmentation du reste à charge pour les soins courants obligeant de fait les citoyens à adhérer à une assurance privée « complémentaire » et limitation du tarif remboursé par la Sécurité sociale de la consultation médicale. Pour maintenir leurs revenus, les médecins furent obligés de multiplier les actes et les consultations en en raccourcissant la durée (en moyenne de quinze minutes). Leur brièveté a tendance à être compensée par la longueur des ordonnances comportant une liste d’examens à faire et de médicaments à prendre.
C’est ainsi qu’à la fin des trente glorieuses fut mise en place le numérus clausus visant à limiter le nombre de médecins sur l’argument partagé par tous, professionnels et syndicalistes, comme politiques des deux bords : « en santé c’est l’offre qui détermine la demande ». Autrement dit, en tout médecin sommeille un docteur Knock capable de transformer « un bien portant en un malade qui s’ignore ». Au lieu de relativiser le paiement à l’acte au profit de financements par dotations et/ou à la capitation, au lieu de repenser la répartition des tâches entre médecins et para médicaux travaillant en équipe, au lieu de chercher à « réguler » la liberté d’installation, on estima qu’en diminuant les médecins, on diminuerait le nombre de malades et que les médecins se répartiraient sur le territoire en fonction des besoins. Quant aux médecins libéraux, ils pensaient qu’étant plus rares « sur le marché », ils pourraient plus facilement revendiquer des augmentations tarifaires ou réclamer des dépassements d’honoraires. Ainsi, jusqu’en 2003, la Sécurité sociale paiera des retraites anticipées à dix mille médecins pour réduire la prétendue « pléthore médicale ». Conséquence : la pénurie actuelle de médecins, en ville comme à l’hôpital, qui devrait s’aggraver jusqu’en 2030.
2. La deuxième maladie de l’hôpital public tient aux limites de la grande réforme progressiste de 1958 ayant promu sous l’égide de Robert Debré trois mesures essentielles à l’origine des CHU : le plein temps hospitalier, la triple mission de soins, d’enseignement et de recherche, et l’humanisation des hôpitaux. La discipline phare n’était plus l’anatomie à l’origine du modèle anatomo-clinique antérieur, mais la biologie dont la place centrale sera consacrée par la création de l’INSERM en 1964.
Pour faire accepter sa réforme par une majorité de patrons hospitaliers hostiles, soutenus par l’académie de médecine, Robert Debré dut concéder la création d’un secteur privé à l’hôpital public où les médecins pourraient recevoir leur clientèle et fixer eux-mêmes leurs honoraires, avec « tact et mesure ». Les CHU furent à l’origine d’un très grand progrès de l’ensemble des hôpitaux français, y compris non-universitaires, dans la mesure où ces derniers bénéficièrent de la compétence des anciens internes et assistants formés dans les CHU.
Cependant, à partir des années 1980, les aspects négatifs de la réforme Debré devinrent de plus en plus prégnants. Le plein temps avait entraîné la coupure de l’hôpital avec la ville. Les progrès bio-technologiques avaient entraîné la surspécialisation au détriment de la prise en charge globale des patients. La médecine interne n’était plus le socle commun, mais était écartelée entre, d’une part, l’hyperspécialisation concernant les maladies rares et les maladies dites « de système » et, d’autre part, la médecine générale polyvalente et l’aval des urgences. La recherche et les publications étaient les conditions de la promotion universitaire. Pour assurer les soins au quotidien, on remit en cause la triple mission et la double appartenance à la santé et à l’université, en créant des praticiens « monoappartenants » non universitaires. On provoquait ainsi une hiérarchisation du pouvoir entre hospitalo-universitaires (HU) et hospitaliers(H). Les publications qui faisaient les professeurs des universités n’étaient pas une garantie de compétences pour les autres missions. Et tandis que la profession se féminisait, plus on montait dans la hiérarchie médicale hospitalière, moins il y avait de femmes. De trois, les missions étaient devenues en réalité cinq, dans la mesure où étaient venues s’ajouter aux soins à l’enseignement et à la recherche, la gestion et des activités diverses de santé publique. Ces cinq missions n’étaient pas réalisables par une seule personne mais nécessitaient une équipe dont chaque membre pouvait effectuer sérieusement au mieux deux missions en même temps. L’enseignement devenait la dernière roue du carrosse. L’objectif des enseignants étant moins de préparer les futurs praticiens cliniciens du pays, en particulier les futurs médecins généralistes, que de former des spécialistes hospitaliers « pointus » à leur image. Non sans mal, les médecins généralistes durent forcer la porte des CHU pour y assurer l’enseignement de leur discipline. Enfin la santé publique était reléguée à la dernière place dans la hiérarchie des spécialités, faute d’une réflexion sur l’évolution des besoins de santé.
Pourtant dès 1973 Robert Debré s’adressant à un parterre de chefs de service avait estimé qu’il n’avait fait que la moitié du travail. Il les exhortait à « faire la révolution ». « Ce que j’ai fait avec la biologie, vous devrez le faire avec la santé publique, en faisant venir travailler avec vous, des économistes, des sociologues, des psychologues, des statisticiens… » Et il ajoutait « La majorité des patients consultant à l’hôpital ne seront pas dans des lits. Vous et vos élèves vous devrez sortir de l’hôpital ». En effet nous avons construit un système de soin qui répare plus qu’un système de santé qui prévient. Notre système est assez adapté et performant pour les maladies aigües et les gestes techniques, maladies bénignes en ville (la première médecine), maladies aigües graves et complexes à l’hôpital (deuxième médecine). Mais nous sommes mauvais pour le suivi des maladies chroniques (la troisième médecine) et pour la santé publique (la quatrième médecine), comme on l’a vu lors de la pandémie. Les deux premières médecines sont centrées sur la maladie et sur les gestes techniques, la troisième médecine est centrée sur la personne dans ses dimensions biologiques, psychologiques sociales et culturelles, car c’est le malade qui doit tous les jours suivre son traitement et vivre avec sa maladie. La pédiatrie et la gériatrie en sont le modèle. Quant à la quatrième médecine, la santé publique, elle est centrée sur les populations dans une démarche de prévention et de réduction des inégalités sociales de santé.
Or, si nous sommes mauvais pour les 3ème et 4ème médecines, c’est en grande partie pour les mêmes raisons : défaut de coordination entre la ville et l’hôpital et entre le médical et le médico-social, insuffisance du travail en équipe pluri-professionnelle, manque de formation à la pédagogie, à la psychologie, à la sociologie, à l’anthropologie, finalement à la médecine narrative, à l’éducation thérapeutique et à la pratique de santé communautaire (communautaire, non communautariste). Nous pratiquons une médecine prescriptive d’actes et d’examens, plus qu’une médecine préventive qu’il s’agisse de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Les médecins libéraux se méfient de la santé publique car ils y voient la mainmise de l‘Etat et les hospitaliers, centrés sur les progrès de la biotechnologie, la regardent de haut ou de loin. La vision maculaire de l’hyper-spécialiste hospitalier technophile a été à l’origine à la fin du siècle dernier de l’émergence du concept erroné de « médecine industrielle ». Mais si le médecin était devenu un ingénieur, l’hôpital devait devenir une entreprise, et le directeur un manageur. Faute d’avoir compris que la santé publique devait être la nouvelle discipline maitresse investissant l’ensemble des disciplines médicales, au lieu d’être réduite à l’épidémiologie et à l’élaboration de normes basées sur les faits démontrés, les médecins (notamment de CHU) ont laissé aux manageurs de la Fédération hospitalière de France (FHF) et aux économistes libéraux le soin d’élaborer et de promouvoir la réforme de l’hôpital public, en relayant auprès des décideurs politiques le tournant néolibéral mondial des années 1980-1990. Gérard Vincent, le délégué général de la FHF déplorait en 2006 « le retard de changement de gouvernance hospitalière française par rapport aux nouvelles règles de bonne gouvernance promue par les organisations internationales, de l’OCDE et de l’Union européenne et de leur Think Tank ».
3. La 3ème maladie de l’hôpital est due en effet à l’application à la santé de la politique néolibérale élaborée à l’échelle internationale à la fin du siècle dernier et mise en œuvre en France depuis le début du siècle.
Soulignons que cette politique fut appliquée sur un hôpital public fragilisé par l’application en 2000 des 35 heures, sans embauche suffisante de personnels. Les 35 heures furent en effet appliquées à l’hôpital exactement comme dans une entreprise industrielle avec, en contrepartie, un blocage des salaires, une « optimisation » des horaires de travail comptabilisés à la minute et pouvant varier d’une semaine à l’autre, une instabilité des jours de repos, le tout rendant de plus en plus difficile le travail en équipe et participant à la perte de sens du travail.
Le principe de la politique néolibérale est que toute activité humaine qui peut être mesurée doit être valorisée et mise en concurrence sur le marché, le rôle de l’Etat n’étant pas de gérer mais seulement de fixer des normes et d’assurer le caractère à la fois libre et non faussé de la concurrence pour obtenir le meilleur rapport qualité/coût. Il n’y a donc plus deux gestions, la gestion publique cherchant la meilleure efficience pour la collectivité et la gestion privée recherchant la meilleure rentabilité pour le producteur/vendeur mais une seule gestion, la bonne, la gestion privée basée sur l’intéressement financier du prestataire. C’est ainsi qu’en 2004 on introduisit la tarification à l‘activité (T2A), qu’on généralisa à l’ensemble des activités de soins en 2008 (le 100% T2A). Seules les activités très difficiles, voire impossibles, à quantifier, comme la psychiatrie ou l’éducation thérapeutique, échappaient à la T2A. Quant aux missions de service public (greffes d’organes et de tissus, soins aux prisonniers, permanence d’accès aux soins pour les personnes démunies, formation des professionnels, urgences …), elles pouvaient être vendues à la découpe quel que soit le statut de l’établissement public ou privé, répondant à un cahier des charges.
C’est ainsi que fut instaurée en 2008 un processus de « convergence tarifaire » entre les hôpitaux publics et les cliniques commerciales pour égaliser le financement des actes réalisés dans les établissements publics et privés. Ce processus, qui devait s’achever initialement en 2012, fut reporté de plusieurs années à la suite du mouvement de protestation des personnels hospitaliers, avant d’être formellement (mais pas réellement) annulé en 2017. La fédération de l’hospitalisation privée (FHP) avait lancé une grande campagne publicitaire dénonçant les montants des tarifs payés par la Sécurité sociale plus élevés pour l’hôpital public sur le thème : « Pour sauver la Sécu, choisissez la clinique ». Elle alla jusqu’à porter plainte à deux reprises à Bruxelles contre le gouvernement français pour « concurrence déloyale ». En réalité, si concurrence déloyale il y a, elle est au profit des cliniques commerciales et des établissements privés à but non lucratif (ESPIC), qui choisissent leurs activités et dans lesquels les professionnels jugés rentables pour l’établissement et embauchés sous contrat (orthopédistes, radiologues, anesthésistes, manipulateurs radios…), peuvent gagner de 1.5 à 3 fois plus qu’à l’hôpital.
En 2009 La loi Bachelot instaura la « gouvernance d’entreprise » avec suppression du service public hospitalier, suppression formelle des services cliniques, ravalés au rang de « structures », au profit de pôles de gestion regroupant de façon plus ou moins arbitraire plusieurs services pour permettre des mutualisations de personnels et des suppressions d’emplois. Le directeur médical du pôle était nommé par le directeur administratif, « seul maître à bord », selon l’expression du président Sarkozy. Ce directeur de l’hôpital-entreprise, nommé par l’Agence régionale de santé (ARS), pouvait venir du secteur privé sans avoir de compétence particulière en santé publique. Le principe de la recherche de rentabilité était inscrit dans la loi prévoyant la possibilité d’un intéressement financier individuel des agents aux bénéfices éventuels de l’établissement, les directeurs touchant une prime annuelle en fonction des résultats économiques, pouvant aller jusqu’à 45 000 euros. Ainsi la T2A ne fut pas utilisée comme une technique de financement adaptée à certaines activités facilement quantifiables, sans grande variabilité de coût d’un parient à l’autre, comme la chirurgie ambulatoire, la médecine interventionnelle programmée ou la séance de dialyse, mais comme un outil politique mettant en œuvre la concurrence avec le privé lucratif. Les promoteurs de la T2A les plus lucides estimaient que cette concurrence imposerait quasi automatiquement l’adoption par l’hôpital d’une gestion privée de type commercial et éventuellement secondairement conduirait à l’abandon du statut public, comme ce fut le cas pour un tiers des hôpitaux publics allemands vendus au privé. Jean de Kervasdoué, ancien directeur des hôpitaux, pouvait écrire dans son « Que sais-je » publié en 2004 sur l’hôpital public « l’Hôpital est une entreprise comme une autre…le mot marketing choque mais c’est bien de cela dont il s’agit : l’hôpital cherche à vendre ». Et Mireille Faugère directrice de l’APHP de 2010 à 2013, ayant fait sa carrière à la SNCF, pouvait adopter comme slogan publicitaire pour attirer le client « A nous de vous faire préférer l’APHP ! ». La FHF se félicitait de gagner des « parts de marché », en oubliant que si l’hôpital devait désormais être géré comme une clinique commerciale, les professionnels finiraient par préférer l’original à la copie, au moins ceux d’entre eux qui y gagnaient beaucoup plus.
Il fallut donc tout mesurer pour tout valoriser. Mais il y a 10 000 pathologies avec trois à quatre degrés de gravités et des facteurs psychologiques et sociaux. On passa donc de 700 groupes dits homogène de séjours, en réalité très hétérogènes, à plus de 2500 on distingua la cause de l’hospitalisation du diagnostic principal, on spécifia les comorbidités, on prit en compte la précarité, on définit les degrés de sévérité… C’est ainsi que la dénutrition et les escarres devinrent très rentables. On embaucha des codeurs professionnels et certains recoururent à des entreprises privées spécialisées dans le codage pour maximiser la facture adressée à la Sécurité sociale. Celle-ci dut multiplier les contrôles et les redressements financiers plus ou moins arbitraires. La marchandisation entraînait la bureaucratisation. Pire les tarifs guidèrent la pratique, le business plan remplaçait le projet médical. Pour faire « chauffer » la T2A, on demandait des examens et des consultations spécialisées inutiles mais nécessaires pour pouvoir justifier la facturation d’un hôpital de jour. Par contre s’il n’existait pas de tarif dédié à une nouvelle activité, il était irresponsable de vouloir la développer. C’est ainsi que s’explique l’énorme retard pris par la France en matière de télémédecine, avant la survenue de la pandémie. L’absence de tarif provoque l’absence d’activité, tandis que la création d’un tarif s’accompagne de la production de normes et de contrôles.
Mais en 2010, suite à la crise financière de 2008 puis à la crise économique qui s’en suivit, le gouvernement chercha à réduire la dépense publique, en particulier les dépenses de santé. Il décida donc d’instaurer une « régulation » a priori, c’est-à-dire d’imposer une limitation des dépenses. Et pour ce faire, il transforma l’ONDAM (objectif national des dépenses de l’assurance maladie) qui n’était comme son nom l’indique qu’un objectif régulièrement dépassé, en un budget contraint indépassable. Cela n’était guère possible en ville dont la régulation se fait a posteriori par une négociation entre la Sécurité sociale et les syndicats des professionnels de santé. Alain Juppé qui avait essayé en 1997 d’imposer une réduction des rémunérations des médecins libéraux en cas de dépassement de l’ONDAM de ville, avait été contraint à un recul rapide qui s’était payé dans les urnes par la perte de la majorité parlementaire. La chose était plus facile à appliquer aux hôpitaux dans la mesure où c’est l’Etat qui fixe le montant des tarifs de remboursement par la Sécurité sociale sans négociation avec les professionnels. A la suite du rapport de Raoul Briet (2010), conseiller maître de la Cour des comptes, deux mesures furent donc décidées pour maintenir les dépenses de santé dans l’enveloppe de l’ONDAM votée chaque année par le Parlement. D’abord une mise en réserve dite « prudentielle » en début d’exercice de plusieurs centaines de millions (en moyenne 400 millions) qui jusqu’en 2019 ne furent pas rendus aux hôpitaux en fin d’exercice. Ensuite une règle d’ajustement prix-volume pour qu’en cas d’augmentation de l’activité les prix baissent automatiquement. Les tarifs étaient ainsi dissociés des coûts réels. Chaque année le Parlement votait une progression de l’ONDAM en moyenne de 2.3% quand l’augmentation prévue des charges et des besoins était estimée officiellement entre 4% et 4.5% (pendant ce temps la dotation de la psychiatrie ne progressa annuellement que de 1.2% en moyenne). Le Parlement votait donc ainsi chaque année la mise en déficit des hôpitaux.
Pour maintenir l’équilibre des comptes, les directeurs devaient donc supprimer des dépenses inutiles, réduire l’investissements et surtout pousser à l’augmentation de l’activité « rentable » sans augmenter le personnel dans la mesure où les coûts de personnels représentent 60% des dépenses de l’hôpital. C’est ainsi que les hôpitaux sont amenés à combiner de façon absurde manque de personnels et activités inutiles. Les directeurs copièrent la stratégie commerciale industrielle visant à réduire au maximum le coût généré par les stocks. La consigne devint : il faut « passer de l’hôpital de stock à l’hôpital de flux ». Pas de stock du flux pour les patients, comme pour les lits. Il fallait viser une occupation des lits proche de 100%. Les patients durent désormais attendre plusieurs heures voire plusieurs jours sur des brancards aux Urgences dans l’attente de la libération d’un lit (on découvrira au début de la pandémie qu’on avait appliqué la même règle, « pas de stock du flux », pour les masques et pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur). Ainsi en quinze ans, l’activité a augmenté de 15% sans augmentation de personnel soignant paramédical au lit du malade, 70 000 lits ont été fermés tandis que l’investissement diminuait de 40% et les tarifs baissaient de 7%. A ce petit jeu du hamster dans la roue pédalant de plus en plus vite pour ne pas tomber, l’hôpital devait un jour atteindre ses limites et caler. Ce fut le cas en 2017, mais Marisol Touraine baissa encore les tarifs de 0.9% après les avoir baissés en 2016 de 1%. En 2018, bien qu’elle eut dénoncé l’absurdité de l’hôpital entreprise et du tout T2A, Agnès Buzyn fut à nouveau obligée par Bercy de baisser les tarifs de 0.5%. En 2019 éclataient les crises en cascade, crise de la psychiatrie, puis crise des EHPAD, puis des urgences, puis des hôpitaux. La ministre décidait alors d’augmenter les tarifs de la T2A de 0.2% et osait déclarer « c’est une première historique ».
La suite est connue. Si le Ségur consacra 10 milliards aux revalorisations salariales, il ne changea rien fondamentalement aux modes de financement et de gouvernance des hôpitaux Et pour « renforcer l’attractivité de l’hôpital », il ouvrit la porte à une extension de l’activité privée des praticiens hospitaliers, remettant en cause sans oser le dire clairement le plein temps instauré par la réforme Debré. Quant aux 19 milliards d’investissements annoncés, ils sont programmés sur 10 ans, incluent le remboursement partiel de la dette hospitalière, concernent l’hôpital et la ville et comportent 2 milliards de mise en réserve. L’annonce est plus grosse que la dotation.
Le grand discours de Mulhouse du président Macron sur l’existence de biens supérieurs qui doivent échapper aux lois du marché, sur la nécessité de décisions de ruptures pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant et son exhortation à nous réinventer, « moi le premier » avait-il précisé, semblent s’être retirés avec la vague. Edouard Philippe inaugura le Ségur en déclarant au contraire que le diagnostic fait antérieurement était le bon et qu’il ne s’agissait pas selon lui de changer de cap mais seulement d’accélérer. Et effectivement la fermeture de lits a accéléré passant de 3400 en 2019 à 5700 en 2020.
Traitement
Nous n’avons pas vécu une crise aiguë mais, comme le dit Boris Cyrulnik, une catastrophe, c’est-à-dire que nous changeons de période historique. Les crises vont se prolonger et se cumuler. Les crises climatiques, économiques, sociales entraîneront des migrations de populations et des crises politiques. Toutes déboucheront sur des crises sanitaires. Il faut tout revoir et redonner sa place à l’Etat dont la santé est une fonction régalienne. Le président Macron en avait eu l’intuition : « La santé gratuite sans condition de revenus, de parcours ou de professions, notre Etat-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe ». Cependant le risque est réel d’un renforcement à la fois de l’autoritarisme et du manque d’efficacité de l’Etat bureaucratique. D’où la nécessité d’appliquer à la Santé les principes de subsidiarité et de démocratie participative concrétisés par une cogestion entre l’administration et les professionnels avec la participation des usagers.
Il est urgent de nous préparer à cette nouvelle période en renforçant notre première ligne de défense, la médecine de premier recours, et en reconstruisant l’hôpital public.
Dix mesures essentielles pour l’hôpital:
1. Adopter en début de quinquennat un plan de santé publique sur cinq ans en fixant sa temporalité et son financement. Fixer l’ONDAM annuel entre 3 et 4% en doublant la dotation de la psychiatrie. Supprimer la régulation a priori actuelle par la « mise en réserve prudentielle » et la politique du rabot tarifaire. Instaurer une régulation a postériori pour accroître la pertinence des actes et des prescriptions en mobilisant l’ensemble des acteurs et en organisant une négociation annuelle entre la Sécurité sociale et les professionnels de santé de la ville et de l’hôpital. La réduction des actes et examens inutiles doit aller de pair avec la suppression des rentes à commencer par les 7.6 milliards d’euros de frais de gestion des assurances santé complémentaires venant s’ajouter inutilement aux 6.9 milliards de frais de gestion de la Sécurité ociale
2. Limiter la T2A aux activités standardisées programmées, financer les soins palliatifs par un prix de journée, utiliser pour les autres activités la dotation annuelle modulée en fonction de l’évolution de l’activité (la DAMA)
3. Assurer à tous les niveaux une cogestion entre l’administration et les soignants (médicaux et paramédicaux), avec la participation des usagers
4. Redonner le pouvoir aux services cliniques ayant la liberté de s’associer ou de mutualiser des moyens techniques et humains, en accord avec le projet médical de l’établissement. Supprimer les pôles de gestion. Limiter les mandats de chefs de service à deux quinquennats
5. Dans les CHU et hors CHU, reconnaître et valoriser les activités de recherche et d’enseignement des PH. Dissocier les responsabilités de gestion des titres universitaires. Reconnaître la quintuple mission réalisée par les équipes médicales.
6. Recruter et former 100 000 infirmières afin d’assurer dans chaque unité de soins un quota de soignants présents au lit du malade pour assurer la sécurité et la qualité des soins. Ces quotas adaptés à la charge de travail, doivent être déterminés à partir d’une évaluation de terrain et de données comparatives nationales et internationales. Fixer le niveau de rémunération des infirmières et de l’ensemble des soignants (par rapport au salaire moyen du pays) au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE. Organiser une progression de carrière des infirmières à partir de la validation des acquis d’expérience et de formation avec un statut et une progression salariale importante dans trois domaines de compétences : les soins techniques, le suivi et l’éducation des patients atteints de maladies chroniques, la coordination des soins.
7. Aider à construire le service public de santé intégré (pas de dépassement d’honoraires, travail en équipe pluri-professionnelle, participation à la permanence des soins, inscription de l’activité dans un projet de santé territorial, participation à une CPTS). Développer dans ce cadre les activités mixtes médicales et paramédicales ville/hôpital
Participer à la construction de parcours de soins sur la base d’une graduation en trois niveaux : premier recours généraliste, deuxième recours spécialisé, troisième recours référent.
8. Aider à la résorption des déserts médicaux par différentes mesures :
• proposer aux étudiants un contrat d’engagement de cinq ans d’activité dans un désert médical (au choix) en échange d’un salaire pendant les études,
• créer un statut de praticien hospitalier détaché et rémunéré par l’hôpital dans un désert médical pour une durée de deux ans, renouvelable, avec possibilité ultérieure d’une carrière hospitalière,
• organiser des consultations spécialisées avancées
• aider à la construction de maisons de santé pluri-professionnelle (MSP) ou de centres de santé avec libre choix du statut libéral ou salarié, financement par les collectivités d’assistants médicaux et prise en charge par l’Etat de l’assurance professionnelle.
9. Poursuivre la réforme d’admission dans les études médicales en supprimant le PASS (parcours accès santé spécifique) et en plaçant les études de médecine en dérivation sur les cursus de licences en particulier de biologie mais aussi en réservant des places pour les sciences humaines et sociales et les formations d’ingénieurs (chaque étudiant aurait deux chances). En alternant la formation théorique à la faculté et les stages pratiques à plein temps, encadrés par des médecins-enseignants formés, en ville et à l’hôpital. En organisant pour les internes ayant choisi la médecine une formation partagée avec les paramédicaux, à la médecine narrative, à l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et à la médecine communautaire avec participation de patients experts ou ressources ou médiateurs de santé. Transformer les facultés de médecine en facultés de santé intégrant une formation à la prévention et à la santé environnementale
10. Enrayer le déclin de la recherche médicale française. En doublant les moyens attribués à la recherche médicale. En créant une filière recherche au cours des études médicales, en créant à partir des grands CHU des réseaux de recherche pour regrouper les moyens et sortir de l’éparpillement actuel responsable d’un manque de résultat , en regroupant les sources de financement tout en sanctuarisant la recherche clinique et en développant la recherche en santé publique et en soins infirmiers, en assurant des financements pérennes de longue durée à côté des appels à projets à plus court terme, en facilitant l’accès à des fins de recherche aux données massives de santé du SNDS (système national des données de santé), en développant des études de vraie vie indépendantes de l’industrie.