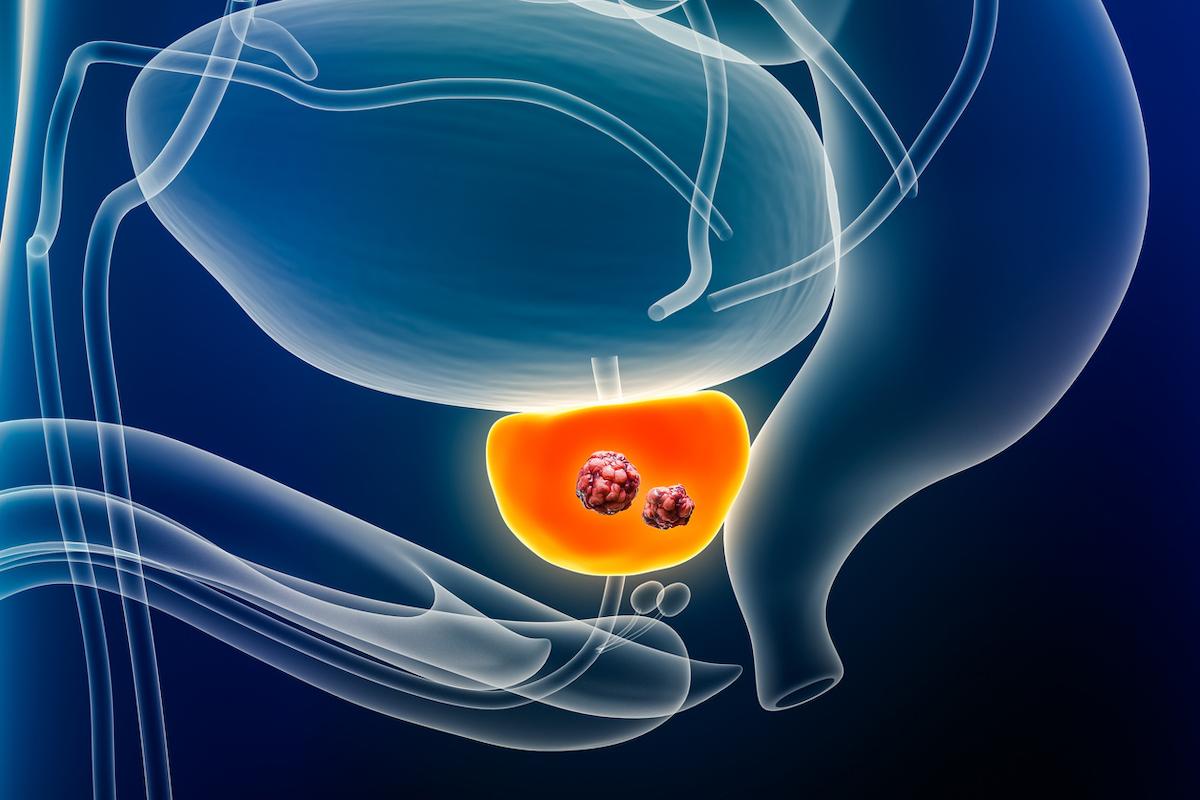Urologie
Cancer de la prostate métastatique hormono-résistant : importance du profilage moléculaire
Chez les patients souffrant d’un cancer de la prostate résistant à la castration et en cas d’altérations de la réparation homologue (HRR), la survie médiane passe de 31 à 45 mois, doublant même chez ceux mutés BRCA2. Les nouveaux résultats finaux de TALAPRO‑2 changent le standard thérapeutique et soulignent l’importance du profilage moléculaire.

- korawat thatinchan/istock
Dans le cancer de la prostate, l’évolution vers un stade métastatique résistant à la castration (mCRPC) aggrave nettement le pronostic des patients. De plus, les cancers de la prostate métastatiques (mCRPC) résistants aux hormonothérapies traditionnelles restent incurables et se révèlent plus agressifs chez les patients qui ont une altération des gènes impliqués dans la réparation de l’ADN, tels que BRCA2. Dans cette sous-population, l’espérance de vie moyenne est d’environ deux ans. L’essai international de phase III TALAPRO‑2 a testé, en première ligne mCRPC, l’ajout d’un inhibiteur de PARP (PARPi), le talazoparib 0,5 mg/j, à l’enzalutamide 160 mg versus enzalutamide seul.
Parmi les 399 sujets HRR‑déficients et résistants qui ont été randomisés, l’analyse finale après 44 mois de suivi montre une réduction de 38 % du risque de décès (HR 0,62 ; IC à 95 % 0,48‑0,81 ; p = 0,0005). La médiane de survie globale atteint 45,1 mois (IC à 95 % 35,4‑NR) sous bithérapie contre 31,1 mois (27,3‑35,4) sous monothérapie. Le bénéfice est maximal chez les 155 porteurs de BRCA1/2 : médiane non atteinte vs 28,5 mois (HR 0,50 ; p = 0,0017) et un taux de survie à 4 ans de 53 % versus 23 %. Les résultats sont publiés dans 2 articles simultanés parus dans The Lancet.
L’association PARPi et enzalutamide
La supériorité s’étend au critère primaire initial, la survie sans progression radiographique : HR 0,47 (0,36‑0,61 ; p < 0,0001), soit une médiane de 30,7 mois contre 12,3 mois. Dans la cohorte globale non sélectionnée (n = 805), l’association confère aussi un allongement significatif de la survie (45,8 vs 37,0 mois ; HR 0,80 ; p = 0,016), avec un avantage marqué chez les HRR‑déficients (HR 0,55) et moindre chez les HRR sauvages ou inconnus (HR 0,88).
Les évènements grades ≥3 dominés par l’anémie (43 %) et la neutropénie (20 %) restent attendus et gérables ; aucun nouveau signal de toxicité n’est survenu. Les questionnaires de qualité de vie indiquent un retard significatif de la détérioration des scores fonctionnels sous bithérapie.
Profilage génomique nécessaire pour un nouveau standard thérapeutique
Conduit dans 200 centres de 26 pays, TALAPRO‑2 randomise en double‑aveugle un inhibiteur de PARP, le talazoparib, en un antiandrogène de nouvelle génération l’enzalutamide, dans un essai ouvert pour reproduire la pratique. Le design stratifié selon le statut HRR garantit la puissance de l’analyse en sous‑groupe. La durée médiane de suivi supérieure à 52 mois pour l’ensemble des patients permet une maturité des données de survie (>70 % d’événements).
Selon les auteurs, les limites résident dans l’absence de comparaison à d’autres standards combinés (docétaxel ou radioligand), mais la forte magnitude d’effet chez les mutés BRCA2 justifie l’intégration immédiate de cette association dans les recommandations.
Selon le Pr Karim Fizazi, coordinateur de l’essai, urologue à l’Université Paris-Saclay et responsable du comité de cancérologie génito-urinaire à Gustave Roussy : « Les résultats actualisés de TALAPRO-2 démontrent l’importance de réaliser un test moléculaire chez les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistants à la privation androgénique, entre autres afin de déterminer s’ils présentent ou non une altération du gène BRCA2. Si une telle altération est détectée, ils pourront alors être orientés vers un traitement alliant inhibiteur de PARP et hormonothérapie de seconde génération, appelé à devenir le nouveau standard thérapeutique pour ce sous-groupe de patients ».
« Le testing moléculaire peut être réalisé via une biopsie liquide par l’analyse de l’ADN tumoral circulant dans le sang. Il s’agit d’une méthode très fiable et informative, en particulier dans le cancer de la prostate », a-t-il conclu dans un communiqué de presse.
Les recherches futures devront préciser la place de la bithérapie dans les autres sous‑groupes génomiques, explorer les associations triplets (PARP‑i + ARSI + immunothérapie) et mesurer son impact sur la résistance ultérieure aux radiothérapies ciblées au ^177Lu‑PSMA.