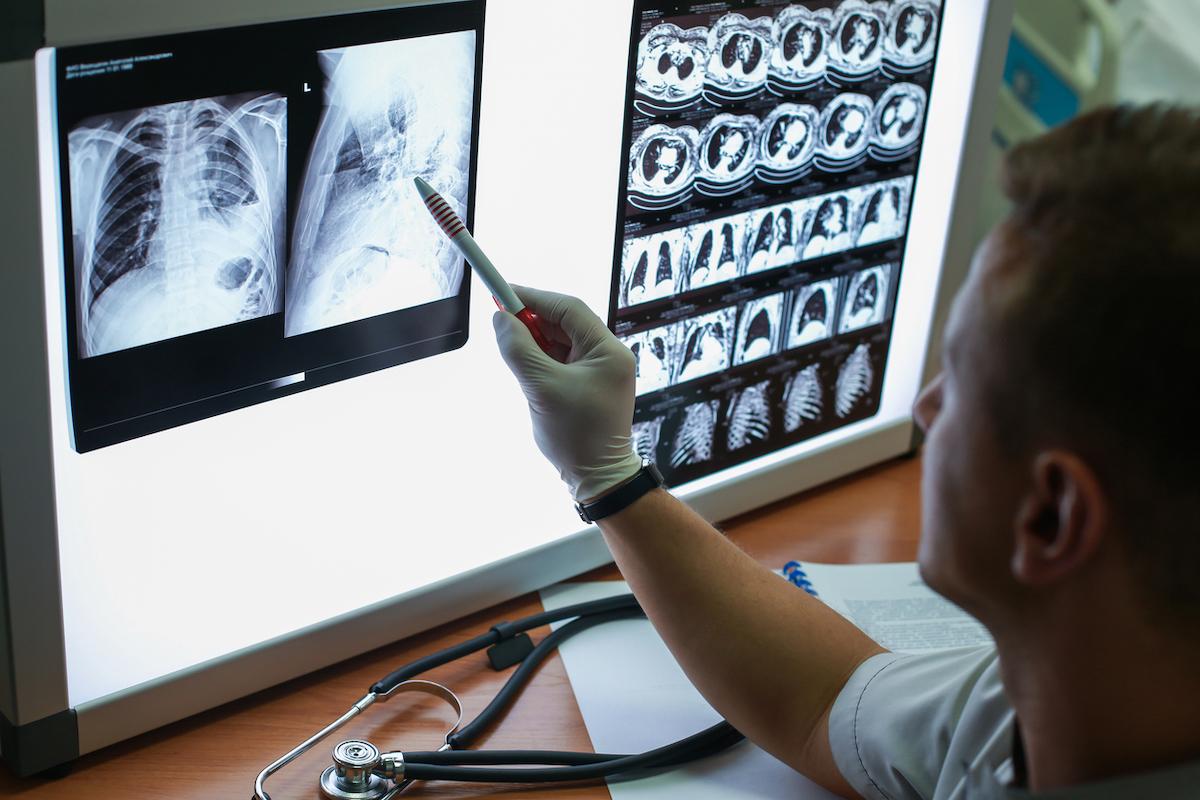Pneumologie
BPCO : vers un diagnostic plus précoce intégrant l’imagerie
L’ajout des anomalies scanographiques et des symptômes respiratoires à la spirométrie reclasse 15% des fumeurs sans obstruction comme BPCO avérée, tandis que 7% des obstructifs asymptomatiques sortent de la définition. Ces patients « BPCO redéfinis » ont une mortalité plus élevée, davantage d’exacerbations et un déclin fonctionnel accéléré, soulignant l’intérêt clinique de cette méthode dans le cadre d’une prise en charge précoce.

- mi-viri/istock
La définition historique de la BPCO est dépendante de l’obstruction bronchique et repose sur un rapport VEMS/CVF < 0,70 post-bronchodilatateur. Or, les analyses en scanner thoracique révèlent des lésions d’emphysème ou d’épaississement bronchique chez près de la moitié des fumeurs encore « non obstructifs » et souvent symptomatiques. Face à ce décalage entre structure et fonction, Bhatt et al. proposent, dans une étude publiée dans le JAMA, une classification multidimensionnelle à même de permettre un diagnostic plus précoce, et pourquoi pas chez les non-fumeurs.
Leur classification est fondée sur un critère majeur (obstruction spirométrique) plus au moins un critère mineur, ou sur au moins 3 critères mineurs en l’absence d’obstruction. Les cinq critères mineurs retenus sont : un emphysème au scanner, un épaississement bronchique au scanner, une dyspnée (mMRC ≥ 2), une mauvaise qualité de vie respiratoire (SGRQ > 25) et une bronchite chronique. L’application de ces critères à la cohorte COPDGene (n = 9416) permet de reclasser 811/5250 fumeurs sans obstruction (15,4 %) qui deviennent BPCO (catégorie mineure) ; inversement, 282/4166 obstructifs (6,8 %) perdent le diagnostic faute de symptômes et de lésions au scanner.
Des nouveaux malades BPCO à haut risque d’exacerbations et de décès
Chez les « nouveaux BPCO », la mortalité totale double (HR 1,98 ; IC à 95 1,67-2,35) et la mortalité respiratoire est multipliée par 3,6 (HR 3,58 ; IC à 95 1,56-8,20) par rapport aux sujets non BPCO. Le taux d’exacerbations augmente de 109 % (IRR 2,09 ; IC à 95 1,79-2,44) et le VEMS décline plus vite (−7,7 mL/an ; p = 0,006).
Dans un autre essai, l’étude CanCOLD (n = 1341), ces résultats sont reproduits à l’identiques : IRR 2,09 d’exacerbations chez les reclassés. À l’inverse, les obstructifs sans lésions ni symptômes écartés du diagnostic ont un pronostic similaire aux non obstructifs, suggérant une physiopathologie ou un seuil fonctionnel distincts.
Aucun signal de surdiagnostic n’est observé avec une spécificité clinique conservée.
Une analyse sur deux cohortes nationales multicentiques
Les auteurs ont exploité deux cohortes longitudinales multicentriques : COPDGene (États-Unis, fumeurs ≥10 PA, suivi médian 12 ans) et CanCOLD (Canada, population mixte fumeurs/non-fumeurs, suivi 8 ans). Les images scanner à l’inclusion ont été analysées centralement par lecture visuelle, rendant le modèle applicable en pratique sans logiciel quantitatif coûteux. Un e des limites est l’exclusion des non-fumeurs dans COPDGene, l’absence de critères scanner quantitatifs standardisés, et une validation externe nécessaire dans les cas d’expositions non tabagiques (biomasse, pollution).
Selon un éditorial associé, cette étude marque un tournant dans la compréhension et la prise en charge de la BPCO. En introduisant un cadre plus large et multicritères, elle dépasse les limites diagnostiques traditionnelles et ouvre la voie à des soins plus personnalisés et inclusifs pour les patients atteints de BPCO. Elle remet non seulement en question les idées reçues, mais redéfinit également le discours clinique autour de la BPCO, encourageant ainsi l'adoption d'un modèle de soins plus proactif et plus dynamique. Plutôt que d'appliquer une norme uniforme, cette approche reconnaît la complexité de la maladie et préconise des stratégies qui reflètent ses manifestations variées au sein de populations diverses, ce qui est bénéfique pour tous.
D’emblée, il semble nécessaire d’intégrer le scanner thoracique et l’évaluation symptomatique systématique chez les fumeurs ou ex-fumeurs pour détecter précocement la maladie et ainsi cibler le plus tôt possible la prévention (sevrage, vaccination, réhabilitation) chez les sujets “pré-obstructifs” mais déjà lésés. Il reste nécessaire de définir des seuils pour le scanner quantitatif et évaluer l’efficacité de stratégies thérapeutiques précoces dans ces phénotypes. Au-delà, il paraît intéressant d’élargir la validation aux populations exposées hors tabac pour une classification vraiment universelle.