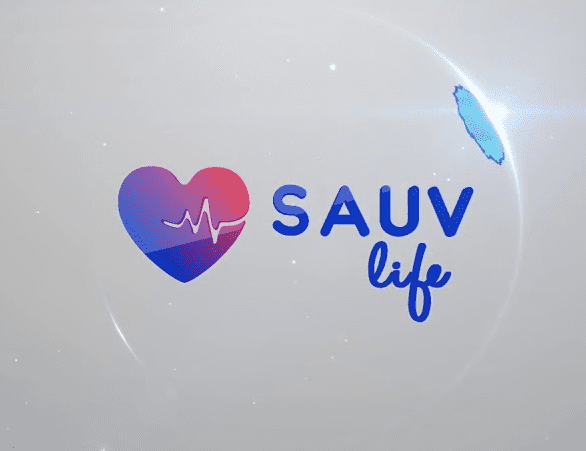Cardiologie
Arrêt cardiorespiratoire : la rapidité plus importante que la qualité de la réanimation
Le plus important en cas de réanimation d’un arrêt cardiaque extrahospitalier, est la rapidité avec laquelle elle est effectuée, plutôt que la personne qui la pratique.

- Mihajlo Maricic/iStock
Chaque retard de 5 minutes dans le retour de la circulation spontanée chez les patients victimes d'un arrêt cardiorespiratoire en dehors de l’hôpital (OHCA, out-of-hospital cardiac arrest), est associé à un risque de décès accru de 38 %.
A partir de cette constatation, des chercheurs italiens ont mis en évidence que même si la proportion de témoins (hors personnel médical) d’un arrêt cardiorespiratoire pratiquant la réanimation cardiorespiratoire (RCP) a augmenté au cours des deux dernières décennies dans la région du Frioul-Vénétie Julienne (une région du nord-est de l'Italie), le facteur déterminant pour la survie et les résultats à long terme est la rapidité avec laquelle la RCP est commencée, et non l'identité de la personne qui la pratique.
La rapidité d'action, gage de survie
Diffusée par l’ESC (European Society of Cardiology), l’étude est fondée sur l’analyse des données de 3315 patients qui ont eu un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI) et ont été admis dans le service de cardiologie de l'hôpital universitaire de Trieste sur une période de 22 ans (2003-2024). Parmi eux, 172 ont présenté un OHCA et 44 ont reçu une RCP de la part d'un témoin pendant toute la période de l'étude.
Dans l'ensemble, un quart des patients (25,6 %) sont morts au cours de la période initiale d'admission à l'hôpital. Par rapport aux survivants, les patients décédés à l'hôpital sont plus âgés (âge moyen : 67 ans contre 62 ans) et avaient davantage de comorbidités. L'analyse statistique révèle que la fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) est moins bonne, que le délai avant la réanimation est plus long et que l'âge plus avancé est un facteur prédictif de la mortalité à l'hôpital, après correction pour le type de sauveteur.
Plus précisément, chaque augmentation de 5 minutes du délai de réanimation et chaque diminution de 5 points de pourcentage de la FEVG sont associées à un risque de mortalité accru de 38 %, tandis que chaque augmentation de 5 ans de l'âge correspond à un risque de décès accru de 46 %. Ensuite, au cours d'un suivi médian de 7 ans, 18 patients (14 %) sont décédés, mais l'analyse des auteurs montre que la mortalité ne diffère pas en fonction du type de sauveteur.
Si ces taux de survie sont plus élevés que ceux généralement observés chez les patients victimes d'un OHCA, les auteurs expliquent que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette situation : les patients inclus dans cette étude ont subi des infarctus de type STEMI pour lesquelles les chances de guérison sont plus élevées (par rapport aux patients victimes d'un OHCA pour d'autres causes cardiaques et extracardiaques). D'autres facteurs pourraient être une proportion plus élevée que la moyenne de témoins formés à la réanimation cardio-pulmonaire, et des systèmes de santé d'urgence performants permettant aux opérateurs d'atteindre les victimes plus rapidement.
Le délai médian de rétablissement de la circulation spontanée (ROSC, Return of Spontaneous Circulation) est de 10 minutes dans l'ensemble, mais plus long pour la réanimation pratiquée par les témoins (20 minutes) que pour celle pratiquée par les personnels médicaux (5 minutes). Les patients ayant bénéficié d'une RCP spontanée ont plus souvent subi une intubation endotrachéale (91 % pour la RCP spontanée contre 65 % pour les patients ayant bénéficié d'une RCP par un service d’urgence).
La rapidité d’action, gage de survie
En divisant la période d’étude en 5 intervalles (2003-2007, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019 et 2020-2024), les auteurs ont observé une augmentation significative de la proportion de patients ayant reçu une RCP à l'initiative d'un témoin au fil des ans. L'analyse statistique a montré que la proportion de patients bénéficiant d'une RCP pratiquée par un témoin est passée de 26 % en 2003-2007 à 69 % en 2020-2024.
Cette étude souligne donc que la rapidité du déclenchement de la RCP, plutôt que la personne qui la pratique, est déterminante pour la survie et l'amélioration des résultats. Et selon les experts, même si il est encourageant de constater que le nombre de sauveteurs a augmenté par rapport aux années précédentes, le fait que 80 % des arrêts cardiaques extrahospitaliers surviennent en milieu publique souligne la nécessité cruciale de poursuivre les mesures d’éducation à la RCP de la population et la formation aux soins de base en réanimation pour améliorer les taux de survie.
Les chercheurs ont précisé également que : « Au fil du temps, la proportion de sauveteurs non professionnels n'a cessé d'augmenter. Le retour rapide de la circulation spontanée était crucial pour la survie à l'hôpital, indépendamment du type de sauveteur. En outre, on a observé une survie à long terme similaire en comparant les patients ayant bénéficié d'une réanimation cardio-pulmonaire initiale par un profane ou par un service médical d'urgence. Nos données soulignent l'importance d'une réanimation immédiate et de la sensibilisation de la population et de la formation BLS pour améliorer encore la survie après un arrêt cardiaque extrahospitalier ».
Sur la base de ces résultats, il semble primordial d'augmenter le nombre de personnes formées aux bonnes techniques de RCP au sein de la population pour améliorer les taux de survie à l'OHCA qui restent relativement alarmants.