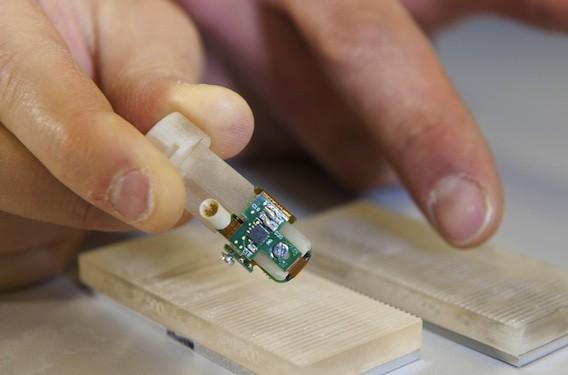Diabétologie
Amputation du membre inférieur : taux d’hospitalisation et mortalité à un an
Différentes études récemment publiées mettent en avant une baisse des amputations liées au diabète. Des données encourageantes mais il reste encore beaucoup à faire.

- Istock/Andrii Zastrozhnov
L’amputation non-traumatique de l’extrémité du membre inférieur (AMI) est une des complications les plus sévères du diabète, et est associée à une mortalité importante. Une équipe de l’université de Hong Kong a étudié la base de donnée regroupant plus de 90 % des patients diabétiques de Hong Kong.
Cette étude retrouve une diminution de 50 à 80% du taux d’hospitalisation pour AMI entre 2001 et 2016. En revanche, le taux de mortalité à un an de l’AMI est inchangé sur cette période de suivi, que ce soit pour des AMI mineures ou majeures.
Diminution du taux d’hospitalisation pour AMI, mais pas de la mortalité
Les AMI sont définies en mineures lorsqu’elles sont réalisées sous la cheville (94% concernent un orteil) et de majeures lorsqu’elles sont réalisées à la cheville ou au-dessus. Les AMI majeures représentent 54 et 66% de toutes les AMI chez les hommes et les femmes respectivement. Comparés aux femmes, les hommes ont un risque augmenté de 2,3 fois (IC 95 % 2,1 – 2,4) d’avoir une AMI mineure, et de 1,6 fois (IC 95 % 1,5 – 1,6) d’avoir une AMI majeure.
En 2016, les taux d’amputations mineures et majeures sont respectivement de 8,6 et 7,2 pour 10.000 hommes, et de 3,3 et 4,7 pour 10.000 femmes. Entre 2001 et 2016, le taux d’hospitalisation pour AMI mineure a diminué de 3,8 % par an (soit 49 % en 15 ans) chez les hommes, et de 6,3 % par an chez les femmes (soit 60% en 15 ans). Concernant les AMI majeures, ces diminutions annuelles sont de 8,0% (78 % en 15 ans) chez les hommes et de 10,4 % (79 % en 15 ans) chez les femmes.
Sur l’ensemble de la période de suivi, la mortalité à un an de la chirurgie après une AMI mineure et majeure est de 19 et 42 % chez les hommes, et de 21 et 42 % chez les femmes. Contrairement au taux d’hospitalisation, cette mortalité à un an ne diminue pas entre 2001 et 2016.
De l’intérêt d’un registre à grande échelle
La force de cette étude repose en partie sur le registre mise en place à Hong Kong au début des années 2000, regroupant plus de 90 % des hôpitaux et cliniques de la région. Fin 2016, plus de 390.000 hommes et 380.000 femmes diabétiques ont été inclus dans ce registre hongkongais, avec entre 2001 et 2016 6.113 et 4.149 hospitalisations pour AMI chez les hommes et les femmes respectivement.
Ces personnes avaient en moyenne 65 ans, et une HbA1c moyenne vers 8,4% chez les hommes et 8,0% chez les femmes. Le LDL-cholestérol stagnait entre 0,8 et 1,0 g/L en 2016, malgré un objectif inférieur à 0,7 g/L chez ces patients.
Des efforts à poursuivre
Ces diminutions importantes du taux d’AMI sont très encourageantes, et peuvent être la conséquence d’une amélioration de la prise en charge du diabète, des risques cardiovasculaires, et de l’éducation du patient. De manière intéressante, des résultats similaires sont rapportés par Amadou et al. en France, à partir de l’étude de données de l’Assurance Maladie : le taux d’AMI a diminué de 3,0 à 2,6 pour 10.000 individus diabétiques ; en revanche, la mortalité à un an a stagné, voire augmenté, de 22 à 26 %, avec un âge moyen de 77 ans qui est plus important que dans la population hongkongaise.
Les efforts réalisés sont donc à poursuivre pour améliorer la mortalité après une AMI, incluant une prise en charge plus précoce des plaies du membre inférieur, un meilleur contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaire et un personnalisation de la prise en charge chirurgicale selon le contexte local et général.