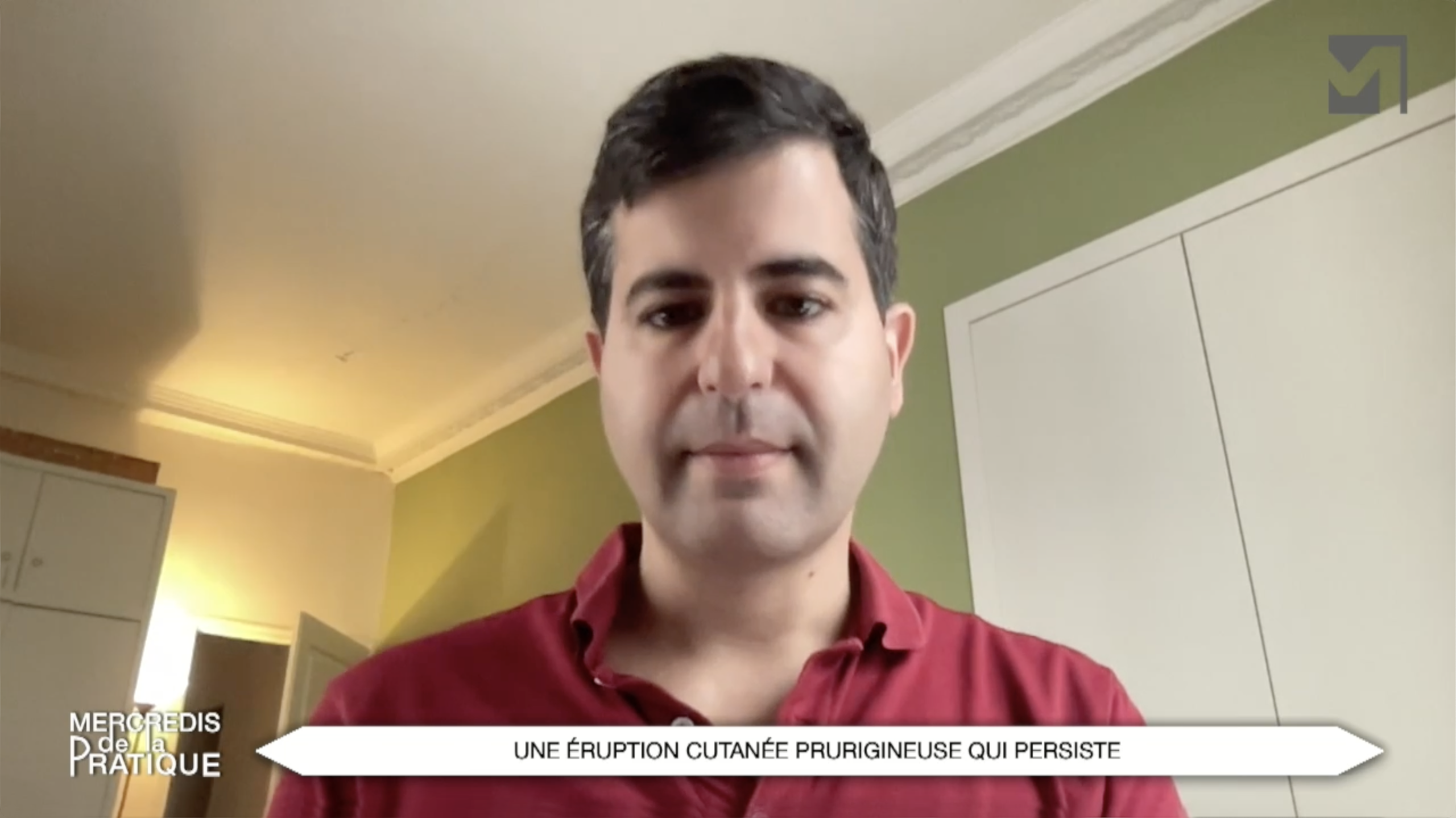Pneumologie
SAS : une approche de pronostic par "clustérisation"
Classer les patients en sous-groupes cliniques et biologiques homogènes permet d’établir un pronostic et surtout d’adapter un parcours de soins. D’après un entretien avec Jean-Louis Pépin.

- DC01/epictura
Une étude, menée en Catalogne, publiée dans Plos One, sur 70 000 patients atteints d’apnée du sommeil a cherché à caractériser les différentes populations souffrant d’apnée du sommeil et les classer en clusters. Cette technique est déjà appliquée dans l’asthme, la BPCO et d’autres maladies chroniques et vise à faire de la médecine personnalisée. L’originalité de cette étude par rapport à celles déjà publiées sur le même sujet, est de montrer que le pronostic du SAS est différent selon les clusters, mais surtout que la consommation de soins est différente.
Les patients sont répartis en sous-groupes homogènes, en clusters, en fonction de leurs atteintes métaboliques, de leur âge et de leurs comorbidités, en particulier cardiovasculaires. 5 groupes ont ainsi été définis dans cette étude, allant de celui qui comprend des patients relativement jeunes ayant peu de comorbidités et de symptômes, à celui de patients plus âgés avec comorbidités en particulier cardiovasculaires, en passant par les métaboliques. Le Cluster 5, par exemple est un des plus importants avec ses 25 000 patients, jeunes, ronfleurs, sans maladies associées. Chez ces patients, il faut instaurer un suivi assez simple : ils vont bien répondre à un traitement par ortèse ou PPC et n’ont pas besoin d’être revus tous les 3 ou 6 mois.
Le cluster permet de définir le parcours de soins idéal pour un patient donné
Par contre les patients présentant une insuffisance cardiaque avec apnées, ou ceux ayant des comorbidités ont besoin d’être revus fréquemment avec éventuellement une mise en place de soins plus complexes, comme ceux à domicile. Et le coût de cette prise en charge est forcément différent. Si cette étude semble malgré tout enfoncer un peu des portes ouvertes selon Jean-Louis Pépin, responsable de la clinique du sommeil physiologique au CHU de Grenoble et directeur d’une unité INSERM sur l‘apnée du sommeil, il est évident aujourd’hui que l’on ne peut plus se contenter d’une simple assistance ventilatoire par orthèse ou PPC.
En fait cette étude a l’intérêt d’exercer une sorte de sensibilisation : l’apnée du sommeil ne se contente pas toujours d’une simple assistance ventilatoire par orthèse ou PPC; l’activité physique, l’accompagnement, la gestion des facteurs de risque et le suivi personnalisé doivent être absolument associés. JL Pépin pense aussi que les remboursements ne pourront plus perdurer si des soins intégrés ne sont pas proposés au cours de certaines formes cliniques de SAS.
Un des reproches que l’on peut faire à cet article est de ne pas donner le code de sévérité des apnées, des données retrouvées dans d’autres études de cluster.
En conclusion, il est temps de passer à la médecine personnalisée dans la prise en charge de l’apnée du sommeil, de la même manière que cela a été fait pour d’autres maladies respiratoires. De nouvelles études sur le même sujet sont à venir et conforteront sans doute cette évolution.