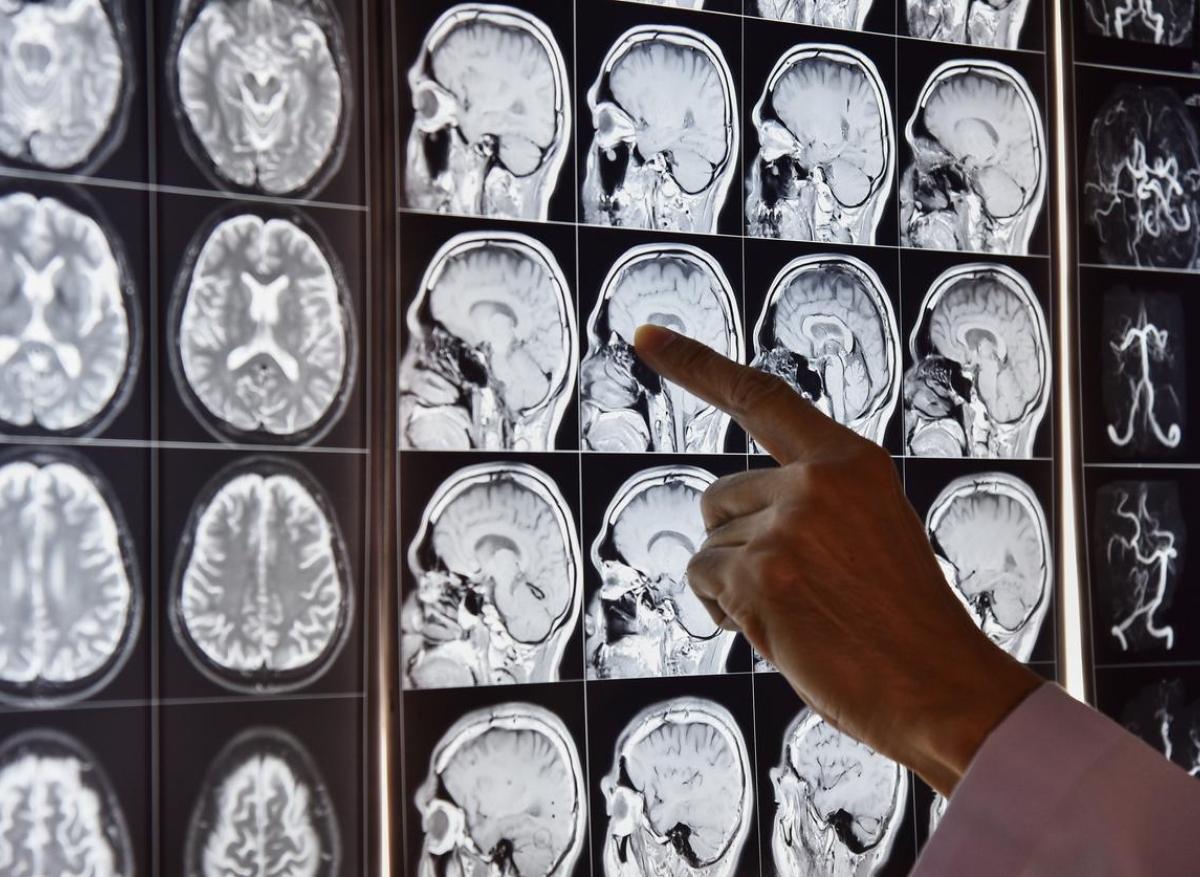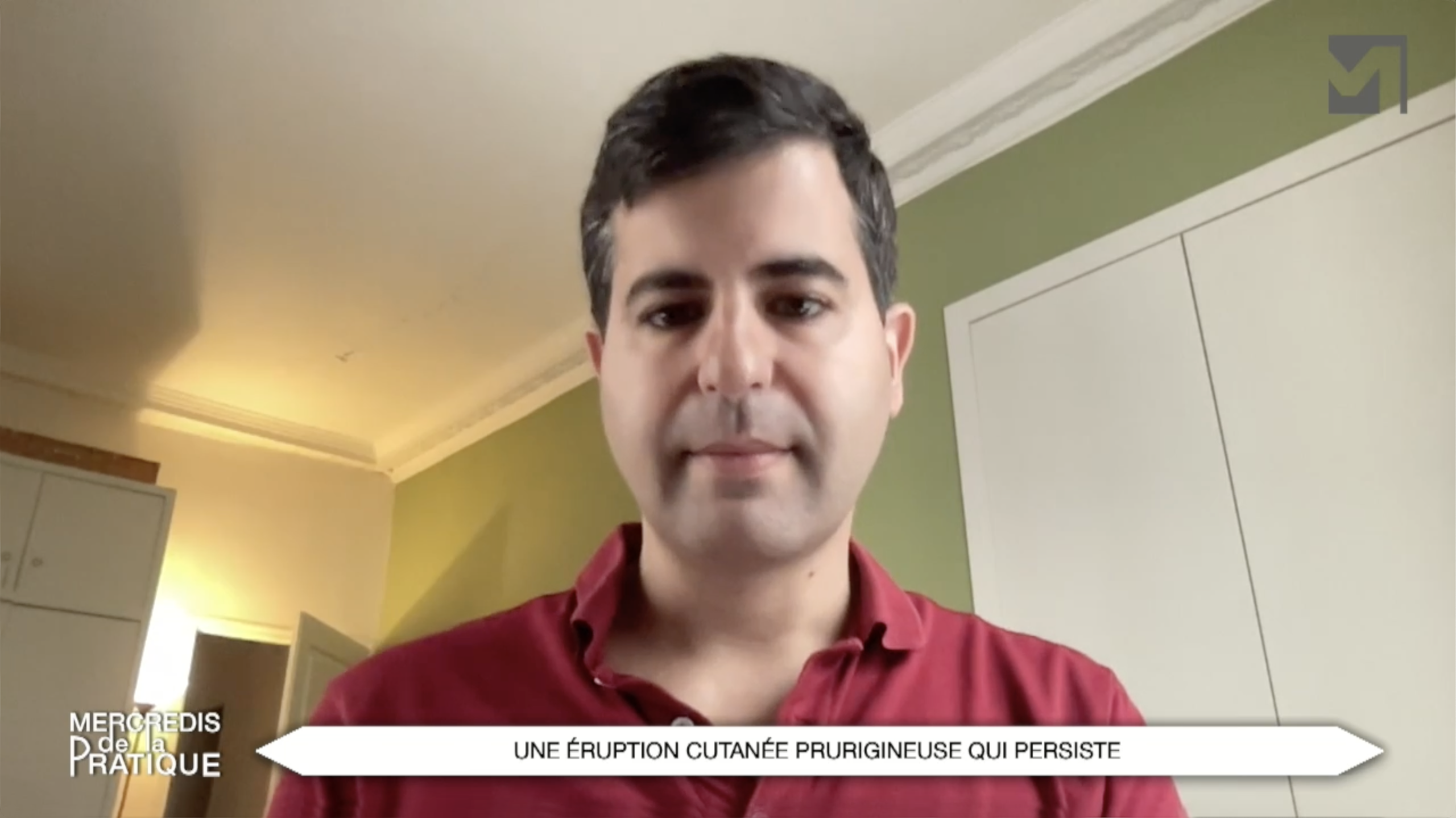Oto-rhino-laryngologie
Perte d'odorat post-traumatique : la piste thérapeutique du PRP
Chez les patients souffrant d’une anosmie post-traumatique, l’injection de plasma riche en plaquettes (PRP) dans les fentes olfactives améliorerait significativement la récupération olfactive. Cette approche, jusque-là réservée aux pertes olfactives post-virales, ouvre une perspective thérapeutique inédite dans une population pour laquelle les options sont limitées.

- Dima Berlin/istock
Les dysfonctionnements olfactifs post-traumatiques restent un défi clinique majeur. Contrairement aux pertes post-virales, qui peuvent bénéficier de la rééducation olfactive, les traumatismes crâniens entraînent souvent des lésions irréversibles des fibres nerveuses. À ce jour, aucun traitement spécifique n’a démontré d’efficacité dans cette indication. Le plasma riche en plaquettes (PRP) et de ce fait riche en facteurs de croissance. Il favoriserait la régénération cellulaire et a récemment été proposé comme traitement prometteur dans les anosmies post-virales, notamment post-Covid-19.
L’objectif de cette étude préliminaire, parue dans Otolaryngology–Head and Neck Surgery Journal, était d’évaluer, pour la première fois, l’efficacité des injections de PRP chez des patients souffrant d’une anosmie post-traumatique persistante. Trente-trois patients ont été inclus (durée moyenne du trouble : 55,6 mois), et comparés à des patients suivant une rééducation olfactive. Trois mois après injection, 66,7 % des patients ayant reçu des injections de PRP rapportent une amélioration subjective de leur odorat. Le score TDI (seuil, discrimination, identification) augmente significativement, passant de 8,4 à 16,5 (p = 0,003), avec une différence statistiquement significative par rapport au groupe contrôle (16,5 vs 13,3 ; p = 0,038).
Un bénéfice clinique au-delà de la subjectivité
Outre l’amélioration ressentie par les deux tiers des patients injectés, l’étude montre une progression objective du score TDI atteignant le seuil de pertinence clinique uniquement dans le groupe PRP. En comparaison, les patients du groupe rééducation olfactive n’ont qu’une amélioration partielle. Le délai moyen avant perception des premières odeurs retrouvées est plus long en post-traumatique qu’en post-viral (5,4 semaines vs 3,4), reflétant probablement une atteinte axonale plus étendue. Cette différence de latence et de taux de réponse pourrait s’expliquer par une régénération neuronale plus complexe dans les atteintes mécaniques.
Les auteurs soulignent également une incidence plus élevée de l’anosmie totale chez les patients post-traumatiques, limitant d’autant plus les chances de récupération spontanée. L’absence d’effets indésirables notables renforce le bon profil de tolérance des injections de PRP dans cette localisation, même plusieurs années après le traumatisme initial.
Une étude pilote, mais porteuse de changements en pratique
L’étude a été menée de façon prospective et contrôlée dans un centre universitaire belge, incluant uniquement des patients avec anosmie post-traumatique confirmée, comparés à un groupe contrôle principalement post-viral. Si ce choix peut introduire un biais, il n’a probablement pas surestimé les effets des injections de PRP, dans la mesure où les anosmies post-traumatiques sont généralement plus sévères et de plus mauvais pronostic. Le petit effectif et l’absence de suivi à long terme constituent les limites majeures. Néanmoins, les résultats suggèrent que même après plusieurs années d’évolution, une stimulation locale par injection de PRP pourrait relancer les mécanismes de récupération olfactive.
Selon les auteurs, cette étude ouvre la voie à une nouvelle indication pour les injections de PRP, qui pourrait trouver leur place en complément ou en alternative à la rééducation dans les anosmies post-traumatiques. Des essais randomisés, avec groupes post-traumatiques appariés et évaluations neurophysiologiques, seront nécessaires pour confirmer l’efficacité et affiner les protocoles. Pour les praticiens, l’enjeu est majeur : proposer enfin une option thérapeutique à des patients durablement handicapés dans leur sécurité, leur alimentation et leur qualité de vie.