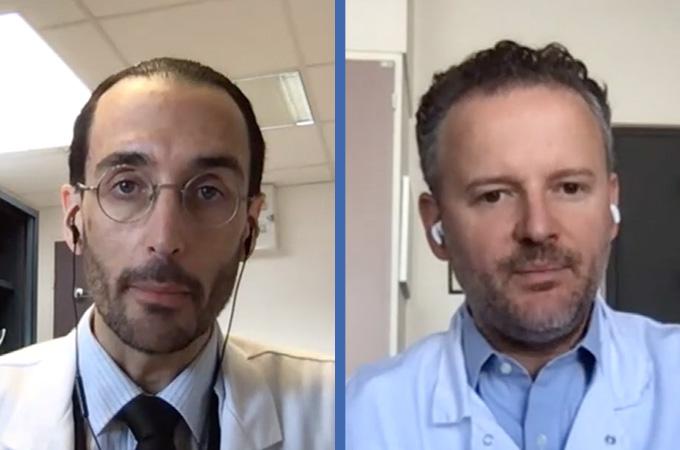Onco-sein
Cancer du sein : nouvelle pondération des risques associés aux mutations
Il existe une relation statistiquement significative entre le développement de cancer du sein et la présence de mutations troncatives sur plusieurs gènes : ATM, BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2, BARD1, RAD51C, RAD51d et TP53.

- monkeybusinessimages/iStock
Actuellement les données concernant la génétique des cancers du sein reposent sur le dépistage des patientes ayant une histoire familiale particulière ou une présentation spécifique, et s’intéressent à un panel de gènes limités, faute de données précises.
Pour autant, avec l’avènement des techniques de séquençages, la disponibilité et le moindre cout, le séquençage génomique en globalité tend à se développer, posant la problématique de l’interprétation des données.
Une étude Cas-Témoin de plus de 113 000 patientes.
L’étude cas-Témoin de Dorling et al, récemment publiée dans le NEJM, et testant un panel de 34 gènes sélectionnés sur leur potentielle implication dans la genèse tumorale des cancers du sein, met en évidence une relation statistiquement significative entre la survenue d’un cancer du sein et la présence de mutation troncative pour 9 gènes testés : ATM, BRCA1, BRCA2, CHECK2, PALB2, BARD1, RAD51C, RAD51d et TP53.
En pratique, 60466 patientes ayant été prises en charge pour un cancer du sein (54624 pour une tumeur invasive, 4187 pour un cancer in situ et 1655 sans précision) ont été sélectionnées et associées à 53461 femmes « contrôles ». Un panel de 34 gènes a été testé en séparant les mutations troncatives ou non-sens dont les conséquences sont bien connues, des mutations faux sens aux conséquences génétiques moins prévisibles.
5 gènes fortement impliqués.
Les résultats de l’étude retrouvent une corrélation fortement statistiquement significative entre la survenue d’un cancer du sein et la présence de mutations troncatives pour 5 gènes (p<0.0001) : ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2 et PALB2. Dans une moindre mesure mais toujours statistiquement significative (p<0.05), cette relation est retrouvée pour les gènes BARD1, RAD51C, RAD51D et TP53.
Des analyses additionnelles ont retrouvé une corrélation avec le statut hormonal : la présence des mutations des gènes ATM et Chek2 seraient plus importantes chez les patientes qui ont un cancer du sein RH+, contrairement aux mutations des gènes BARD1, BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C et RAD51D prédominant chez les tumeurs RH-, et notamment BARD1, et BRCA1 et BRCA2 pour les triples négatives.
Implication des mutations faux-sens.
L’étude retrouve une corrélation statistiquement significative entre le risque de développement d’un cancer du sein et la présence de mutation faux-sens pour 5 gènes : ATM, CHEK2, TP53, BRCA1 et BRCA2 (p<0.0001).
Les mutations faux-sens du gène CHEK2 semblent être prédominantes pour les tumeurs RH+, contrairement à BRCA1 majoritaires chez les tumeurs RH-.
Quelle implication clinique ?
Cette étude permet de définir les gènes semblant directement impliqués dans la survenue des cancers du sein, dans l’objectif de guider la prise en charge des patientes concernées, mais également dans l’idéal de prévenir et dépister. Pour autant, quelles vont être l’implication clinique à grande échelle et les conséquences thérapeutiques et préventives résultantes ? Il reste encore beaucoup de données obscures et notamment le relationnel avec d’autres spectres de tumeurs.
"Cela impose un véritable changement de paradigme, analyse le Professeur Gilles Freyer, cancérologue aux Hospices Civils de Lyon dans un interview récent sur Fréquence Médicale, car s'il était facile d'expliquer à une femme porteuse de mutations de BRCA 1 et 2 ou de PAL-B2 l'intérêt d'une chirurgie prophylactique en raison du niveau de risque très élevé de développer un cancer du sein ou de l'ovaire, on peut se poser la question de savoir s'il est raisonnable de faire ce choix, étant donné son impact sur le parcours de vie, pour des femmes porteuses de mutations sur les autres gènes identifiés : si ceux-ci augmentent réellement la susceptibilité de développer la maladie par rapport aux autres femmes, nous sommes là face à un risque qui est certes significatif mais qui n'est pas si élevé que cela ...".


-1613907708.jpg)