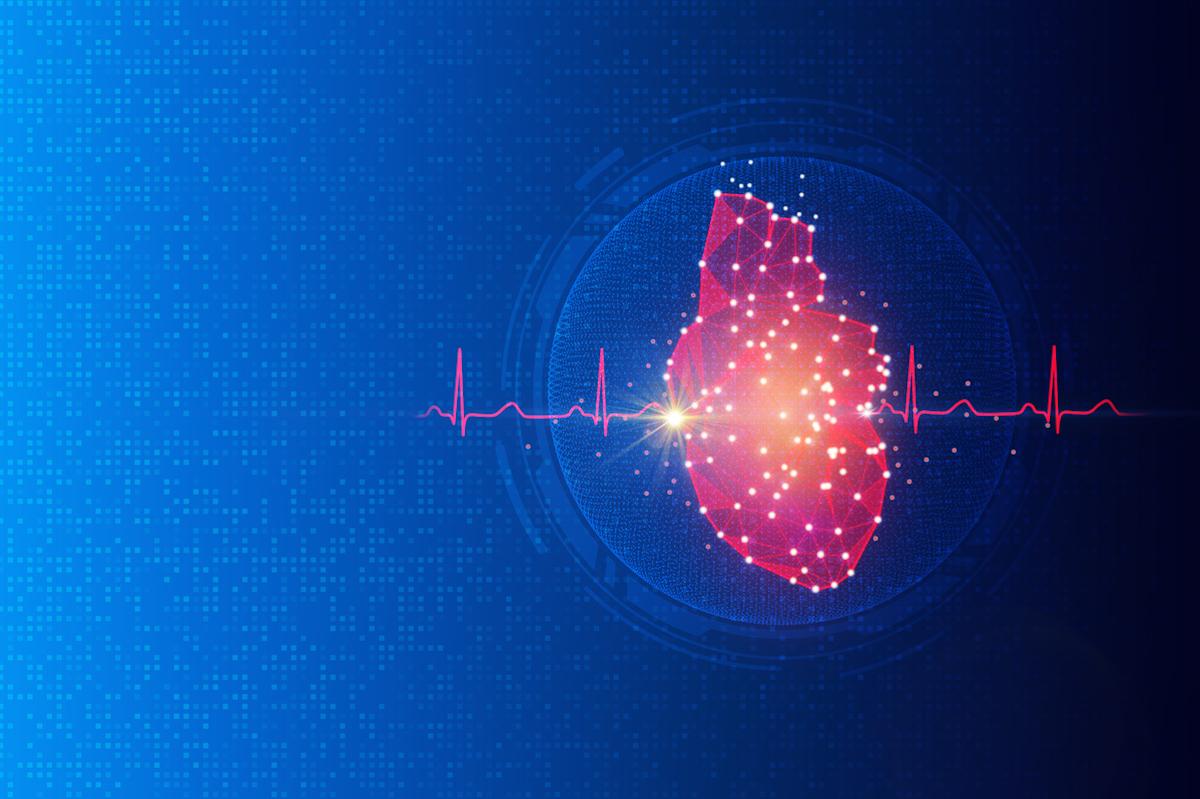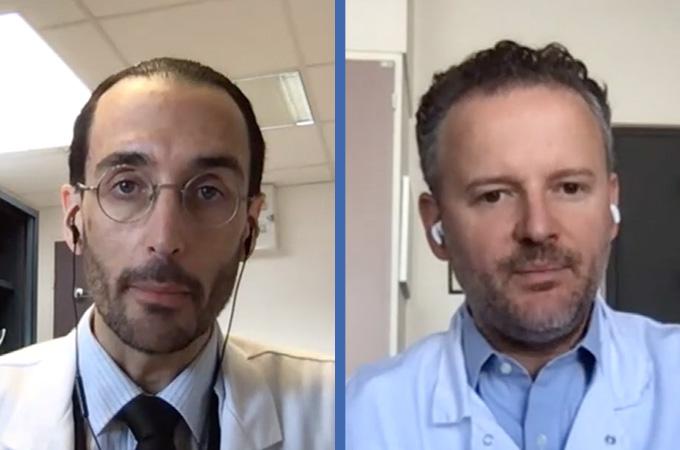Cardiologie
Fibrillation atriale : quelle anticoagulation après une ablation réussie ?
Après une ablation réussie pour une fibrillation atriale chez des patients à risque thromboembolique modéré, il n’existerait pas de supériorité d’un traitement anticoagulant direct sur l’aspirine pour prévenir les AVC à 3 ans. Les événements ischémiques sont restés rares (<1 %/an), au prix d’un surcroît attendu de saignements non majeurs sous anticoagulant, appelant à une décision individualisée sur la durée de l’anticoagulation.
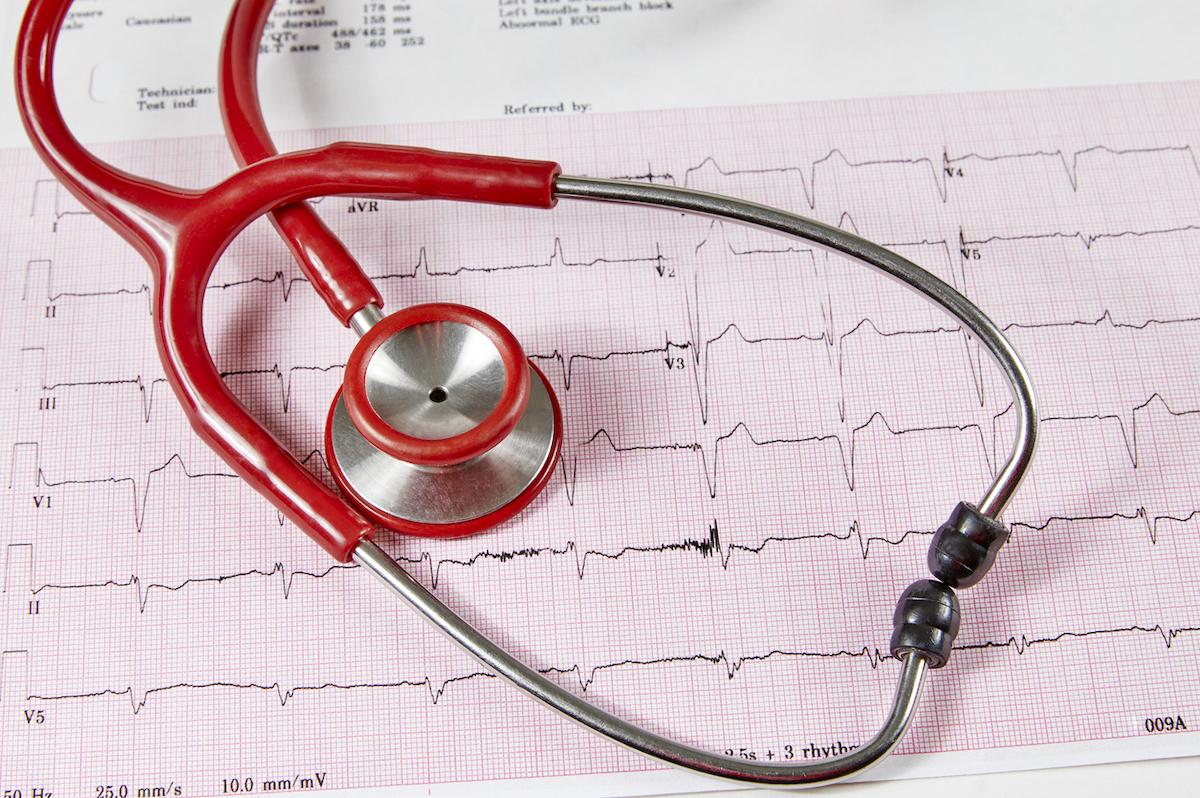
- wingedwolf/istock
L’ablation par cathéter réduit le fardeau de la fibrillation atriale (FA), mais les recommandations maintiennent l’anticoagulation au long cours selon le score CHA₂DS₂-VASc, indépendamment du succès procédural. Dans un essai international, ouvert avec évaluation des critères en aveugle, 1 284 patients en rémission au moins un an après ablation et à risque thromboembolique (CHA₂DS₂-VASc ≥ 1, seuil ≥ 2 chez les femmes ou si la composante « vasculaire » était isolée), ont été randomisés entre aspirine quotidienne (70–120 mg) ou rivaroxaban 15 mg, avec IRM cérébrale à l’inclusion et à 3 ans.
Selon les résultats, présentés au congrès 2025 de l’American Heart Association et publiés dans le New England Journal of Medicine, le critère principal combinant AVC, embolie systémique ou nouvel infarctus cérébral occulte ≥ 15 mm n’est pas réduit significativement par le rivaroxaban : 0,31 vs 0,66 événements/100 patient-années ; RR 0,56 (IC à 95 % 0,19–1,65), différence absolue à 3 ans −0,6 pt (IC à 95 % −1,8 à 0,5 ; p=0,28). Ainsi, dans cette population sélectionnée et stable après ablation, le bénéfice d’un anticoagulant direct sur ce critère composite n’est pas démontré.
Un risque résiduel faible
Les infarctus de moins de 15 mm nouvellement détectés à 3 ans sont survenus chez 3,9 % sous rivaroxaban (22/568) et 4,4 % sous aspirine (26/590) ; RR 0,89 (IC à 95 % 0,51–1,55). Au total, 96 % des participants n’ont eu aucun nouvel infarctus à l’IRM sur 3 ans, confirmant un risque ischémique très faible après une ablation réussie. La tolérance objective un taux de saignement fatal/majeur de 1,6 % sous rivaroxaban versus 0,6 % sous aspirine à 3 ans (HR 2,51 ; IC à 95 % 0,79–7,95), avec davantage de saignements mineurs ou cliniquement pertinents non majeurs sous anticoagulant.
Les comparaisons externes suggèrent des profils concordants : ALONE-AF rapportait ≈0,4 %/an d’AVC après ablation avec anticoagulation prolongée ; l’essai OPTION montrait la non-infériorité de l’occlusion de l’auricule gauche (avec arrêt d’anticoagulant) versus anticoagulation continue, avec ≈0,6 %/an d’événements. Dans l’essai actuel, les taux observés (≈0,3–0,7/100 patient-années) se situent nettement sous le seuil classiquement retenu pour justifier l’anticoagulation systématique.
Vers une décision partagée
Le protocole était pragmatique : essai ouvert et évaluation en aveugle, avec un suivi de 3 ans, IRM systématique, sans monitorage prolongé imposé des récidives asymptomatiques de FA. La population, majoritairement à risque modéré, avec peu d’antécédents d’AVC et une cardiopathie structurelle limitée, pourrait sous-représenter les patients à très haut risque. L’absence de bras placebo et la dose de 15 mg (choix réglementaires) n’altèrent vraisemblablement pas la conclusion compte tenu de la très faible incidence des événements. En extrapolation, les résultats sont robustes pour des patients stabilisés au moins 1 an après ablation, score CHA₂DS₂-VASc bas-intermédiaire, sans récidive clinique documentée ; ils ne s’appliquent pas directement aux profils à CHA₂DS₂-VASc élevé, antécédent d’AVC, ou aux récidives fréquentes.
Selon les auteurs, continuer « par défaut » un anticoagulant après une ablation réussie peut exposer à des saignements non majeurs sans bénéfice ischémique prouvé dans ces profils ; une stratégie fondée sur le score de risque, le contrôle rythmique, l’IRM de référence et la préférence du patient est justifiée. La surveillance rythmique ciblée, et, chez certains, l’alternative d’occlusion de l’auricule gauche, s’intègrent dans une décision partagée. Des essais plus vastes (puissance > 11 000 patients estimée pour détecter une réduction relative de 40 %), incluant des patients à risque plus élevé et un monitorage prolongé, permettraient de préciser le point d’inflexion où l’anticoagulation au long cours, après ablation réussie, redevient réellement bénéfique.