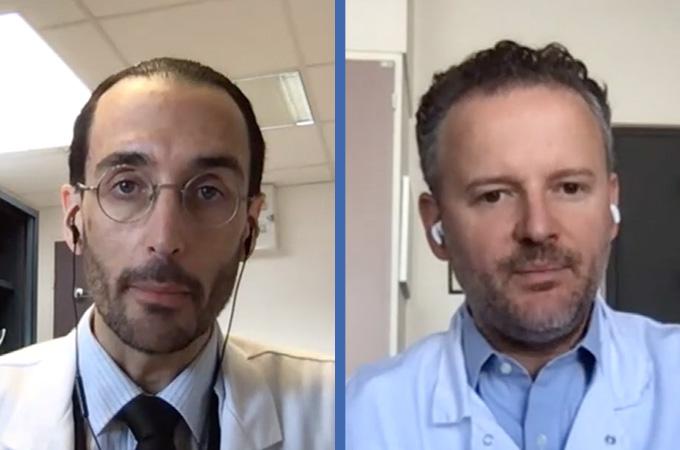Pneumologie
Médecine et IA : ce n’est plus de la science-fiction mais attention aux cyberattaques !
De l'amélioration de l'interprétation des examens à l'identification de nouvelles molécules thérapeutiques, l'intelligence artificielle montre son intérêt mais avec quel contrôle? D’après un entretien avec Anh-Tuan DINH XUAN.

Une étude dont les résultats sont parus en juin 2025 dans Thorax a cherché à tester l’évaluation de la fonction pulmonaire alimentée par l'IA pour le diagnostic de la maladie pulmonaire interstitielle. Lors de la phase 1 de l’étude, une cohorte de 60 patients, dont 30 atteints de pneumopathie interstitielle fibrosante , a été évaluée rétrospectivement par 25 pneumologues. Chaque cas a été analysé à partir d’une EFR, incluant une pléthysmographie et une mesure de la capacité de diffusion, ainsi qu’un historique médical. Les pneumologues ont examiné les cas à deux reprises : une première fois sans assistance, puis avec l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle. Pour chaque patient, ils ont formulé un diagnostic principal ainsi que jusqu’à trois diagnostics différentiels. Dans la phase 2, 19 pneumologues ont répété le protocole après avoir utilisé le logiciel pendant une période de 4 à 6 mois.
Un peu d’histoire de l’IA
Le professeur Anh-Tuan DINH XUAN, physiologiste respiratoire, chef du service de Physiologie-Explorations fonctionnelles de l’hôpital Cochin, à Paris, qui vient de réaliser une présentation sur l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam, explique qu’il est important de reprendre l’histoire de l’IA et ses différentes formes. Il rappelle que l’année 2024 est une année importante puisque deux prix Nobel ont été attribués à des développeurs de l’IA : en physique, à John J HOPFIELD et Geoffrey E HILTON, et en chimie à David BAKER, Demis HASSABIS et John JUMPER. La chimie aide à mieux comprendre l’IA générative, qui permet la découverte de nouveaux médicaments. Anh-Tuan DINH XUAN précise en effet que l’IA est un outil d’aide au radiodiagnostic, permet la découverte de nouveaux médicaments, permet l’identification des risques des patients, la détection précoce des maladies et aide à la gestion hospitalière. Il rappelle le début de l’IA avec le Turing test, élaboré par Alain Turing, mathématicien britannique, qui, dans les années 1950 a programmé un ordinateur pour répondre à des questions, en compétition avec un être humain, avec un arbitre. Le terme d’IA nait en 1956, lorsque l’on n’a plus réussi à faire la distinction entre les réponse humaines et celles de l’ordinateur. L’IA a ensuite évolué en trois étapes : l’IA1.0, dans les années 1950, qui utilise des méthodes de calculs statistiques, l’IA2.0, en 2011, qui utilise les réseaux neuronaux et enfin l’IA3.0, générative, depuis 2018. L’IA est partagée entre le deep-learning (ou apprentissage profond) et l’IA générative, qui est une sous-spécialité du deep-learning. Cette dernière permet de de générer du contenu nouveau à partir d’informations. Elle peut générer un texte, une musique, un dessin et également réaliser un diagnostic à partir d’images radiologiques incomplètes ou reconstruites . Le deep-learning utilise les réseaux neuronaux. L’apprentissage automatique permet à l’ordinateur d’avoir une mémoire (programmation) et le deep-learning lui apporte la possibilité d’apprendre des éléments nouveaux. L’apprentissage en deep-learning se fait suite à des échecs, par pondérations dans les connexions neuronales avec renforcement par un succès et relâchement suite à un échec.
Quid de la synthèse des protéines par l’IA
Anh-Tuan DINH-XUAN explique que les neurobiologistes et les spécialistes des sciences sociales ont mis en place l’apprentissage profond, à l’image d’un puzzle. Plusieurs solutions sont essayées, sans idée préconçue au départ, ce qui enrichit le panel des connaissances. Ainsi, les lauréats des prix Nobel de chimie et de physique ont utilisé le deep-learning pour trouver les structures tridimensionnelles des protéines, puisque les replis déterminent la fonction de la protéine. A titre d’exemple, pour une protéine comportant 500 acides aminés, il aurait fallu une éternité pour que toutes les combinaisons possibles de cette protéine soit essayées. Pour synthétiser une protéine, la modélisation qui sert à trouver la bonne conformation prend beaucoup de temps. Le deep-learning met quelques secondes. Les cytokines et l’IA utilisent plusieurs voies biologiques possibles, testées sur des cellules ou sur des modèles animaux pour réaliser l’identification des cibles moléculaires, ce qui permet de fabriquer une protéine dont la structure 3D s’adapterait parfaitement à ces cibles. Anh Tuan DINH XUAN précise qu’il y a également possibilité de monter des protocoles pré-cliniques et cliniques, qui permettraient de raccourcir la durée des essais cliniques. Il cite comme exemple le thalidomide, qui a à la fois un effet thérapeutique et un effet malformatif. L’IA pourrait permettre d’éviter ces écueils.
Lecture des EFR par L’IA
Anh-Tuan DINH-XUAN explique que dans l’étude de Gompelmann, l’IA est utilisée à des fins diagnostiques à partir des EFR. Ce travail fait suite à une étude parue dans l’European Respiratory Journal, réalisée à l’hôpital Cochin. Une soixantaine d’EFR ont été données à interpréter par des médecins, disposant de quelques informations clinique, ains qu’à l’IA. Même si l’efficacité de l’IA n’était pas de 100%, elle a fait mieux que les médecins. Il est ensuite proposé aux experts de consulter les propositions de l’IA. Ils avaient 3 choix : changer de diagnostic pour utiliser celui de l’IA, maintenir leur diagnostic ou établir un autre diagnostic en tenant compte de la proposition de l’IA. Le pneumologue peut donc proposer à l’IA des éléments nouveaux, issus du « sixième sens » humain, dont ne dispose pas l’IA, qui en réalité rappelle des éléments connus de l’humain mais oubliés.
De belles promesses mais des inquiétudes
Anh-Tuan DINH XUAN explique que nous en sommes encore au début du développement de l’IA, qui apporte de nombreuses et belles promesses, mais qui peut également provoquer une certaine inquiétude. Il explique que lorsque deux entités sont face à face et que l’une est plus performante que l’autre, on n’a jamais vu l’entité la plus performante se soumettre à l’autre, le seul contre-exemple étant la mère face à son enfant. Si des protéines thérapeutiques sont capables d’être fabriquées par l’IA, des virus ou des éléments délétères peuvent également être créés, si les programmes tombent entre de mauvaises mains. Ceci n’est plus de l’ordre de la science-fiction.
En conclusion, la médecine a beaucoup à gagner avec l’IA mais il est absolument nécessaire de fabriquer des super-héros, armés de boucliers pour lutter contre les déviances si elle vient à être utilisée par les mauvaise personnes. Qui peut le plus peut le moins…