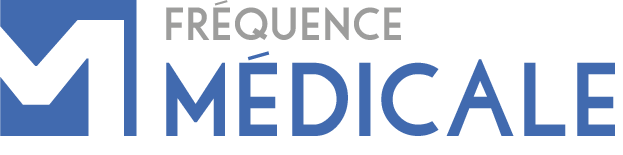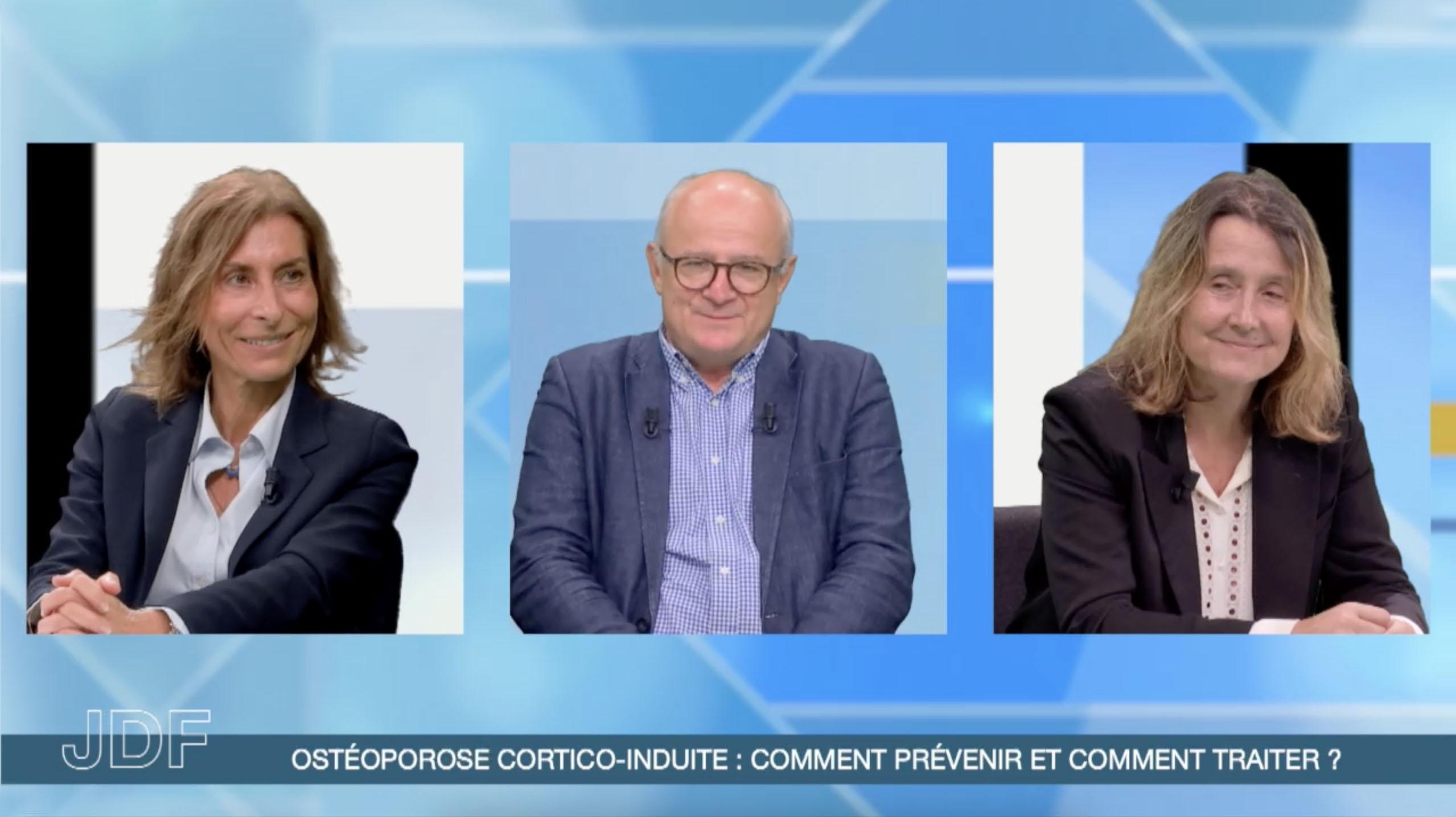Elections et débat national
Santé et Présidentielle : l’université mise sur l’homme face aux nouveaux métiers
La campagne présidentielle a commencé et, après la crise de l’hôpital et la pandémie Covid-19, nous avons interrogé les candidats et des représentants de la société civile sur leurs propositions de réforme de la Santé. Aujourd’hui, l’interview du Pr Jean Sibilia, Doyen à l’université de Strasbourg.

- sefa ozel/istock
Le Pr Jean Sibilia est rhumatologue aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS). Il y est doyen de la Faculté de Médecine, Maïeutique et Sciences de la santé et est président de la Conférence nationale des doyens. Il est également chercheur, impliqué dans de nombreuses structures de recherche et il est vice-président de la Politique hospitalo-universitaire et territoriale en santé de l’Université de Strasbourg.
On a vécu plusieurs années difficiles et de nombreuses crises. Quelle analyse fait l'université sur ces crises, et en particulier celle de la Covid-19, dans la perspective de la nécessaire réforme de la santé ?
La crise a révélé un système en difficulté et tout le monde fait le même diagnostic. Aujourd'hui, le système est en souffrance, ce n'est pas que le système hospitalier, c'est l'ensemble du système de santé et, au-delà, la crise a aussi révélé les faiblesses du système de formation et de recherche. Mais il y a eu des points positifs. Je prends comme exemple la formation des étudiants : personne n’imaginait pouvoir utiliser aussi vite les outils numériques pour l’enseignement alors qu’on a pu accélérer le développement des outils digitaux de formation. Et il y a eu d’autres initiatives formidables : la réserve sanitaire étudiante en particulier, avec des étudiants sur le terrain. Ainsi, il y a eu des expériences pédagogiques, un peu à l'image du service sanitaire, qui ont été des très belles réussites, mais on a aussi pu apprécier le degré d'impréparation en termes de pédagogie en période de crise. C'est mon premier point.
Le deuxième point de notre analyse, c'est notre classement dans le mouvement de la recherche sur la Covid-19. Il y a eu quelques pépites, très clairement, avec quelques très beaux travaux français. Mais quand on prend l'ensemble, la vision globale de la réussite de la recherche sur la Covid-19 en France, le classement est sans appel. On est, je crois, en 16ᵉ position. Je n'aime pas les classements, mais il à un moment donné, le classement permet quand même de préciser la réalité. Et, là aussi, on n'était pas prêts. Notre recherche est brillante parfois, mais elle est déstructurée par une multitude de structures et de couches administratives et de financements différents. Et l'on n'a pas su créer l’axe de recherche qu’ont créé d'autres pays : sans comparaison trop précise, l'Angleterre ou l'Allemagne ont eu une réussite plus grande, et pas seulement en termes de valorisation et de développement de vaccins, mais aussi en termes de recherche et d'évaluation thérapeutique. Un exemple ? C'est le nombre d'études consacrées à l'hydroxychloroquine en France, par rapport notamment à l'Angleterre. Ce n'est pas normal qu'on ait généré en France plusieurs dizaines d'études sur l’hydroxychloroquine, alors qu'en Angleterre les choses se sont organisées bien mieux et bien plus vite. Donc deux exemples qui touchent à la formation et la recherche et qui montrent que nous n'étions pas prêts et que nous ne sommes pas organisés pour répondre à ce type d'évènement.
Alors justement, dans la réflexion que vous menez en ce moment, il y a un nouveau modèle de santé publique de proximité. Est-ce que cela ne risque pas encore de fractionner la recherche et les soins, chacun travaillant dans son coin ?
Je pense que cela va être grand enjeu des prochaines années. C'est ce qu'on appelle le « principe de subsidiarité » et je crois qu'il faut savoir le développer de façon très pratique : faire la bonne action au bon niveau.
Dans la réflexion qui a été menée par les doyens des universités, je pense qu'on s'accorde souvent à penser que l'État a une place fondamentale sur des fonctions régaliennes très importantes. Ces fonctions sont assez nombreuses et parmi elles, il y a l'organisation de la santé, de telle sorte qu'il y ait une égalité d'accès aux soins et à l'innovation pour chacun. L’État a également comme rôle d'assurer la sécurité, l'éthique et la déontologie sous la forme de mesures d'exemplarité, de telle sorte qu'on donne du sens. Donc l'État a des fonctions fondamentales, régaliennes, mais qui sont un peu le cadre. Ensuite, il faut bien réfléchir à quel niveau doivent se mettre en place ces actions. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Et on a vu pendant la crise Covid, pour reprendre ce fil rouge, que les actions territoriales ou régionales ont été plus réactives, plus flexibles, plus pertinentes.
Donc, il faut trouver à partir de cet exemple un modèle pour bien définir ce que fait l'État et ce que font les collectivités et les territoires dans des actions à l'échelle du territoire. Il faut définir ce qu'est un territoire de santé et si l’on doit agir à son échelle ou à l'échelle un peu plus large de la région. Mais il faut que cette subsidiarité soit vraiment bien lisible, sous la forme d'une feuille de route et de moyens qui sont associés à ces actions. Parce qu'il n'est pas question, effectivement, que les moyens restent centralisés, et qu'on confie des missions aux territoires sans le « nerf de la guerre ». Donc, il va falloir trouver un modèle plus performant, un modèle d'efficience en fait. L’idée forte, c’est comment on est le plus efficace à l'échelle locale, pour le citoyen, pour l'étudiant, pour l'État, mais avec un cadrage national qui permet de ne pas saupoudrer et de ne pas partir dans tous les sens.
Alors, si on rentre dans le détail des problèmes, on a vu qu'en France on a des territoires sous-dotés, des déserts médicaux. On a augmenté le numérus clausus, mais en termes de mesures d'urgence, beaucoup proposent d'affecter des internes de dernière année, en particulier ceux de la future 10ᵉ année, dans les territoires sous-dotés. Qu'est-ce que vous en pensez et à quelles conditions cela peut s'envisager pour un universitaire ?
Je pense qu'il y a une condition, qui doit être notre ligne conductrice, c'est qu'on doit accompagner nos étudiants, nos jeunes dans leur projet professionnel et sortir de la verticalité de la décision. Certains veulent imposer des choses à nos étudiants et ça, c'est une vision d'un autre monde. Aujourd'hui, on essaye d’accompagner, avec à la fois rigueur et bienveillance, nos étudiants dans un projet professionnel. Donc, clairement, la position de l'université et des doyens c'est, qu’en aucun cas, il serait utile et efficace d'appliquer des mesures de coercition et d'obligation. Ce serait même contreproductif. Cette stratégie, on n'y croit pas et ce n'est pas seulement une règle qu'on se fixe.
Donc qu’est-ce que l’on peut proposer ? Il y a un certain nombre de choses qui ont été détaillées par les uns et les autres, et qui convergent. La première, c'est d'essayer de former dans les territoires, mais c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. On forme dans les territoires, en médecine générale et en spécialités, avec des universitaires qu'on appelle des MSU, des Maîtres de Stage Universitaires. Pour prendre un exemple sur un territoire comme l'Alsace, qui fait à peu près 1,8 million d'habitants, on a aujourd'hui autour de 350 Maîtres de Stage Universitaires. Donc il y a un vrai maillage de la formation dans les territoires.
La deuxième chose, c’est qu’il faut que l'accueil dans les territoires soit à la hauteur de ce qu'on peut faire. On ne peut pas imaginer un médecin rester dans un territoire s’il n'y a pas d'accompagnement dans ce territoire, dans le cadre d'une offre de soins pluri-professionnelle, dans une maison de santé, dans un centre de santé pluri-professionnel et universitaire éventuellement, et qui lui permettra de poursuivre sa formation. On ne peut pas non plus imaginer qu'il restera seul dans un endroit sans infrastructures et il faut accueillir sa famille, ses enfants avec une école, des commerces, un secteur public. Donc il y a un véritable accompagnement territorial qui est absolument nécessaire pour faire revivre les territoires. Il ne s'agit pas que de l'offre de soins.
Troisième point évidemment, on peut imaginer des mesures qui sont des mesures plus pédagogiques. La première mesure, c'est par exemple de mettre effectivement une quatrième année de médecine générale dans les territoires. Pourquoi pas ? Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Par contre, on a évoqué la possibilité de créer un « Assistanat territorial », c'est-à-dire que finalement, tout étudiant dans le cadre de sa formation pourrait bénéficier d'un ou deux ans d'assistanat territorial, qui pourrait être d'ailleurs bien mieux rémunéré qu'un poste d'interne, mais qui donnerait un complément de formation, voire une possibilité d'accès au secteur deux. Donc on peut imaginer dans ces territoires sous-dotés que tous les médecins fassent une ou deux années d'Assistant territorial, comme certains font un, deux, trois ou quatre ans de Chef de clinique ou d’Assistant Hospitalier Partagé aujourd'hui. On peut imaginer qu'il y ait cette fonction et que ce soit une fonction qui soit dans le cadre de la formation, avec une véritable attractivité. On peut aussi imaginer demander à des hospitaliers ou des hospitalo-universitaires senior de faire des consultations, ce qui existe déjà, assez largement. On peut aussi imaginer des statuts mixtes, des statuts de médecins hospitaliers et de médecins territoriaux, ce qui est une autre façon de faire de la consultation avancée. Donc, l'université peut aider pour des postes universitaires dans les territoires, de Chefs de clinique universitaire dans les territoires, financés par les régions.
On a donc tout un dispositif potentiel qui est assez dense et qui s'ajoute à une chose qui a été évoqué comme nouvelle, mais qui n'en est pas une, qui est le Contrat d’engagement de service public pour l'installation en zone sous-dense, le CESP. Ce contrat existe déjà depuis de nombreuses années, il n’est probablement pas suffisamment attractif, mais il permet aux étudiants qui le souhaitent de financer leurs études contre une installation dans une zone sous-dotée qu'ils ont identifié avec l’ARS. Et l'université signe avec les étudiants en contrat et avec l’ARS pour cette installation en zone sous-dense.
Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais je crois qu'il faut maintenant les mettre en œuvre de façon organisée et avoir une vraie stratégie régionale ou territoriale, ce qui n'est pas encore le cas, avec une coordination entre les acteurs de la santé, aujourd'hui les ARS, peut-être demain des Agences territoriales de santé. On peut imaginer une évolution de ces agences, de l'université et évidemment du système de santé au sens large, incluant, les libéraux, les hôpitaux, notamment les GHP et les CPTS. Donc les acteurs sont en place et il faudrait maintenant coordonner ces acteurs, qui sont finalement peu nombreux, de telle sorte qu'on puisse faire une offre de formation et une offre de soins dans les territoires. L’objectif est que, dans cinq ou dix ans au plus, on puisse guérir ce mal, qui n'est pas qu'un mal français d'ailleurs, puisqu’il existe dans beaucoup de pays européens.
Mais il y aura un temps de latence et je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. La suppression du numerus clausus et toutes ces mesures-là, elles ne bénéficieront aux territoires que dans quelques années. Et pour le numerus clausus, ce n'est pas avant une dizaine d'années. Donc il faut y aller maintenant mais il va falloir se serrer les coudes parce qu'il y a encore quelques années difficiles avant que le système ne se corrige complètement.
On a vu au cours de cette crise, une collaboration qui s'est mis en place dans certaines régions, entre la ville, l'hôpital et entre les différents types d'hôpitaux. Comment est-ce qu'on peut utiliser et mettre à profit cette expérience pour décloisonner la ville et l'hôpital, les universitaires et les hôpitaux généraux ou privés, et quels systèmes envisager pour mieux faire travailler tous ces acteurs ensemble ?
Je pense que c'est un autre élément-clé. On a parlé du premier élément qui était tout faire pour que l'offre de soins soit accessible au citoyen et qu'on désamorce le problème des déserts médicaux. Le deuxième, à plus long terme, c’est comment casser ces cloisonnements entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.
C'est un vrai souci qui est issu d'un certain nombre de décisions, et notamment de la disparition de l'obligation de la permanence des soins en 2005. C'est vraiment un moment de bascule qui a déstructuré le lien entre la ville et l'hôpital et qui fait peser un poids incroyable sur les urgences. En 2019, c’est plus de 21 millions de Français qui sont passés aux urgences, alors que le chiffre était de 12 millions quelques années auparavant. Donc clairement, il y a un point de bascule et la bascule se fait en termes de surcharge des urgences, en termes de problématique populationnelle, et au détriment de l'hôpital, avec une sorte de désolidarisation entre la ville et l'hôpital. Cette désolidarisation n’est pas volontaire pour aucun des deux acteurs, mais ces 2 parties de la santé ne travaillent plus suffisamment ensemble. Donc l'idée aujourd'hui, et Ma santé 2022 l’amorçait déjà car on ne découvre pas un problème qui est dans le collimateur depuis un certain temps, c’est qu’il faut retrouver une offre de soins de proximité qui allie l'ensemble des acteurs dans le cadre des CPTS, des CPTS qui devraient être alliées aux GHT. Par définition, on ne veut pas, d'un côté faire un réseau d'hôpitaux sans les hôpitaux privés, de l'autre, faire un réseau de soins de proximité.
En termes de solutions, je pense qu'il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est faire entrer des hôpitaux privés et les ESPIC dans les GHT, pour qu'ils participent aux urgences. Je crois que c'est une mesure importante. Et la deuxième mesure, c'est lier les CPTS aux GHT et à partir de là on a un réseau qui est suffisamment dense et qui est suffisamment collaboratif entre la ville et l'hôpital. Après évidemment, ce réseau, on doit le mettre en œuvre, et j'en reviens à l'université, avec une ouverture plus grande de l'université sur les territoires. Cela se fait déjà, comme je l'ai dit, car il y a plus de 300 Maîtres de Stage Universitaire dans les territoires en Alsace où ils existent jusque dans les plus petits territoires. Donc aujourd'hui, on le fait déjà, sauf qu'on n'a peut-être pas les moyens d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Même si on n'a pas de baguette magique, je pense que le sens du vent a changé, mais il faut continuer à amplifier cet effort sur ces deux axes-là, qui sont vraiment majeurs : décloisonner la médecine de ville et l'hôpital et ouvrir l'université vers l'ensemble des acteurs de la santé dans les territoires en termes de formation et de recherche.
On démarre peut-être modestement, mais si on peut le faire en termes de formation, on peut le faire demain en termes de recherche en soins premiers. On ne fera pas de recherche physiopathologie complexe dans les territoires, mais en revanche, on peut répondre à des questions pratiques sur des soins médicaux ou paramédicaux, incluant d'ailleurs une recherche sur les outils. Par exemple, quel va être l'apport de la médecine connectée, de la télé expertise, de la télémédecine ?
Il y a de multiples questions qui vont se poser, dont l'impact d'une délégation de tâches à une infirmière ou un métier intermédiaire dans les territoires. Parce que c'est un point important pour les déserts médicaux de se dire qu’on ne va pas attendre dix ou quinze ans des médecins. Je pense que, sur des filières courtes, on doit être capable de créer de la délégation de tâches sur des infirmières territoriales, qui existent déjà, mais dont on peut augmenter le nombre beaucoup plus vite. De la même façon, on peut développer des métiers intermédiaires d'assistants médicaux pour aider des cabinets, de telle sorte que ceux qui y travaillent ne quittent pas ces territoires. Si je reviens à la problématique des déserts médicaux, ce sont deux points majeurs : faire venir des jeunes et permettre à ceux qui y sont d'y rester. Ces deux questions qui sont absolument connectées, ne sont pas exactement les mêmes et on n'a pas les mêmes réponses.
Alors peut être un petit mot sur la recherche dont vous venez de parler. On a vu qu’il y a eu beaucoup de recherches en France sur la Covid-19. Par contre, on a l'impression que ça n'a pas été aussi bien organisé que, par exemple, en Angleterre ou quasiment tous les hôpitaux du NHS se sont mis à travailler tous ensemble sur des grands protocoles communs dont on a beaucoup parlé. Est ce qu'il y a une réflexion de l'université sur cet aspect pour optimiser la recherche en France ?
Sur cet aspect, nous considérons qu’il y a 2 points majeurs. Première chose, et ce n'est pas suffisamment répété : si on veut une offre de soins de qualité à moyen terme ou à long terme, elle n'existera pas si on ne fait pas un immense effort pour la recherche et pour la formation médicales et paramédicales. On ne peut pas dissocier soins, formation et recherche, c'est directement lié. De multiples études le montrent et c'est la première chose.
La deuxième chose, c’est qu’il y a un sursaut majeur à faire en termes de recherche biomédicale, à la fois dans son organisation et dans son financement. Ça a été largement débattu et beaucoup de travail a été effectué par le CNCR, la coordination de la recherche hospitalière, et par les Académies, qui ont fait un remarquable travail sur la recherche biomédicale et ont bien identifié des difficultés en termes de financement. En 2018, la dépense intérieure brute en recherche et développement (DiRD) ne représentait que 2,2%, contre 3,26% au Japon, 3,04% en Allemagne et 2,58% en moyenne dans les pays de l’OCDE.Surtout, la part de la DiRD attribuée à la santé n’est que de l’ordre de 15% en France, alors qu’elle est de près de 30% en Angleterre et aux États-Unis. Dans notre pays, l’investissement par la MIRES (Mission Interministérielles Recherche et Enseignement Supérieur) pour la santé et les sciences biologiques, qui financent notamment l’ANR et les organismes de recherche (INSERM, CNRS…) ; n’est que de 17,2%, soit près de 2,5 milliards d’euros, et il est en baisse depuis 10 ans quand il augmente dans les autres grands pays.
Donc, il y a un sous-financement majeur de la recherche biomédicale en France et, à un moment donné, ça a forcément un impact.
L’autre problème de la recherche en France, c'est la complexité de son organisation car cette recherche est faite par les hôpitaux, les CHU en particulier, les universités, le CNRS, l'Inserm, et elle est faite avec d'autres partenaires, y compris des partenaires privés, comme les CLCC, les Centres de lutte contre le cancer. Il y a donc un morcellement que l'on peut parfois voir comme un élément positif, mais le foisonnement mène au morcellement et au saupoudrage.
Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on ait véritablement une vision stratégique de l'organisation de la recherche biomédicale adossée à des financements qui devraient être largement augmentés. Il faudrait que l'on confie cette recherche, et en particulier la recherche médicale, à un acteur unique, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Nous les universitaires, nous plaidons pour que cet acteur unique soit l'université, qui a en charge une mission de formation et de recherche dans les territoires universitaires. C'est comme ça dans tous les grands pays du monde où l’université a en charge la formation et la recherche et les coordonne avec l'ensemble des acteurs, évidemment les établissements de santé, mais aussi les acteurs du monde libéral. C'est possible en Angleterre avec les JPRD : le réseau existe et travaille depuis de très nombreuses années. Donc on peut travailler ensemble à condition qu'il y ait une organisation claire et qui soit guidée par une agence unique, comme c'est le cas dans les grands pays comme l’Angleterre, l’Allemagne ou les Etats-Unis. C'est une proposition qui a été faite d’avoir une Agence nationale de moyens, qui permettrait d'être un consortium des agences thématiques actuelles, mais qui serait une grande Agence de santé capable de donner le cadre des grands plans et d’aider à des grands financements. Parce qu'évidemment, il y a des financements. En médecine, on n’est pas au niveau de la recherche nucléaire, on n'a pas les mêmes besoins, mais les plateformes de génomique ou les plateformes multi-omiques sont extrêmement coûteuses. Donc il y a vraiment besoin là aussi de savoir quelle est la place de l'État, quelle est la place d'une agence nationale qui donne le cadrage et qui peut soutenir les grands financements, et quelle est l'action locale territoriale des universités avec l'ensemble des acteurs. Car, bien sûr, il est possible d’y lier les collectivités, les métropoles et les régions, qui ne demandent qu'à rentrer, encore plus qu'elles ne le font aujourd'hui, dans le soutien à la recherche et à la formation. Encore faut-il qu'on leur délègue cette tâche et qu'on leur délègue des moyens.
Donc, on revient exactement à la même réflexion que pour le soin, c’est la subsidiarité pour la recherche : comment est-ce qu'on organise aujourd'hui un meilleur équilibre entre les fonctions de l'État et les fonctions territoriales pour donner l'agilité, la flexibilité. Pour plus d'agilité et de flexibilité, sans morceler et sans saupoudrer, le curseur de subsidiarité doit donc être très bien positionné pour qu'on devienne plus efficient.
Donc l'équation est relativement simple, mais la résoudre est relativement compliqué parce que cela impose de remettre en cause un certain nombre de positions.
Alors, au final, à la suite de la Covid-19 qui a été, comme vous le dites, un révélateur mais qui a permis de mettre en place des modèles qu'on n'avait jamais envisagés aussi rapidement en France. C'est quoi le message d'un doyen ?
Si je synthétise ce qui parait nécessaire après cette crise, c'est trois messages. Le premier, c’est d’utiliser cette crise en prenant beaucoup de hauteur pour donner un signal : « Quel est le projet commun qu'on pourrait mener aujourd'hui après un moment aussi difficile ? Qu'est-ce qu'on a à construire ensemble comme projet de société ? » Ce projet de société pour nous universitaires, doit continuer à être fondé sur la solidarité, l'altruisme, la générosité. Parce que je pense que ce sont des valeurs sociales, humaines, fondamentales et qu'un système doit avoir une vision. On ne construit pas un système comme un « mikado administratif », on doit créer un avenir commun et il faut que cet avenir repose sur des valeurs. Et je crois que les valeurs de l'université, qui sont des valeurs de responsabilité sociale, sont fondamentales, donc on aimerait reconstruire ce modèle sur ces valeur-là. C'est une première chose assez générale, mais qui, à mon sens, est vraiment très importante.
La deuxième chose, c'est qu'on puisse construire avec un souci de simplification pour tout le monde. On a une « suradministration » de notre système et on a un système qui est « sur-normé ». C'est une particularité française mais essayons quand même de trouver quelque chose de plus simple. On l'a vu dans les réformes : pour des raisons de croisements, de normes, de principe de précaution, on veut tout cadrer avec un souci d'égalité. On a généralement peur que ça ne soit pas suffisamment encadré et que l’on nuise à l'égalité. Mais c'est vraiment une mauvaise façon d'aborder cette question. Je pense que l'égalité des chances doit se traduire autrement que par des textes administratifs et par une norme qui cadre tout et qui rigidifie l'ensemble du dispositif. Là, c'est vraiment une transformation culturelle qui est complexe parce qu'on est un pays très administré, très normé, et depuis bien longtemps, c'est le fameux côté jacobin. On doit pouvoir rendre plus flexible et plus agile le système, à condition d'y mettre de la subsidiarité, et en particulier d'aller au bout de la réforme des universités et confier réellement à celles-ci les fonctions de formation et de recherche dans les écosystèmes universitaires, c'est-à-dire dans les territoires universitaires. Après, y a-t-il une réforme à faire au sein de l'université ? Toutes les universités sont-elles capables de le faire ? On peut imaginer le cas de grandes universités chercheuses, qui ont peut-être une plus grande potentialité pour coordonner cette recherche, alors que d'autres peuvent être peut-être plus dans une stratégie de formation. C'est mon deuxième message.
Et le troisième, c'est que pour la formation médicale et paramédicale, il faut vraiment qu'on ait une nouvelle vision de ce que sont la formation et les métiers de demain. Sachant que le principal atout de demain, ce seront les gens, ce seront les humains. Parce qu’on peut imaginer tous les outils, de l'algorithmique, de l'intelligence artificielle et toutes les évolutions technologiques, elles seront portées encore longtemps par des humains. Donc il faut les former ces humains et il faut leur donner un projet professionnel de qualité comprenant des évolutions, des passerelles, des développements issus de la formation continue. Et il faut aussi leur donner une reconnaissance et une valorisation. Ce n'est pas normal que dans notre pays, dans le monde de la recherche comme dans le monde du soin, nos personnels de la recherche et du soin soient payés comme ils le sont aujourd'hui. Vous connaissez tous le chiffre de la rémunération des infirmières. On était 28ᵉ sur 32 à l’OCDE, en termes de rémunération de nos infirmières. On a gagné quelques crans après le Ségur de la santé, mais on est encore loin de la moyenne. Donc il faut vraiment prioriser la formation, le suivi du projet professionnel, l'évolution des compétences et les délégations de tâches, et non pas imaginer de nouveaux métiers. Il y aura de nouveaux métiers, mais je pense qu’il y aura surtout des « métiers augmentés », c'est-à-dire en partant d'un métier pour lequel on a déjà un socle, on peut y adosser de nouvelles compétences, par exemple les infirmières avec les IPA, qu’il faudra faire encore évoluer. Idem pour les manipulateurs radio. On peut faire de ces métiers-là des métiers augmentés de telle sorte qu'on réponde aux enjeux de la santé de demain.
Mais le message final, c'est vraiment confier à l'université avec l'ensemble des acteurs, la capacité de développer des projets professionnels et de développer des métiers, des compétences qui vont répondre aux enjeux de la santé de demain.