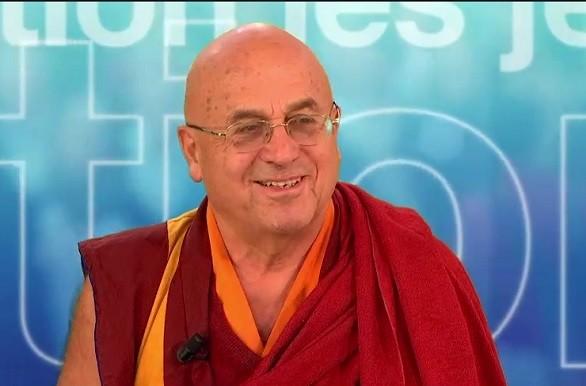Psychiatrie
Suicide : le passage à l’acte ne survient pas toujours en contexte suicidaire
La moitié des adultes qui mettent fin à leurs jours n’ont aucun facteur de risque de dépression ou de risque suicidaire diagnostiqués. Cela plaide pour considérer au moins deux sous-types de suicides et pour élargir la prévention au-delà du seul repérage des troubles mentaux et des tentatives antérieures.

- shadrin_andrey/istock
Le suicide demeure une cause majeure de mortalité, avec près de 50 000 décès annuels aux États-Unis et plus de 700 000 dans le monde. Classiquement, le meilleur prédicteur de décès par suicide est la tentative antérieure, mais moins de 10 % des sujets ayant fait une tentative décèdent ensuite par suicide, et environ la moitié des décès surviennent sans trace de suicidalité préalable ou de diagnostic psychiatrique documenté.
Le registre Utah Suicide Mortality Research Study (USMRS) avait déjà montré que ces suicides « sans antécédents » (SD-N) présentaient moins de diagnostics psychiatriques que les suicides « avec antécédents » (SD-S), sans que l’on sache s’il s’agissait d’un moindre accès aux soins ou d’un profil de risque différent.
Le suicide sans antécédents suicidaires : un sous-type génétiquement distinct
Dans cette nouvelle analyse publiée dans le JAMA Network Open, 1337 suicides SD-N ont été comparés à 1432 suicides SD-S et à 19 499 témoins populationnels, via des scores polygéniques portant sur 12 traits neuropsychiatriques.
Après ajustement sur l’âge, le sexe et l’ascendance génétique, les PGS de dépression majeure, affect dépressif, anxiété, névrosisme, maladie d’Alzheimer et, à un moindre degré, état de stress post-traumatique sont significativement plus bas dans le groupe SD-N que dans le groupe SD-S. Pour l’affect dépressif, le névrosisme et la maladie d’Alzheimer, les SD-N ne se distinguaient pas des témoins, suggérant une absence de vulnérabilité génétique majorée sur ces dimensions.
Des vulnérabilités partagées et des différences selon le sexe et l’âge au décès
Au-delà de ce signal global, certains risques génétiques apparaissaient comparables dans les deux sous-types de suicide. Les scores polygéniques de TDAH et d’usage problématique d’alcool sont élevés de façon similaire chez les SD-N et SD-S par rapport aux témoins, évoquant un socle commun de vulnérabilités liées notamment au contrôle des impulsions. Les scores polygéniques d’autisme ne sont pas globalement plus faibles dans le groupe SD-N, mais des analyses par sexe suggéraient un profil plus complexe, avec des scores polygéniques d’autisme élevés chez les femmes SD-N, invitant à mieux explorer le rôle de traits neurodéveloppementaux (rigidité cognitive, difficultés sociales) dans le risque suicidaire féminin.
Les auteurs rapportent aussi des différences selon l’âge au décès : chez les sujets plus jeunes, les scores polygéniques de dépression, affect dépressif et névrosisme sont plus bas en SD-N qu’en SD-S, tandis que chez les plus âgés, l’écart portait surtout sur l’anxiété et la maladie d’Alzheimer. Fait notable, les PGS de schizophrénie étaient augmentés dans les deux groupes de suicides par rapport aux témoins, alors que les diagnostics cliniques de schizophrénie étaient nettement moins fréquents chez les SD-N que chez les SD-S, ce qui pourrait refléter une vulnérabilité subclinique ou la capture, par ce score polygénique, d’autres dimensions comportementales liées au risque de mortalité. Au total, ces résultats suggèrent que combiner tous les suicides en une seule catégorie dilue des signaux génétiques distincts, en particulier selon le sexe et l’âge.
Une cohorte génétique populationnelle et des limites de généralisabilité
Cette étude de cohorte repose sur le registre Utah Suicide Mortality Research Study, qui agrège depuis 1998 les décès par suicide dans l’Utah avec leurs données cliniques, sociodémographiques et génétiques. Les auteurs ont identifié la suicidalité antérieure (idéations, menaces, tentatives) à partir des diagnostics et des notes cliniques analysées par traitement automatique du langage. Les scores polygéniques ont été calculés à partir de grandes études d’association pangénomique publiées, choisies pour la taille d’échantillon et la proximité d’ascendance (principalement européenne) avec la cohorte. Les comparaisons entre SD-N, SD-S et témoins ont été réalisées par analyses de covariance ajustées, avec corrections pour tests multiples, puis explorées par sous-groupes de sexe et d’âge. Plusieurs limites restreignent toutefois la généralisabilité : possible sous-détection de suicidalité passée dans le groupe SD-N, témoins non dépistés pour la suicidalité, prédominance d’ascendance européenne, effectifs encore modestes pour certaines analyses stratifiées.
Néanmoins, selon les auteurs, l’ensemble converge vers l’idée que les suicides sans antécédents suicidaires documentés ne sont pas simplement des suicides mal dépistés, mais pourraient correspondre à une étiologie génétique et clinique partiellement différente.
En pratique, ces données invitent à la prudence dans l’extrapolation des modèles fondés uniquement sur les troubles psychiatriques et les tentatives antérieures. Elles renforcent la nécessité de combiner l’évaluation des troubles mentaux avec l’étude d’autres dimensions (impulsivité, consommation d’alcool, traits neurodéveloppementaux, facteurs sociaux et environnementaux). Pour la recherche, elles plaident pour des analyses génétiques et cliniques stratifiées selon la présence ou non d’antécédents suicidaires, le sexe et l’âge au décès, ainsi que pour une prise en compte plus systématique des facteurs non psychiatriques dans la compréhension et la prévention de la mortalité par suicide.






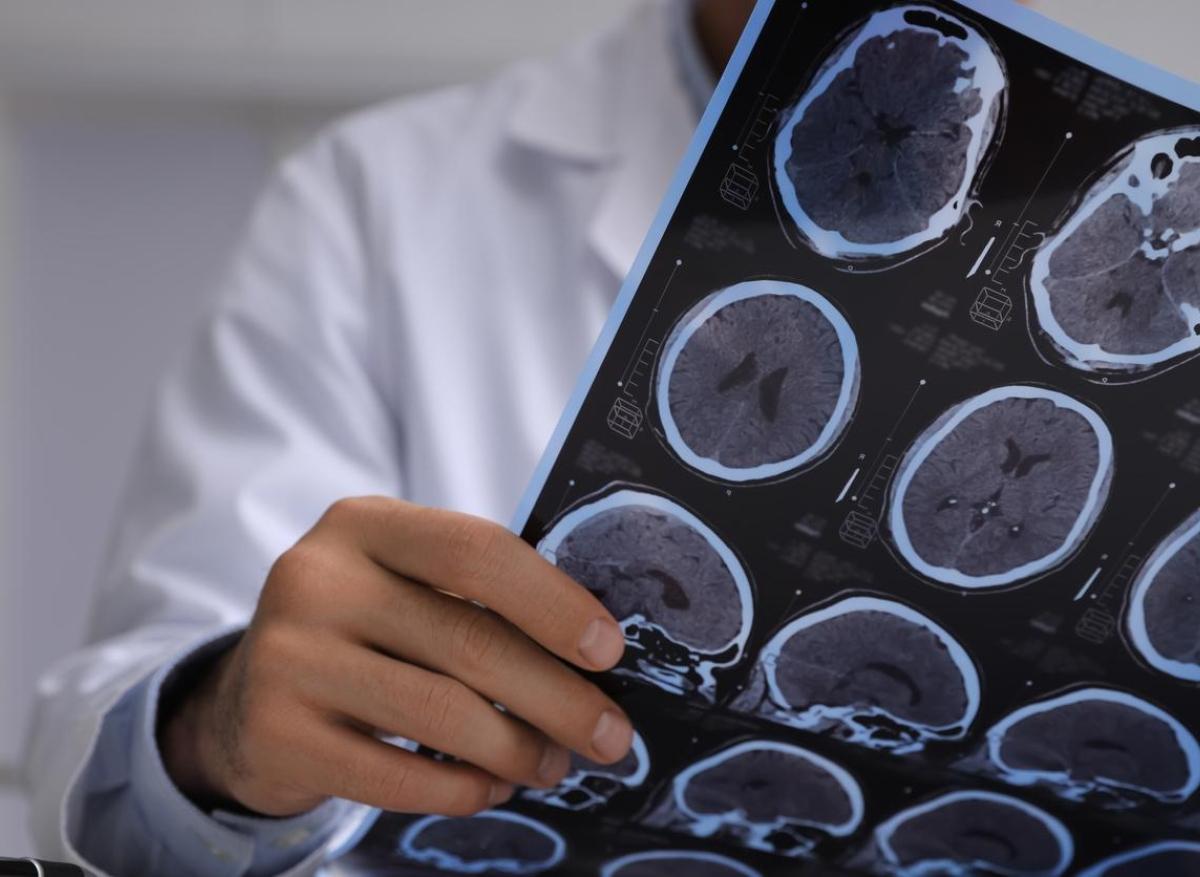

















-1571835510.jpg)