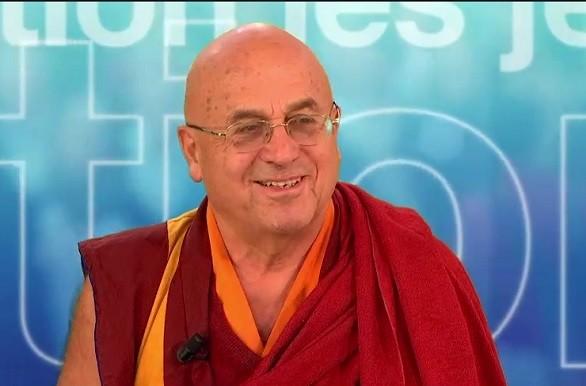Gynéco-obstétrique
Paracétamol, grossesse et autisme : pas de lien clairement établi selon la science
L’alerte du Ministre de la santé américain sur un risque d’autisme chez l’enfant exposé in utero au paracétamol a profondément inquiété. Une revue systématique de méta-analyses (umbrella review) montre pourtant que les signaux mis en exergue reposent sur des données fragiles et largement polluées par les facteurs familiaux et environnementaux.

- Pixavril/istock
Le paracétamol reste l’antalgique-antipyrétique recommandé en France pendant la grossesse, et c’est le cas dans la plupart des agences réglementaires internationales, en raison des risques materno-fœtaux liés à la fièvre non traitée et à l’absence d’alternative, comme les AINS. Une décision purement politique a remis en cause ce postulat aux États-Unis et a inquiété femmes enceintes et médecins. Une revue scientifique des analyses disponibles (umbrella review), publiée dans The BMJ, a recensé neuf revues systématiques (portant sur 40 études) sur l’exposition prénatale au paracétamol et le risque d’autisme ou de trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
La plupart concluent à une association possible, mais tout en appelant à la prudence devant le risque majeur de biais de confusion (génétique, familial, environnemental, lié aux indications de ce traitement) et la qualité hétérogène des études. Lorsque l’on se concentre sur les rares études de cohorte utilisant des analyses intra-fratries, l’augmentation de risque observée en analyses de cohortes complètes (hazard ratios proches de 1,05–1,10) disparaît ou s’atténue autour de 1,0, ce qui n’est pas compatible avec un effet causal du paracétamol.
Un signal médiatique fort, une évidence scientifique faible
L’umbrella review montre un chevauchement très important des études primaires entre revues (corrected covered area 23%) et une qualité méthodologique globalement faible selon AMSTAR 2 : sept revues sont jugées de qualité « critiquement basse », deux de qualité « basse ». Une seule revue incluait des études contrôlant de façon adéquate les facteurs familiaux par modèle de frères et sœurs.
Dans ces analyses, les hausses de risque d’autisme (HR 1,05 ; IC à 95 % 1,02–1,08) et de TDAH (HR 1,07 et 2,02) observées en analyses de cohortes ne sont plus retrouvées en modèles intra-fratries qui réduisent le risque de biais génétique (HR proches de 0,98–1,06). Une cohorte japonaise récente confirme cette atténuation, avec des HR passant d’environ 1,1–1,3 à des valeurs non significativement différentes de 1.
Parallèlement, aucune donnée humaine solide ni expérimentale animale à doses thérapeutiques ne démontre un mécanisme neurotoxique établi du paracétamol. En revanche, les risques fœtaux des AINS (oligoamnios, fermeture ductale) et de l’hyperthermie non traitée (organogénèse, risque obstétricaux) et des causes de la fièvre (infections virales) sont bien documentés, ce qui plaide pour ne pas décourager l’usage raisonné du paracétamol pendant la grossesse.
Des associations très sensibles aux analyses intra-fratries, une tolérance rassurante
Cette umbrella review s’appuie sur une recherche systématique des revues de cohortes, études cas-témoins et essais, couvrant plusieurs bases bibliographiques et la littérature grise jusqu’au 30 septembre 2025. Les résultats doivent toutefois être interprétés dans le cadre d’un corpus largement observationnel, marqué par une hétérogénéité des définitions d’exposition, des outils diagnostiques d’autisme et de TDAH, et une prise en compte très variable des facteurs de confusion.
Les modèles intra-fratries, bien qu’imparfaits, renforcent la généralisabilité d’un message central pour la pratique : les données actuelles ne justifient pas de restreindre le paracétamol lorsqu’il est cliniquement indiqué pour traiter douleur ou fièvre chez la femme enceinte, en gardant le principe de la dose efficace minimale sur la durée la plus courte.
Pour aller plus loin, les priorités de recherche sont désormais des cohortes de grande taille avec évaluation rigoureuse de l’exposition, ajustement approfondi (génétique, environnement, indication), triangulation des méthodes (analyses populationnelles, intra-fratries, contrôles négatifs) et exploration d’autres issues neurodéveloppementales afin de consolider, ou d’infirmer, définitivement ce signal.





















-1571835510.jpg)