Neurologie
Alzheimer : la perte de mémoire n’est pas un marqueur précoce systématique
Considérée comme un signe précoce de la maladie d’Alzheimer, les troubles de la mémoires ne sont pas systématiques au début de la maladie, révèle une étude de l’Inserm. La perte de mémoire peut aussi être le symptôme d’autres pathologies, qui seraient alors écartées au profit d’un diagnostic erroné.

- designer491/iStock
En France, on estime à 900 000 environ le nombre de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Alors que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, nombre d’essais cliniques cherchent aujourd’hui des moyens de diagnostiquer précocement cette maladie neurodégénérative en en cherchant les symptômes cliniques les plus évocateurs, en particulier une perte de mémoire.
Pourtant, une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’Inserm, du CHU de Lille et de l’Université de Lille au sein du laboratoire "Lille Neurosciences et Cognition" montre que l’amnésie n’est pas spécifique de la forme précoce de la maladie d’Alzheimer. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la revue Neurobiology of Aging.
Un symptôme non-prédictif d’Alzheimer
Aujourd’hui, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer repose sur l’imagerie cérébrale, ainsi que sur une évaluation neuropsychologique, au cours de laquelle les troubles de la mémoire sont considérés comme un symptôme précurseur de la maladie. La maladie d’Alzheimer est donc fréquemment diagnostiquée en premier lieu chez les patients âgés ayant des troubles de mémoire ou écartée rapidement dans le cas contraire.
Or, l’étude, qui s’est basé sur le don de cerveau de 91 patients décédés, montre que la maladie d’Alzheimer n’est pas la seule pathologie dans laquelle surviennent les troubles de la mémoire. Les patients décédés souffraient de diverses maladies neurodégénératives dont l'Alzheimer, mais aussi la dégénérescence fronto-temporale, la maladie à corps de Lewy, de Creutzfeldt-Jakob, ou de lésions cérébro-vasculaire progressives.
Tous avaient été vus à des stades précoces de leur maladie et avaient passé des tests cognitifs. Ils avaient ensuite été classés en trois groupes selon la sévérité des pertes de mémoire : un groupe de non amnésiques, un groupe de patients modérément amnésiques, et un dernier groupe de patients sévèrement amnésiques. Après leur décès, l’étude de leur cerveau (neuropathologique) a permis de confirmer ou d’infirmer le diagnostic clinique initial.
Un risque d’errance diagnostique
Parmi les 91 patients, un seul souffrant d’amnésie modéré s’est vu confirmer le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Un tiers des patients touchés par cette maladie n’avait pas de problèmes de mémoire, et près de la moitié des patients sans maladie d'Alzheimer était amnésique. La présence d’une amnésie apparaissait comme faiblement prédictive de la pathologie Alzheimer.
"Nos résultats confirment que le diagnostic fondé sur l’amnésie comme marqueur précoce et systématique de la maladie d’Alzheimer a une pertinence limitée, souligne Maxime Bertoux, chercheur à l’Inserm. Ils invitent à repenser la manière dont cette maladie est diagnostiquée afin de réduire l’errance diagnostique et la mauvaise orientation de certains patients et d’améliorer la reconnaissance clinique et sociétale des autres maladies neurodégénératives."
Les résultats de l’étude invitent aussi à revoir les critères sur lesquels sont recrutés les participants à des essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer. Dans la majorité des cas, un critère d’amnésie est retenu. "Associer systématiquement une perte de mémoire à la maladie d’Alzheimer pourrait biaiser les inclusions dans les protocoles de recherche", ajoute Maxime Bertoux.
Enfin, les chercheurs soulignent l’importance de "confronter toute technique diagnostique à l’analyse post-mortem du cerveau, la seule à offrir une preuve formelle de diagnostic". Ils appellent ainsi à une sensibilisation plus large de la population sur l’intérêt du don de cerveaux.


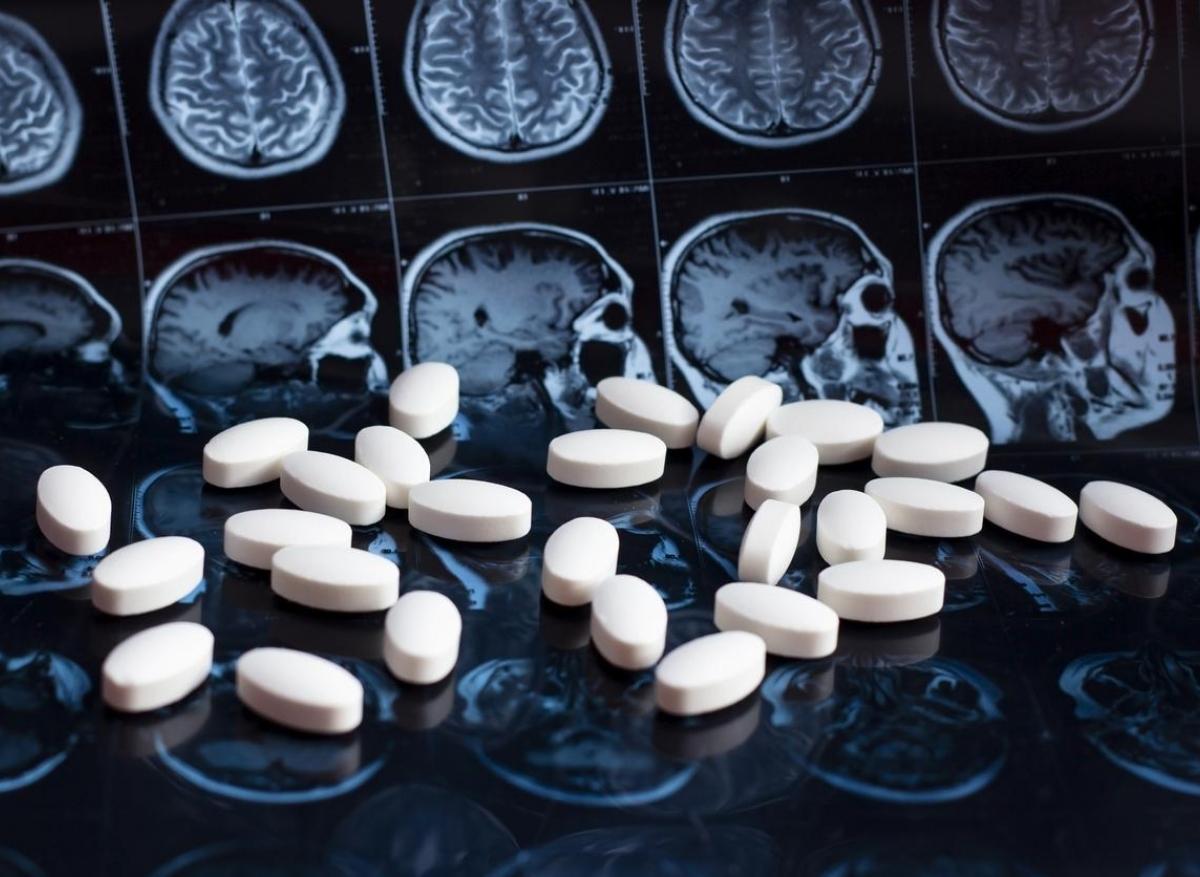

-1574959022.jpg)



























