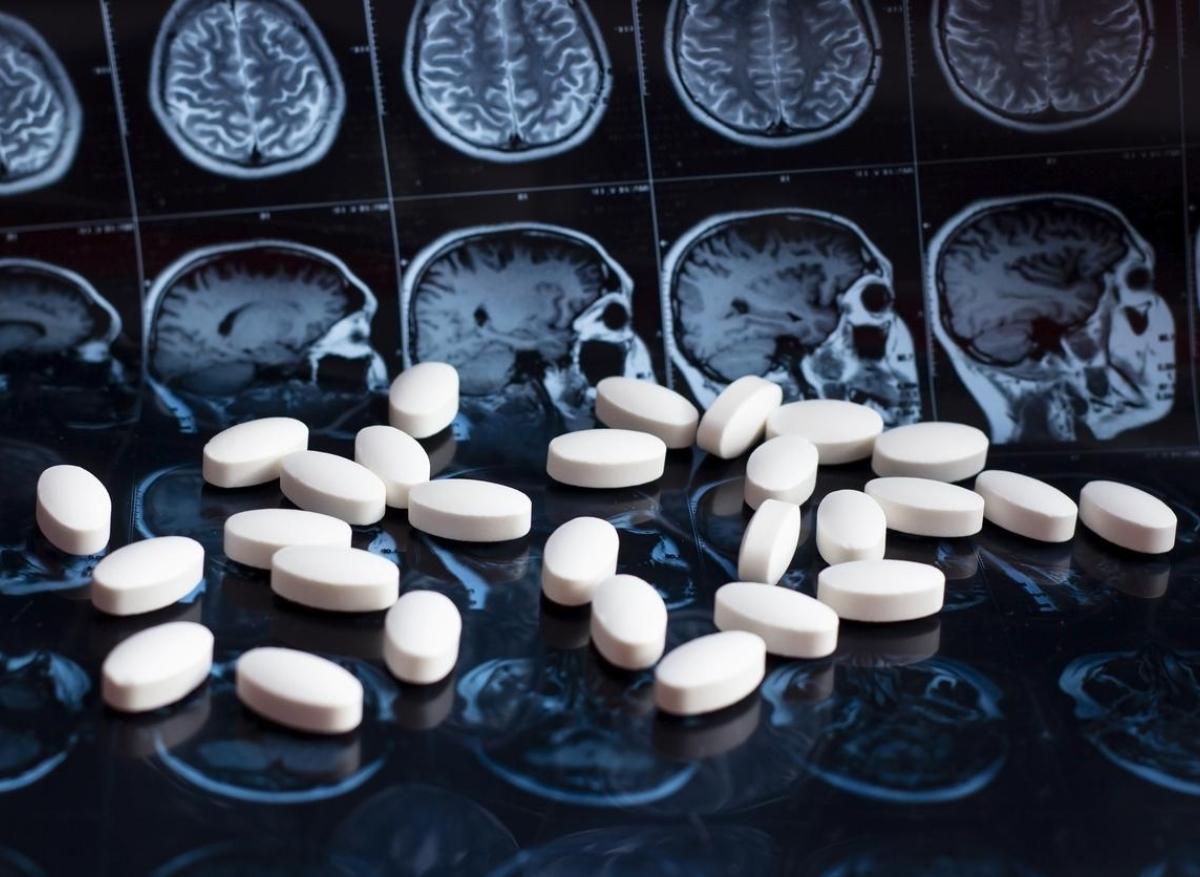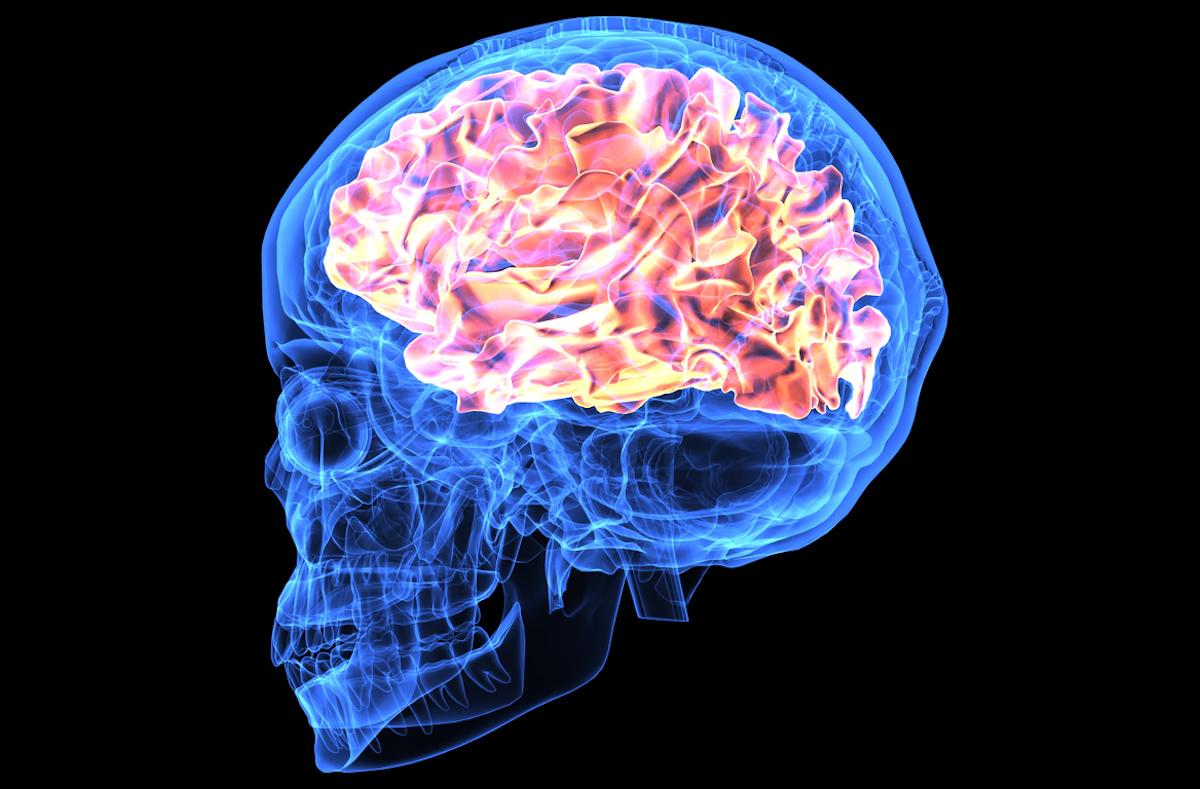Neurologie
Maladie d’Alzheimer : passer de la probabilité au diagnostic clinico-biologique avant traitement
La mise à disposition d'anticorps anti-amyloïdes contre la maladie d'Alzheimer et de tests diagnostiques sanguins marque le début d'une nouvelle ère dans le diagnostic et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Cependant, sans une réforme rapide des systèmes de santé, des politiques publiques et des attitudes sociétales, leur potentiel ne pourra être pleinement exploité.

- jarun011/istock
signant plaques β-amyloïdes et dégénérescence tau. L’ajout de biomarqueurs fait passer la précision diagnostique de 60–70 % à 90–95 % et permet un diagnostic plus précoce permettant un traitement.
L’ère des anticorps anti-amyloïde (lecanemab, donanemab) oblige à réorganiser les parcours : dépistage clinique, accès gradué aux tests (sang puis LCR/PET), harmonisation des critères 2024, traçabilité et équité, selon la série The Lancet consacrée à cette maladie.
Du soupçon clinique au diagnostic clinico-biologique structuré
Le point de départ reste un phénotype typique (déclin progressif, souvent mnésique, ± troubles comportementaux, signes neurologiques, retentissement fonctionnel) étayé par des tests cognitifs et une imagerie structurelle (atrophie temporo-médiale). Mais ces éléments sont non spécifiques. Le basculement vers une certitude opérationnelle repose sur des biomarqueurs moléculaires qui marquent in vivo les lésions cardinales : PET amyloïde/tau, LCR Aβ42/Aβ40 et p-tau181, et désormais tests sanguins p-tau (p-tau217) disponibles dans plusieurs pays.
Cette armature clinico-biologique, en usage croissant dans les centre mémoire européens, ancre le diagnostic et anticipe la thérapeutique : les traitements ciblant l’amyloïde, approuvés dans un nombre croissant de juridictions, exigent la preuve d’une pathologie β-amyloïde préalable et sont d’autant plus efficaces qu’ils sont utilisés tôt. Dans les essais d’enregistrement, ces anticorps ont ralenti la progression cognitive de 27 à 39 %, tout en améliorant des biomarqueurs tau, consacrant l’intérêt d’identifier tôt les patients biologiquement éligibles.
Reconfigurer le système de soins : un parcours gradué, traçable et équitable
La montée en puissance des biomarqueurs invite à repenser le trajet patient. En amont, la première ligne, la médecine générale, repère le trouble cognitif et adresse tôt en centre mémoire. Au palier spécialisé, un algorithme par paliers optimise les ressources : sanguin p-tau (triage) pour probabiliser l’amyloïdose et, en cas de positivité ou de doute, confirmation par CSF ou PET selon disponibilité, contre-indications et préférences. Ce séquencement limite l’errance, lisse les capacités d’imagerie/LCR et sécurise l’indication thérapeutique.
Parallèlement, il faut outiller l’équité d’accès : cartographie régionale des plateaux, priorisation des profils à risque (début précoce, déclin documenté), transparence des délais, information partagée.
Les comptes rendus doivent documenter A/T (amyloïde/tau) et l’état neurodégénératif (atrophie hippocampique, FDG-PET, neurofilament light) afin de soutenir la décision, l’inclusion thérapeutique et la réévaluation longitudinale. Enfin, l’intégration des nouveaux tests sanguins dans les SIH requiert qualité analytique, seuils validés, procédures de contre-vérification et formation à l’interprétation conjointe avec la clinique.
Gouvernance, critères 2024 et agenda de recherche pour un déploiement responsable
Deux cadres coexistent et doivent être harmonisés dans les pratiques : les Alzheimer’s Association 2024 Revised Criteria (staging biologique A/T croisé à 6 stades cliniques) et les critères IWG 2024 (entité clinico-biologique liant amyloïdose/tauopathie et profils cognitifs). La tension conceptuelle (statut des phases présymptomatiques/asymptomatiques, signification d’une positivité biomarqueur sans déficit objectif) impose de circonscrire la décision thérapeutique à la situation clinique avec retentissement et biomarqueurs concordants.
Côté système, il faut normer le codage du statut A/T, publier des indicateurs (délai suspicion vers confirmation, part de diagnostics biomarqueurs-confirmés, taux d’accès aux thérapies ciblées), et structurer des registres de vie réelle pour évaluer bénéfices, risques et parcours. Les priorités de recherche portent sur la validation externe des critères 2024, la généralisation des tests sanguins (p-tau217) à diverses populations, l’articulation optimale sang versus LCR/PET, et la définition de fenêtres d’intervention plus précoces sans médicaliser indûment les états à risque.
En synthèse, la filière Alzheimer gagne à passer d’un modèle « probabiliste » centré sur la clinique à un modèle clinico-biologique tracé, garantissant précision, éligibilité thérapeutique et justice d’accès.