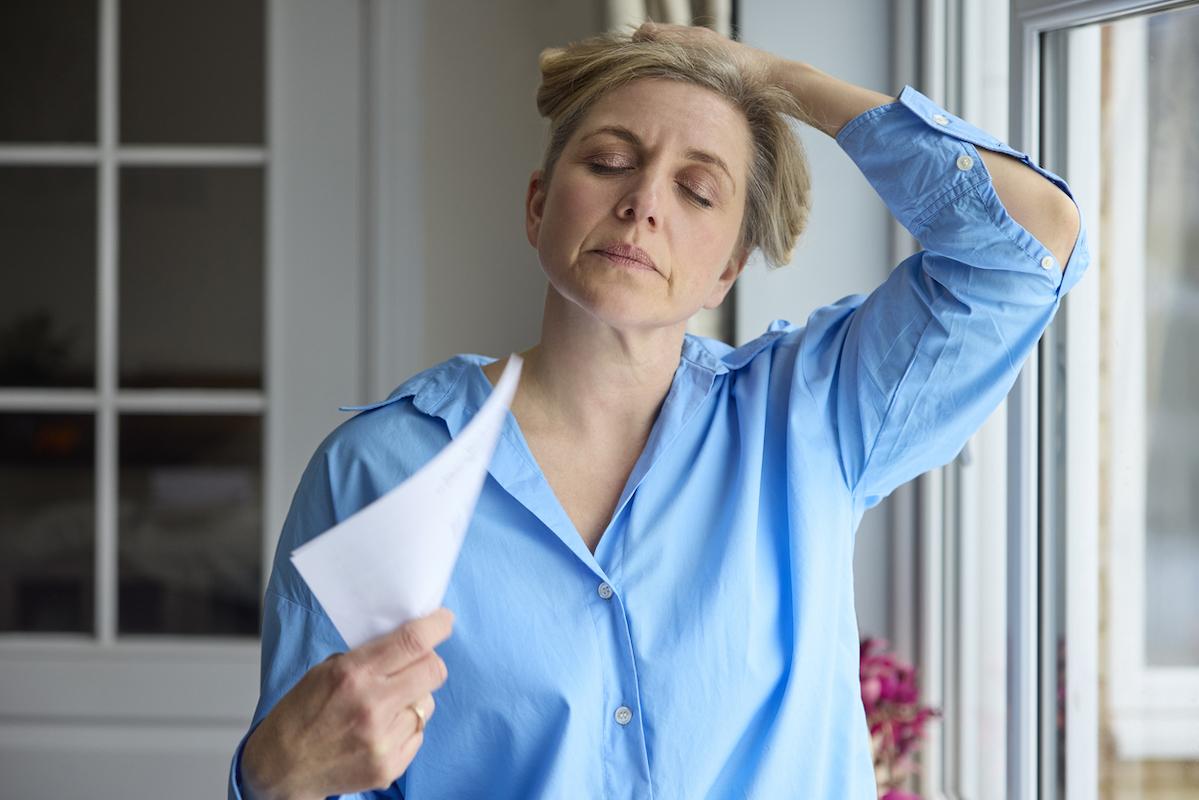Neurologie
Sclérose en plaques : influence du sexe sur le risque d’apparition du handicap
Le sexe et l’âge influenceraient différemment les mécanismes de progression et devraient être intégrés dans la prise en charge. La distinction entre PIRA, PIRMA et RAW est essentielle pour mieux individualiser les stratégies thérapeutiques, notamment chez les patients plus âgés ou après la ménopause.

- Jacob Wackerhausen/istock
Si l’impact du genre sur l’incidence et le risque de poussée dans la SEP est bien connu, son influence sur le handicap a été moins étudié. De plus, ce handicap a longtemps été rattaché à l’activité inflammatoire, mais il semble maintenant évident que la composante non liée aux poussées (PIRA) semble occuper une place importante.
Les données sur l’influence du sexe sur l’apparition du handicap (CDA) dans sa composante RAW (liée aux poussées), PIRA (indépendante des poussées) et PIRMA (progression Indépendant de l’activité clinique et radiologique) n’a jamais été rapportée.
Analyse de la base de données de Ravenne des patients SEP-RR
Les auteurs ont analysé la base de données de Ravenne de patients suivis pour une SEP RR avec un examen clinique tous les 6 mois (EDSS) et une IRM tous les ans : 492 patients ont été inclus avec un suivi moyen de 5,8 ans (3,5–8,4). Ils avaient un âge médian de 44,0 ans (IQR 35,0–53,6), 68,9% étaient des femmes. Les 2 populations ont ensuite été appariées et ajustées.
Le CDA a été identifié chez 32,7% des femmes et 15,1% des hommes, soit une différence de risque de +17,6% (IC à 95% 10,3%–24,9%) ; p<0,001). Le score EDSS médian à la dernière visite est significativement plus élevé chez les hommes (2,0 ; IQR 1,5–2,5) que chez les femmes (1,5 ; IQR 1,0–2,0; p<0.001).
Risque de PIRA plus élevé chez les femmes
Les femmes ont un Hazard Ratio d’avoir un PIRA plus élevé que les hommes : HR 2,44 ; IC à 95% à 1,56–3,70 ; p<0,001 et le nombre d’évènements PIRA est significativement plus important en période post-ménopausique que pré-ménopausique : 0,35±0,60vs 0,19±0,40 ; MD +0.16 ; p=0,014.
Le PIRMA est survenu chez 56 (21.5%) femmes et 16 (6.9%) hommes, correspondant à une différence de risque de +14.6% (95% CI 8,7%–20,6% ; p<0,001 ; ainsi le Hazard Ratio d’avoir un événement PIRMA est significativement plus élevé chez les femmes : HR 2,13 (IC à 95% 1,25–3,70) ; p<0,001). Le RAW est survenu chez 24 (9.2%) femmes et 13 (5.6%) hommes (p=0,170) et les évènements PIRA sont significativement plus nombreux en pré qu’en postménopause : 0,15±0,35 vs 0,05±0,20 ; p=0,015.
Le score EDSS par évènement est plus élevé chez les hommes
Les hommes ont une aggravation plus importante du score EDSS par événement PIRA (0,29±0,71 vs +0,16±-0,53 ; p=0,023) et PIRMA (+0,25±0,71 vs +0,09±0,8 ; p=0,001). Un âge au début de la maladie ≥50 ans augmenterait le risque de PIRA/PIRMA sans interaction du sexe.
Le sexe influençait néanmoins le site lésionnel initial (névrite optique et atteinte supra-tentorielle, p<0.001) et le type de traitement proposé (efficacité modérée vs haute efficacité, p=0.013) pour le PIRA et le PIRMA.
Dissociation fréquence et sévérité des événements de progression selon le sexe
Cette étude relève donc la dissociation entre fréquence et sévérité des événements de progression selon le sexe : les femmes, en particulier ménopausées, semblant avoir davantage d’épisodes de progression silencieuse (PIRA/PIRMA) et les hommes présenter une aggravation plus marquée de l’EDSS par épisode.
Elle révèle également une stratégie thérapeutique différente selon le sexe qui ne semble pas idéale puisque les femmes, moins fréquemment traités en 1ère ligne par un traitement de haute efficacité présentent un risque de PIRA/PIRMA plus élevé.
Si les biais inhérents aux études rétrospectives (manque d’évaluation clinique précise , biais de rappel, durée de suivi peut être courte pour évaluer la survenue du handicap) doivent être prise en compte, les résultats de cette étude suggèrent que le sexe et l’âge influencent différemment les mécanismes de progression et doivent être intégrés dans la prise en charge. La distinction entre PIRA, PIRMA et RAW est essentielle pour mieux individualiser les stratégies thérapeutiques, notamment chez les patients plus âgés ou après la ménopause.
References :
- Sex differences in relapse-independent and relapse-associated disability progression in relapsing-remitting multiple sclerosis: a real-world inverse-probability weighted study. Foschi M, Marastoni D, Panzera I, Mancinelli L, Ganino C, Abbadessa G, D'Anna L, Gabriele F, Sacco S, Signoriello E, Lugaresi A, Tsantes E, Piscaglia MG, Surcinelli A.Ther Adv Neurol Disord. 2025 Sep 23;18:17562864251376807