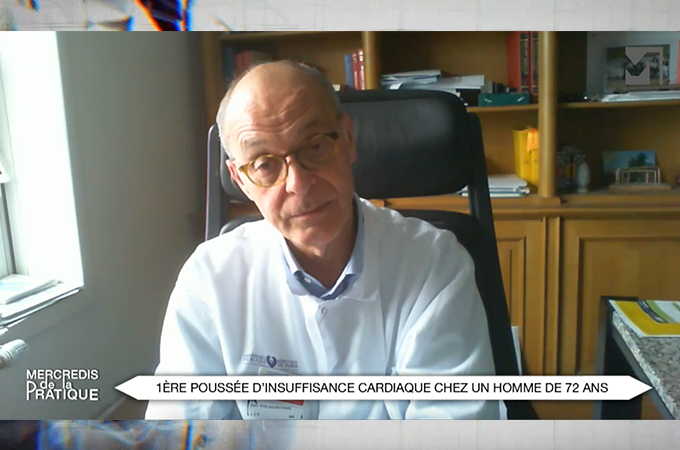Diabétologie
Diabète cortico-induit : quels mécanismes moléculaires pour un traitement ciblé ?
Un diabète peut apparaître lors d’une corticothérapie ; mieux en comprendre les mécanismes permettrait de mieux le traiter, voire de le prévenir.

- Istock/adrian825
Une intolérance au glucose et un diabète peuvent apparaître lors d’une corticothérapie, liés entre autre à une augmentation de la néoglucogenèse hépatique. Afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents, une équipe chinoise a développé plusieurs modèles murins et in-vitro. Ils ont ainsi pu démontrer le rôle majeur du facteur de transcription Krüppel-like factor 9 (Klf9), dont l’expression hépatique permet au cortisol d’activer la néoglucogenèse hépatique lors du jeûne prolongé, ou de manière pathologique lors d’une corticothérapie. Surtout, l’inhibition de cette protéine permet d’éviter l’apparition d’une hyperglycémie lors d’un traitement par dexaméthasone chez la souris.
Klf9, un intermédiaire hépatique crucial
Tout d’abord, les chercheurs ont corrélé l’expression de Klf9 d’une part, le jeûne prolongé (qui active la sécrétion de cortisol) et un traitement par dexaméthasone d’autre part, ce dernier étant associé à l’apparition d’une hyperglycémie. Ils ont ensuite démontré l’action de Klf9 dans le maintien de la glycémie à jeun et l’activation de plusieurs gènes clés de la néoglucogenèse hépatique, en le surexprimant dans des lignées cellulaires d’hépatocytes in-vitro et in-vivo chez la souris. Enfin, le rôle central de cette molécule a pu être démontré par plusieurs invalidations de ce gène (knock-out) : la perte d’expression hépatique de Klf9, chez des souris diabétiques, a permis de nettement améliorer leur métabolisme glucidique, et, chez des souris normales, de protéger d’une hyperglycémie induite par dexaméthasone.
L’utilisation de modèles murins encore indispensable
Les moyens mis en œuvre dans la découverte et l’étude du rôle de Klf9 dans le diabète cortico-induit démontrent l’utilité d’associer des modèles in-vivo murins à des ressources in-vitro. Ainsi, le premier indice de l’implication de cette molécule découle de la réalisation de transcriptomes, permettant de séquencer tous les ARNm présents, de foies de souris traitées par dexaméthasone, comparés à ceux de souris contrôles. Si l’utilisation de lignées cellulaires a ensuite permis de souligner le rôle direct de Klf9 dans l’activation de la néoglucogenèse hépatique par transfection cellulaire, l’utilisation de souris restait indispensable pour démontrer cette action in-vivo, l’hyperglycémie cortico-induite résultant de relations complexes inter-organes, incluant en plus du foie au moins le pancréas, le tissu adipeux et le cerveau.
De nouvelles voies de recherche
Un diabète est une complication fréquente et redoutable de la corticothérapie, surtout au long cours, pouvant en remettre en question l’indication ; ainsi, après greffe d’organe, la tendance est au remplacement de la corticothérapie par d’autres immuno-suppresseurs, parfois au détriment de la fonction du greffon. Aujourd’hui, la prise en charge du diabète cortico-induit est uniquement symptomatique, avec règles hygiéno-diététiques et traitement anti-diabétique. La précision du rôle central de Klf9 dans les mécanismes hépatiques conduisant à ce diabète cortico-induit, et la démonstration de la prévention de ce diabète par son inhibition chez la souris, permet d’entrevoir une thérapie ciblée associée à la corticothérapie pour en prévenir les effets secondaires glycémiques, qui inhiberait donc l’action hépatique de Klf9. Avant une telle prise en charge, une étude approfondie des autres effets de l’inhibition hépatique de cette protéine, la persistance de l’effet recherché au plus long cours, et la démonstration de la faisabilité d’une telle intervention chez l’Homme, restent bien sûr à réaliser.