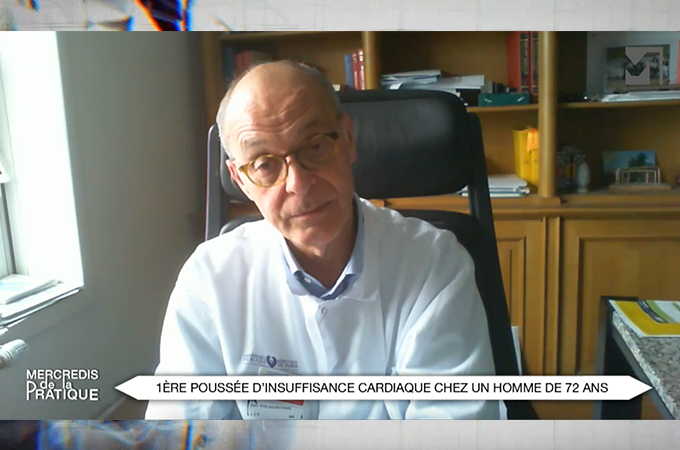Psychiatrie
Dépression : les effets cardio-métaboliques contrastés des antidépresseurs
Poids, tension artérielle, fréquence cardiaque, bilan hépatique : les antidépresseurs n’ont pas tous le même profil physiologique. Une méta-analyse en réseau de 151 essais randomisés met en évidence des différences cliniquement significatives entre molécules.

- YaroslavKryuchka/istock
Alors que jusqu’à 17 % de la population adulte reçoit un traitement antidépresseur en Europe et en Amérique du Nord, les effets physiologiques de ces traitements restent mal caractérisés. Poids, tension artérielle, hyponatrémie ou allongement du QT sont des effets indésirables bien documentés individuellement, mais peu comparés systématiquement entre molécules. Une méta-analyse en réseau (NMA) a été conduite à partir de 151 essais randomisés contrôlés et 17 rapports d’agences, incluant plus de 58 000 patients traités en monothérapie pour une pathologie psychiatrique.
Selon les résultats publiés dans The Lancet, il existerait des différences substantielles entre molécules, notamment sur les paramètres métaboliques et cardiovasculaires. Ainsi, la prise de poids diffèrerait de près de 4 kg entre l’agomélatine (effet neutre) et la maprotiline (effet marqué), la fréquence cardiaque varierait de plus de 21 bpm entre la fluvoxamine et la nortriptyline, et la pression artérielle systolique de plus de 11 mmHg entre la nortriptyline et la doxépine.
Les IRSNa (duloxétine, desvenlafaxine, venlafaxine) seraient associés à une augmentation du cholestérol total, ainsi que, pour la duloxétine, de la glycémie, malgré une tendance générale à la perte de poids. Ces modifications, bien que modérées, pourraient avoir un retentissement clinique en cas de facteur de risque cardiovasculaire préexistant.
Des différences marquées dans les effets physiologiques des antidépresseurs
La plupart des antidépresseurs étudiés n’induisent pas de perturbation cliniquement significative de la natrémie, de la kaliémie, de la créatininémie ou du QTc dans les essais randomisés. Cependant, les IRSNa (notamment duloxétine, desvenlafaxine, lévomilnacipran) entraîneraient une élévation des transaminases (AST, ALT) et des phosphatases alcalines, en cohérence avec des cas de cholestase décrits dans la littérature. Ces anomalies hépatiques restent de faible amplitude mais doivent être connues. Aucune corrélation n’a été observée entre l’amélioration des symptômes dépressifs et la survenue de ces altérations physiologiques, à la différence de ce qui a été décrit avec les antipsychotiques.
Le profil de tolérance semble aussi influencé par les caractéristiques de base des patients : une pression artérielle systolique plus élevée, une augmentation des transaminases et une glycémie plus importante sont associées au surpoids initial ou à l’âge avancé. Par ailleurs, les tricycliques (amitriptyline, maprotiline) sont les plus fréquemment associés à une prise de poids significative, en lien probable avec leur activité antihistaminique H1 et antagoniste 5-HT2C. À l’inverse, certaines molécules comme la paroxétine ou la duloxétine réduisent modérément le poids, tout en augmentant les marqueurs lipidiques ou glycémiques, illustrant une dissociation entre variation pondérale et altérations métaboliques.
Une synthèse rigoureuse pour guider la personnalisation du traitement antidépresseur
Les données proviennent d’une méta-analyse en réseau de grande ampleur, fondée sur des essais randomisés en monothérapie d’une durée médiane de 8 semaines. La qualité méthodologique était globalement élevée, avec un faible risque de biais pour la majorité des études incluses. Les données physiologiques analysées portaient sur 30 antidépresseurs et incluaient des paramètres cardiovasculaires, métaboliques, électrolytiques, hépatiques et rénaux. Des régressions ont permis d’identifier des facteurs d’amplification du risque selon les profils cliniques. Bien que certains effets n’aient pas été observés dans les essais (notamment l’hyponatrémie avec le citalopram ou l’allongement du QTc), ces différences avec les études observationnelles s’expliquent par des populations plus jeunes et moins comorbides dans les essais contrôlés.
Selon les auteurs, ces résultats permettent donc de mieux anticiper le risque physiologique à court terme chez les patients en monothérapie. Ils invitent à intégrer ces données dans les algorithmes de prescription, notamment chez les patients à haut risque cardiovasculaire ou métabolique, et à privilégier une approche individualisée du choix d’antidépresseur, fondée à la fois sur l’efficacité clinique, les préférences du patient et le profil de tolérance attendu.
Des études complémentaires sur la persistance de ces effets au long cours sont nécessaires, ainsi que des analyses sexospécifiques encore trop rares. En attendant, ces données constituent un outil précieux pour le dialogue médecin-patient et la décision partagée.