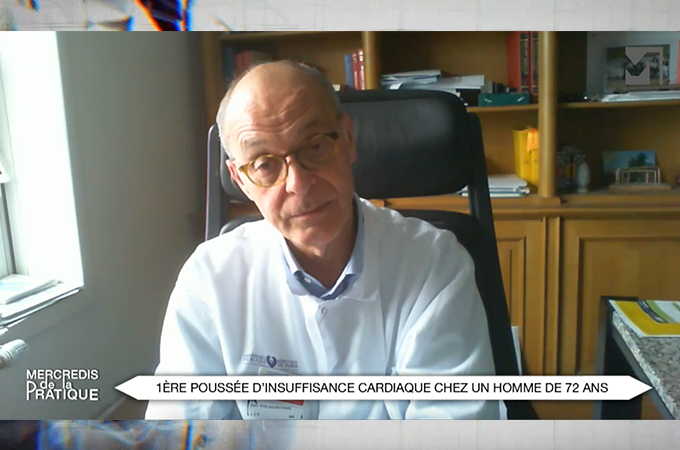Pneumologie
Pneumopathies interstitielles diffuses associées aux connectivites, des recommandations de pratique clinique européennes !
Un groupe d’experts européens se sont réunis pour élaborer des recommandations précises sur la prise en charge des pneumopathies interstitielles diffuses secondaires aux connectivites. Dues guidelines ont été écrites de manière spécifique pour chaque type de connectivite. D’après un entretien avec Bruno CRESTANI.

Une étude dont les résultats sont parus en août 2025 dans l’European Respiratory Journal, a cherché à élaborer des recommandations de pratique clinique actualisées sur les pneumopathies interstitielles associées aux connectivites. Il s’agit d’un travail international, principalement européen, au cours duquel plusieurs spécialistes se sont réunis, notamment des rhumatologues, des internistes et des pneumologies pour faire un screening et établir un consensus. Les auteurs de cette étude ont fait un travail colossal, limité par la faiblesse du niveau de qualité des données disponibles, ce qui a rendu conditionnelles la plupart des recommandations. Des recherches complémentaires seront encore nécessaires sur les zones comportant peu d’évidences. Des différences subtiles peuvent être présentes, liées notamment à la variabilité du niveau économique des différents pays.
Un travail multidisciplinaire colossal
Le professeur Bruno CRESTANI, chef du service de pneumologie de l’Hôpital Bichat Claude-Bernard, coordonnateur du Centre de Référence des Maladies Pulmonaires Rares, à Paris, et co-auteur de ce travail, explique que l’élaboration de ces recommandations de pratiques cliniques représentait un travail colossal très ambitieux, à l’initiative de l’ERS et de l’EULAR. Il s’agit un travail européen à ambition mondiale, qui a duré plus de 3 ans, ayant inclus un nombre important de représentants non seulement européens, mais aussi américains et australiens. Il s’agissait de pneumologues, rhumatologues, radiologues et anatomo-pathologistes ainsi que deux représentants de patients. Ce travail de de longue haleine a été financé par l’ERS, principalement réalisé par visioconférence, avec l’aide de jeunes investigateurs, pneumologues et rhumatologues qui ont joué un rôle important dans le recueil et l’analyse de la bibliographie. L’analyse de la littérature a été systématique et exhaustive, 25 PICO et 28 questions narratives ont été construits. Des méthodologistes de l’EULAR et de l’ERS sont également intervenus. Bruno CRESTANI insiste sur le caractère ambitieux de ce travail qui a incus toutes les connectivites. Celles-ci ont été divisées en quatre groupes : la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, les myopathies inflammatoires et enfin un quatrième groupe comportant les connectivites mixes, les lupus ou encore le syndrome de Sjögren, pour lesquelles il existe moins de données objectives. Des recommandations pour le dépistage, le diagnostic, le traitement et le dépistage ont été élaborées spécifiquement pour les quatre groupes de connectivites.
Des recommandations pour le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi
Bruno CRESTANI explique, qu’en terme de dépistage, le scanner thoracique reste l’outil de référence, l’échographie pulmonaire n’étant pas, aujourd’hui, un examen suffisamment validé. Le scanner doit être systématiquement réalisé chez les patients atteints de pneumopathie interstitielle secondaire à une sclérodermie ou une connectivite mixte. Dans les autres cas, l’indication du scanner est évaluée en fonction des facteurs de risque individuels, qui ont été listés pour chacune des connectivites. Pour les recommandations diagnostiques, le lavage alvéolaire est indiqué seul met dans le but d’écarter un diagnostic alternatif et la biopsie pulmonaire n’a pas sa place sauf en cas de présence de nodule ou d’image anormale. En résumé, tout patient ayant une connectivite avec un diagnostic de pneumopathie interstitielle diffuse doit bénéficier d’un scanner thoracique, d’EFR avec DLCO, d’un test démarche de 6 minutes avec mesure de la saturation en oxygène et d’un recueil précis de ses symptômes pour évaluer la sévérité initiale. Concernant les recommandations de suivi, le délai de répétition des EFR et du scanner est décidé en fonction de la durée d’évolution de la maladie et selon son fort ou faible risque de progression. En cas de sclérodermie, les EFR sont répétées tous les 3 à 6 mois pendant 3 à 5 ans, associées à un scanner annuel, chez les patients à haut risque. Pour les patients à faible risque, ces examens sont en moyenne deux fois plus espacés. L’objectif reste d’essayer de limiter au maximum les irradiations liées au scanner. Bruno CRESTANI ajoute que, pour les recommandations thérapeutiques, des tableaux ont été élaborés pour chaque maladie. Il cite comme exemple la sclérodermie pour laquelle un traitement spécifique anti-fibrosants comme le nintédanib peut être proposé en cas de fibrose étendue à plus de 10% sur le scanner. Les patients à fort risque peuvent également bénéficier de l’association d’un immunosuppresseur et d’un anti-fibrosant en première intention. En résumé, une proposition par maladie est faite en fonction de la sévérité de l’atteinte pulmonaire et des signes extra-respiratoires
En conclusion, ces recommandations de pratiques cliniques permettent d’éclaircir l’approche diagnostique et le traitement des patients porteurs de connectivites avec atteinte pulmonaire interstitielle diffuse. La diffusion des résultats de ce travail de grande ampleur devrait grandement faciliter la prise en charge de ces patients.