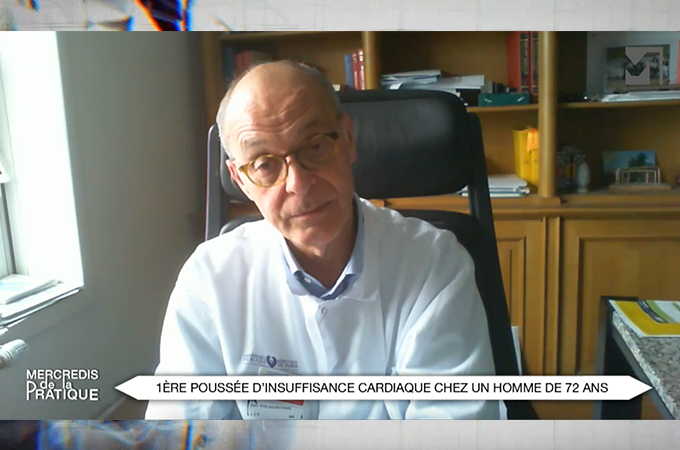Pédiatrie
Imagerie diagnostique chez l'enfant : majoration du risque de cancer hématologique
Chez l’enfant et l’adolescent, l’exposition cumulative aux rayonnements ionisants liés à l’imagerie diagnostique est associée à une augmentation dose-dépendante du risque de cancer hématologique. Si le risque absolu reste bas, la justification stricte de ces examens est essentielle, en particulier pour les scanners.

- SbytovaMN/istock
Les progrès réalisés dans le domaine de l'imagerie médicale ont considérablement amélioré le diagnostic, le dépistage et le traitement d'un large éventail de pathologies., le scanner (ou tomodensitométrie) représente la principale source d’irradiation médicale. Les enfants, plus radiosensibles et avec une espérance de vie longue, sont particulièrement concernés par les conséquences éventuelles de ces examens.
L’étude de cohorte rétrospective RIC, menée dans six systèmes de santé américains et en Ontario, a suivi 3 724 623 enfants nés entre 1996 et 2016 (35,7 millions de personnes-années, suivi moyen 10,1 ans).
Selon les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine, en quantifiant la dose cumulée sur la moelle osseuse active et en appliquant un décalage d’exposition de 6 mois, les auteurs observent une relation linéaire dose–dépendante pour le risque de l’ensemble des cancers hématologiques : excès de risque relatif par 100 mGy = 2,54 (IC à 95 % 1,70–3,51 ; p<0,001). Un niveau d’exposition de 30 mGy est associé à un RR = 1,76 (1,51–2,05) versus 0 mGy. Au total, 2961 cancers hématologiques ont été diagnostiqués, majoritairement lymphoïdes (79,3 %).
RR = 1,41 pour 1 à 5 mGy, 1,82 pour 15 à 20 mGy et 3,59 pour 50 à 100 mGy
Par comparaison à l’absence d’exposition, le risque de cancer augmente graduellement dès les faibles doses : RR = 1,41 pour 1 à 5 mGy, 1,82 pour 15 à 20 mGy et 3,59 pour 50 à 100 mGy. Parmi les enfants exposés à 1 mGy ou moins, la dose moyenne est de 14,0 ± 23,1 mGy (équivalant à un scanner crânien : 13,7 mGy) et de 24,5 ± 36,4 mGy chez ceux avec cancer. Les modalités les plus contributrices incluent l’angiographie tête/cou (dose moyenne 30,8 mGy) et le scanner crânien ; à l’inverse, la radiographie standard délivre des doses très faibles (≤ 0,03 mGy).
Moins de 1% des enfants dépassaient 30 mGy. À ce niveau de dose, l’excès d’incidence cumulative d’un cancer hématologique à 21 ans est estimé à 25,6/10 000. La fraction attribuable au sein de la cohorte atteint 10,1 % (5,8–14,2), et est portée surtout par les examens à forte dose.
Pris ensemble, ces résultats indiquent un risque individuel faible mais mesurable, et confirment des signaux rapportés en Europe, tout en élargissant le niveau de preuve à l’Amérique du Nord et à un spectre d’examens au-delà du scanner.
Justifier chaque scanner chez l’enfant et privilégier les alternatives
La force de l’étude RIC tient à son ampleur en termes de population étudiée, au chaînage dossiers–registres de cancers, et à la dosimétrie individualisée de la moelle osseuse. Pour limiter les biais de causalité inverse et de confusion par indication, les auteurs ont appliqué un lag de 6 mois et opéré des revues ciblées des comorbidités ; néanmoins, en tant qu’étude observationnelle, un résidu de confusion reste possible, d’autant que les groupes de forte dose comportent peu de cas (par exemple 31 cas entre 30 et <50 mGy). La généralisabilité est bonne pour des systèmes de soins comparables, mais dépend des pratiques locales d’imagerie.
Selon un éditorial associé, ces données soutiennent une stratégie « ALARA » renforcée : justifier chaque examen chez l’enfant et l’adolescent, préférer l’échographie ou l’IRM quand elles offrent une information équivalente, optimiser les protocoles pédiatriques (kV/mAs, champs restreints, itérations reconstruites), éviter les répétitions non nécessaires et suivre la dose cumulée. La décision partagée avec les familles doit mettre en balance les bénéfices diagnostiques souvent majeurs et un surcroît de risque absolu faible.