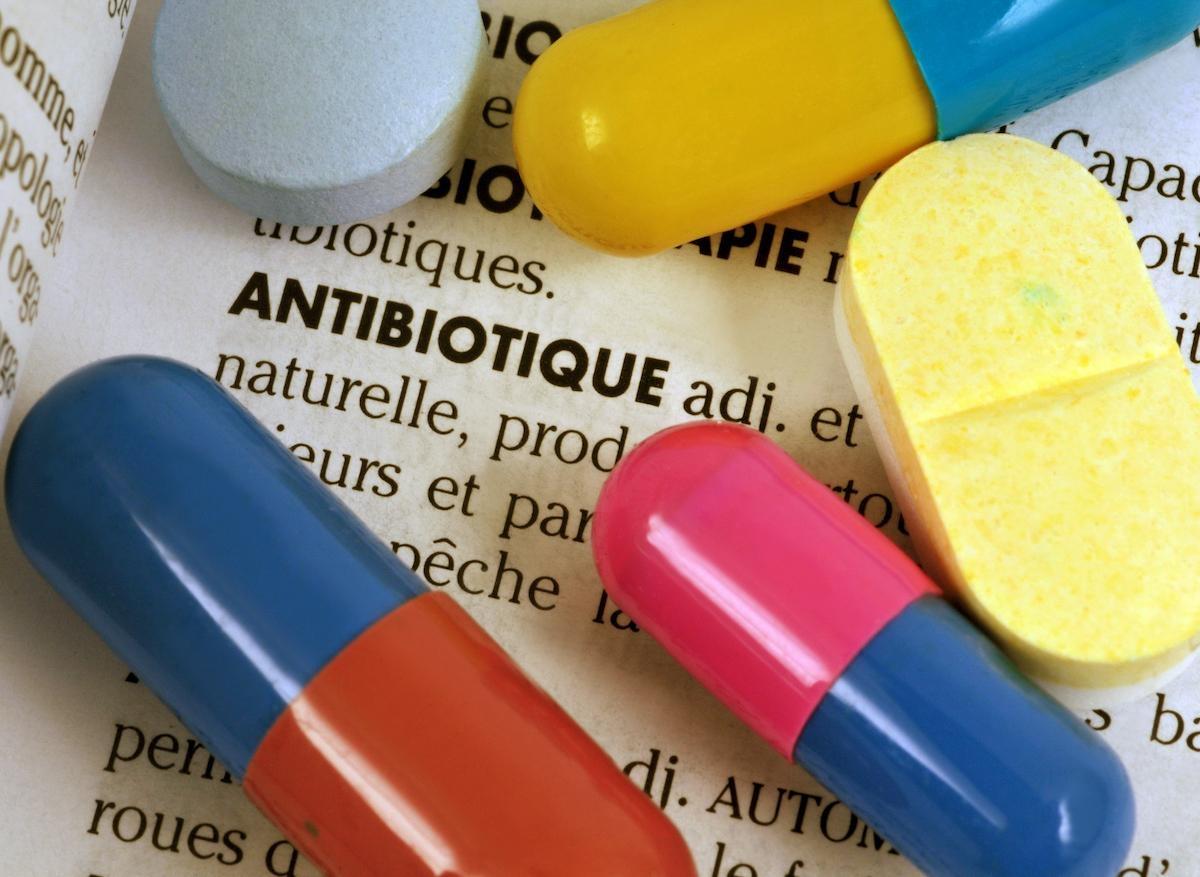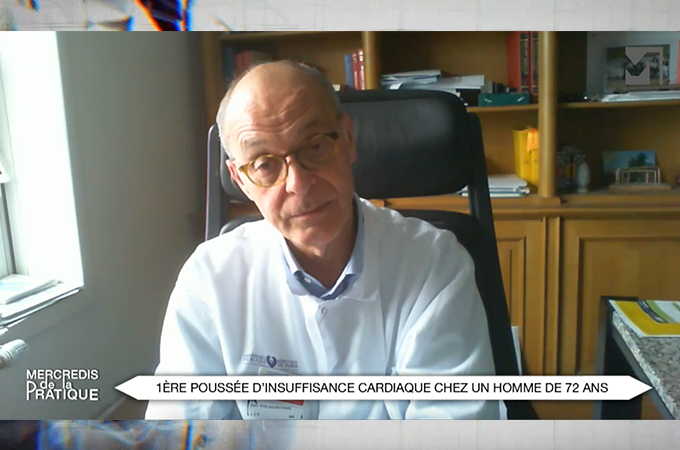Allergologie
Allergies : les différences d’incidences entre la ville et la campagne expliquées
Chez le nourrisson, l’émergence d’une sous‑population Th2 effector‑memory particulière (Th2B) distinguerait les enfants urbains qui développeront une dermatite atopique, une allergie alimentaire ou une sensibilisation. À l’inverse, les bébés issus d’un milieu agricole sans allergie auraient plus de lymphocytes T régulateurs, suggérant que l’environnement et le microbiote intestinal moduleraient précocement l’immunité. Cette découverte ouvre la voie à une prévention personnalisée de l’allergie.

- Nemer-T/istock
L’essor des maladies allergiques s’accompagne d’un biais Th2 dont la genèse, dès la première année de vie, reste mal comprise. Deux cohortes de naissance à risques contrastés d’allergie ont été comparées : nourrissons urbains de Rochester (antécédents atopiques familiaux) et nourrissons de la communauté agricole Old Order Mennonite (OOM), faiblement allergiques.
Des scientifiques ont découvert qu'un sous-ensemble de cellules immunitaires non caractérisé précédemment pourrait jouer un rôle essentiel dans le développement des maladies allergiques et expliquer les différences entre les populations urbaines et rurales. Cette découverte, publiée dans la revue Allergy, apporte un nouvel éclairage sur la façon dont le système immunitaire se forme au cours de la vie précoce et explique pourquoi les enfants vivant en milieu urbain sont plus sujets aux allergies que ceux vivant en milieu rural.
L'étude a mis en évidence une sous-population unique de cellules T (cellules T helper 2 (Th2)) avec des caractéristiques moléculaires distinctes (CD25⁺CD127⁺CD161⁻CRTH2⁺). Ces cellules T pro-allergiques seraient plus inflammatoires que tout ce qui a été décrit précédemment dans ce contexte. Elles ont été trouvées plus fréquemment chez les nourrissons urbains qui ont développé par la suite des allergies, ce qui suggère qu'elles pourraient être un biomarqueur prédictif, voire un facteur mécanistique des maladies allergiques.
Des différences immunorégulatrices marquées
Grâce à la cytométrie plein spectre, puis au clustering SWIFT haute dimension, les auteurs ont identifié une population CD4⁺ mémoire effectrice CD49d⁺CCR4⁺CRTH2⁺, dépourvue de CD161 mais co‑exprimant CD25 et CD127. Cette population Th2B apparaîtrait dès 6 mois chez les nourrissons urbains. Sa fréquence serait significativement augmentée (p < 0,01) chez ceux qui déclencheront ultérieurement dermatite atopique, allergie alimentaire ou sensibilisation médiée par IgE à 12 mois, alors qu’elle reste basse dans le groupe des nourrissons de la campagne sans allergie.
Les analyses single‑cell RNA‑seq révèlent que cette population Th2B partage la signature IL‑5/IL‑9 des Th2 A mais surexprime FOXP3 et CISH et sécrète davantage d’IL‑2 et de TNF‑α, témoignant d’un phénotype pro‑inflammatoire hybride différent des Th2A. À l’opposé, plusieurs sous‑populations T régulatrices (Treg naïves HELIOS⁺ et Treg mémoire TIGIT⁺) sont enrichies chez les nourrissons de la campagne et chez les nourrissons non atopiques (différence moyenne +40 %, p < 0,05).
Une étude prospective sur sang de cordon puis sur sang périphérique
Les données proviennent de l’étude ZOOM financée par le National Institute of Health : prélèvements de sang de cordon puis périphériques à 6 et 12 mois, comparant environ 100 enfants urbains à 80 nourrissons des campagnes. La combinaison cytométrie 26 couleurs, scRNA‑seq et dosage multiplex des cytokines confère une résolution fonctionnelle élevée, mais la taille modeste et l’origine géographique unique limitent la généralisation.
Bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour identifier une cause possible, les auteurs émettent l'hypothèse que les différences dans le développement du microbiome intestinal entre les deux populations et une plus grande exposition aux bactéries « saines » chez les enfants ruraux pourraient être un facteur déclenchant. L'environnement agricole, riche en exposition microbienne, semble favoriser le développement d'un système immunitaire plus tolérant. Parallèlement, l'environnement urbain pourrait favoriser l'émergence de cellules immunitaires prédisposées à l'inflammation allergique.
Des applications immédiates et des pistes de recherche
D’ores et déjà, il serait possible de réaliser un repérage précoce des enfants à risque d’allergie : un dosage Th2B à 6 mois pourrait prédire la trajectoire atopique et justifier une intervention ciblée (diversification alimentaire, probiotiques, programmes d’éducation). En recherche translationnelle, il est possible d’envisager étudier les déterminants microbiotiques et environnementaux de cette expansion Th2B, ce qui pourrait aboutir à des stratégies de modulation (synbiotiques, exposition fermière contrôlée).
Des essais multicentriques devront valider la valeur prédictive de cette population Th2B et préciser la fenêtre de plasticité immunitaire. Le couplage séquençage‑métagénomique permettra de lier microbiome intestinal, environnement rural et polarisation T cellulaire. Ainsi se dessine une médecine préventive des allergies fondée sur la signature immunitaire individuelle dès la première année de vie.