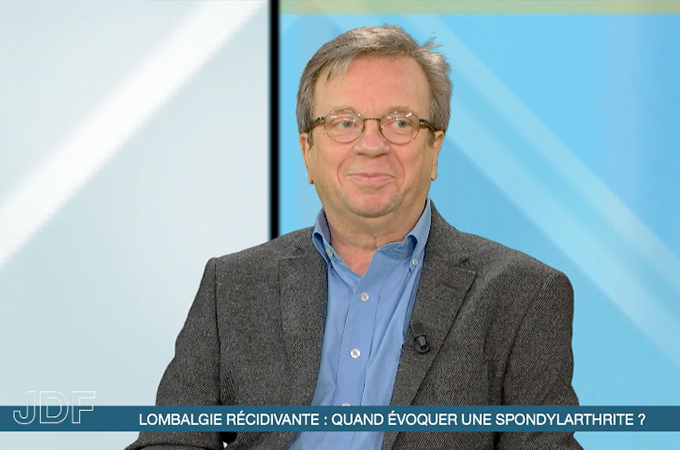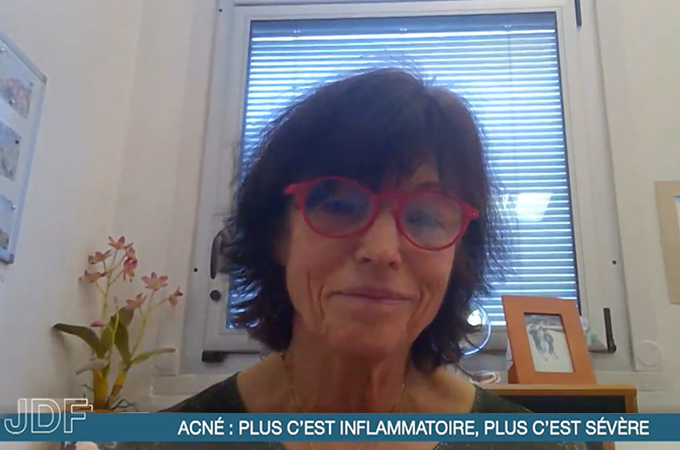Oto-rhino-laryngologie
Surdité congénitale : une thérapie génique restaure une audition chez l'enfant
La délivrance, via la fenêtre ronde, d’un vecteur viral AAV-Anc80L65 codant l’otoferline fait chuter de 54 dB le seuil auditif moyen chez dix patients de 1,5 à 23,9 ans atteints de surdité congénitale (DFNB9), sans signal de toxicité grave. Un seul geste, éventuellement bilattéral, pourrait donc différer, voire remplacer, un implant cochléaire pour cette étiologie génétique.

- Mariia Vitkovska/istock
La surdité congénitale (DFNB9), qui représente près de 8 % des surdités neurosensorielles congénitales, résulte de mutations bialléliques d’un gène appelé OTOF, entraînant une déficience en otoferline, une protéine qui joue un rôle essentiel dans la transmission des signaux auditifs de l'oreille au cerveau. Après des réussites de la thérapie génique limitées au nourrisson, la plasticité auditive au-delà de la petite enfance demeurait incertaine.
Pour l’évaluer, cinq centres ORL chinois associés au Karolinska Institutet, ont conduit un essai de phase I/II ouvert incluant dix patients (âge moyen : 9,4 ± 7,5 ans ; extrêmes 1,5-23,9 ans). Sous anesthésie générale, chacun a reçu une dose unique de 1 × 10¹² vecteurs génomiques AAV-OTOF, injectée dans la scala tympani, sans corticothérapie systémique.
Selon les résultats publiés dans Nature Medicine, à six mois, le pure-tone average (PTA) comportemental moyen est passé de 106 ± 9 dB à 52 ± 30 dB ; sept sujets sur 10 sont désormais < 60 dB, seuil compatible avec une conversation sans lecture labiale.
Récupération fonctionnelle en moins d’un mois
Quatre semaines suffiraient pour obtenir 80 % du gain final. Les clic-ABR chutent de 101 ± 1 à 48 ± 26 dB, les bursts-ABR de 91 ± 4 à 57 ± 19 dB et l’ASSR de 80 ± 14 à 64 ± 21 dB. Les clic- et burst-ABR mesurés à M4 prédisent étroitement le PTA à M6 (R² = 0,68 et 0,73), alors que l’ASSR reste peu corrélée (R² = 0,17).
L’âge module fortement l’effet de cette thérapie génique : les enfants de 5 à 8 ans gagnent en moyenne 63 dB et comprennent spontanément des phrases courantes ; les adolescents et jeunes adultes récupèrent 25 dB, améliorant surtout la perception des signaux d’alerte et la localisation spatiale. Aucun patient n’a perdu son bénéfice initial sur les 12 mois de suivi.
La tolérance est favorable avec 162 événements indésirables de grade I/II qui ont été recensés, dominés par une neutropénie transitoire (16 cas) normalisée en moins de 7 jours. Il n’y a pas eu de vertige, de vestibulopathie ou de baisse auditive tardive. Chez un participant traité secondairement sur l’oreille controlatérale, l’efficacité et la tolérance ont été identiques, suggérant la faisabilité d’une stratégie bilatérale séquencée.
Méthodologie robuste et perspectives cliniques
Le protocole prévoit un suivi sur cinq ans, combinant audiométrie comportementale et objective harmonisée, imagerie à haute résolution et surveillance immunovirologique afin de détecter précocement toute otopathologie inflammatoire ou perte d’efficacité. L’absence de bras contrôle et la petite taille de cohorte limitent la puissance statistique, mais la cohérence inter-sites, l’utilisation d’outils standardisés et la couverture d’un large éventail d’âges renforcent la validité externe.
Selon les auteurs, ces données plaident pour l’intégration du génotypage OTOF dans le dépistage néonatal auditif, permettant une intervention causale avant la dégénérescence des cellules ciliées internes et la pose d’un implant. Les prochaines étapes incluront un essai international randomisé comparant la thérapie génique à l’implantation dans les surdités bilatérales, ainsi que le développement de capsides capacitaires capables de véhiculer des gènes plus longs (GJB2, TMC1) afin d’étendre cette approche à la majorité des surdités génétiques autosomiques récessives.