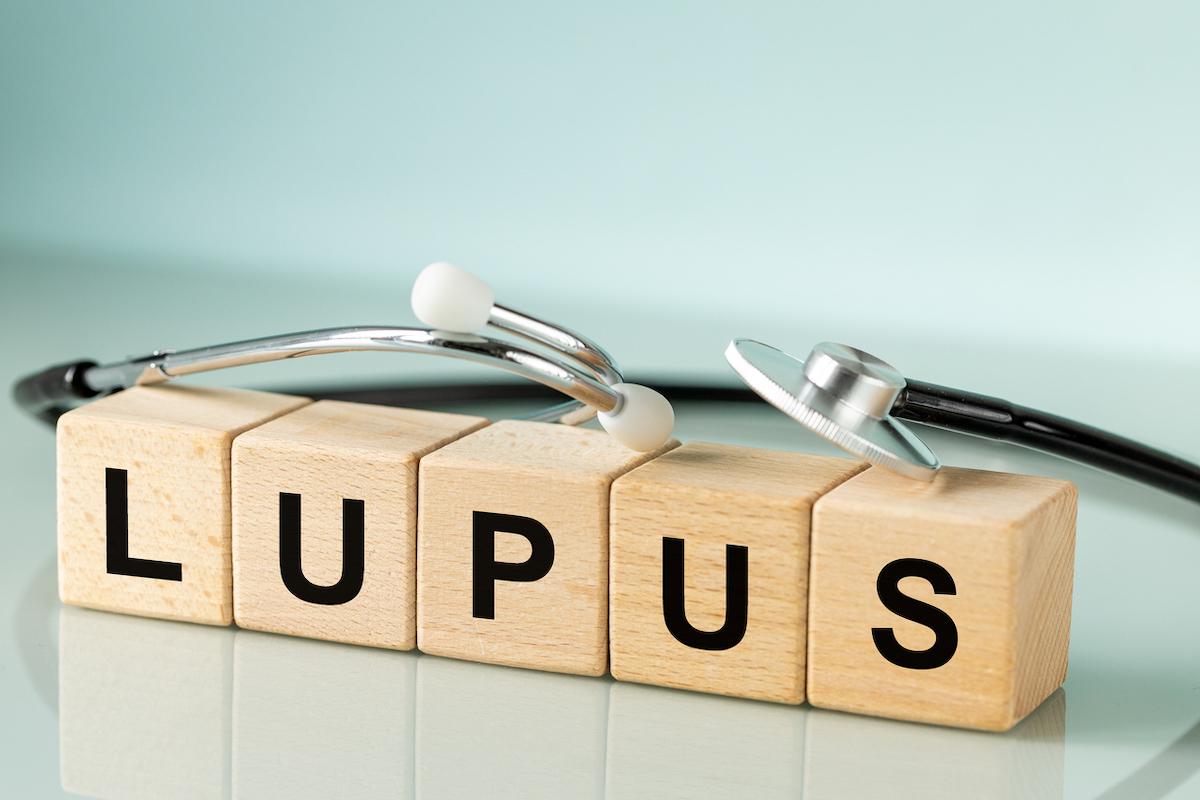Interview du week-end
Leucémie : “Si on veut avancer, il faut des chercheurs avec des compétences différentes qui regardent dans la même direction”
L’institut de la Leucémie, Institut Hospitalo-Universitaire fondé en 2023, s’est donné pour objectif de parvenir à guérir les leucémies à tous les âges de la vie. Sa soirée de lancement, organisée il y a tout juste un mois, a été l’occasion de faire le point avec l’hématologue Pr Lionel Adès, porte-parole de l’IHU, sur les avancées prometteuses et les challenges rencontrés par la recherche avec ce cancer du sang.
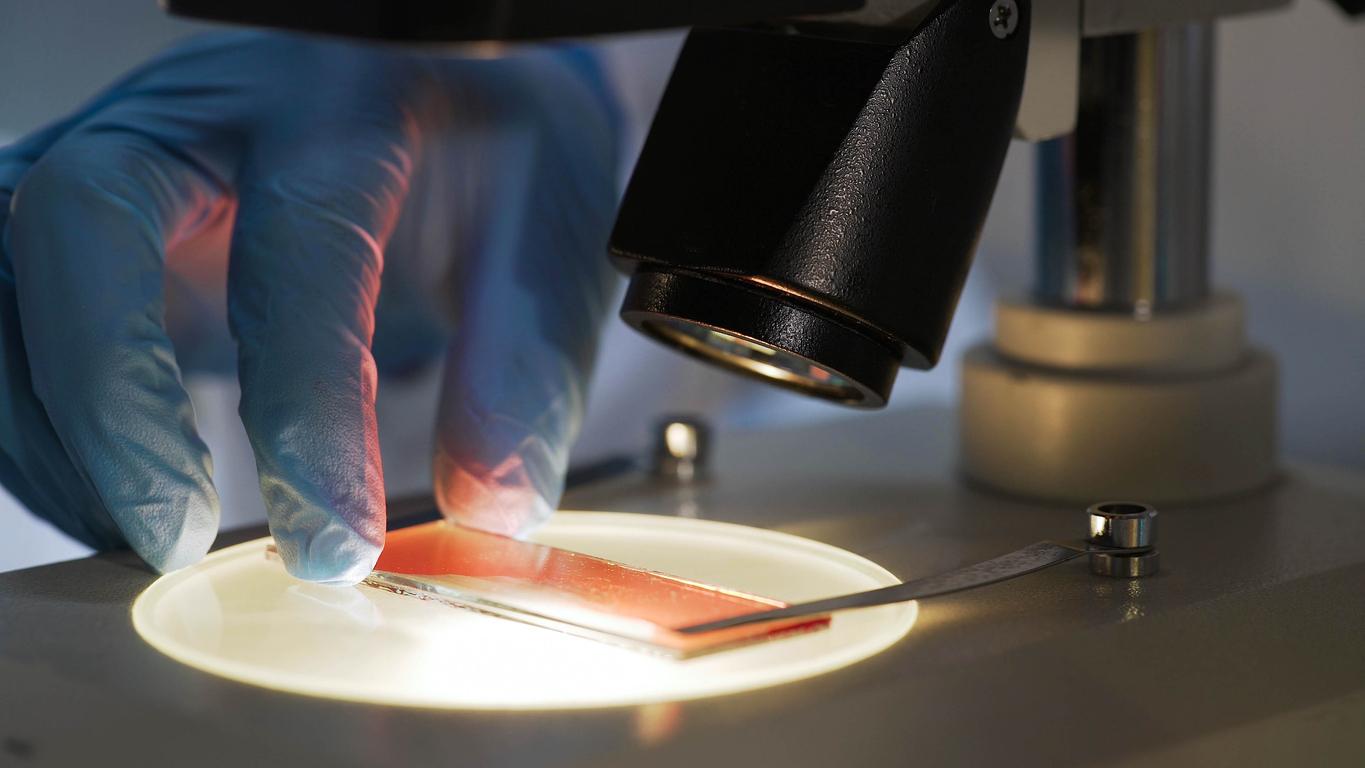
- Par Sophie Raffin
- Commenting
- Motortion/istock
Chaque année, entre 9.000 et 10.000 nouveaux cas de leucémies, ainsi que plus de 9.000 cas de syndromes myéloprolifératifs et dysplasiques, pathologies qui prédisposent au cancer du sang, sont diagnostiqués en France. Le Pr Lionel Adès du service d'hématologie seniors de l'hôpital Saint-Louis a rejoint l’institut de la Leucémie - créée par l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris, l’INSERM, le Collège de France et l’Université Paris Cité - pour tenter d’améliorer la prise en charge et les soins offerts à ces patients.
- Pourquoi docteur : Love Story, L’arbre de Noël ou Oscar et la Dame rose… de nombreuses œuvres cinématographiques ou littéraires ont pour héros des enfants ou jeunes adultes atteints d’une leucémie. Ce qui conduit beaucoup de personnes à voir la leucémie comme un cancer infantile. Est-ce que cette représentation est correcte ?
Pr Lionel Adès : Les leucémies aiguës sont des cancers du sang, plus exactement, des cancers touchant la moelle osseuse, l'organe qui produit les cellules du sang. Il y a deux grandes familles : la leucémie aiguë lymphoblastique et la leucémie aiguë myéloïde.
La leucémie aiguë lymphoblastique est la mieux connue du grand public. En grande partie, car elle touche, en effet, surtout l’enfant. Il s’agit d’ailleurs du cancer infantile le plus fréquent. Toutefois, les adultes peuvent aussi développer la maladie. Il y a un deuxième pic de diagnostic vers 50-60 ans. On a aussi beaucoup entendu parler de cette leucémie, puisque des succès thérapeutiques considérables ont été enregistrés sur les 20 dernières années. Aujourd'hui, la majorité des enfants qui sont atteints d’une leucémie aiguë lymphoblastique guérissent.
Mais, cela ne doit pas faire oublier l’autre forme de la maladie : la leucémie aiguë myéloïde, aussi appelée leucémie aiguë myéloblastique. Si elle existe chez l’enfant, sa fréquence augmente surtout avec l'âge. Elle est diagnostiquée en moyenne aux alentours de 65 ans. Elle est d’ailleurs généralement décrite comme une maladie du vieillissement. Les guérisons sont aussi de plus en plus nombreuses, même si c'est plus difficile que pour la leucémie aiguë lymphoblastique.
Leucémie : "Les progrès dans la prise en charge ont été faits sur plusieurs axes"
- Vous avez dit qu’il y avait eu beaucoup d'avancées dans les traitements de la leucémie. Quelles sont-elles exactement ?
Les progrès dans la prise en charge des cancers du sang ont été faits sur plusieurs axes. Le premier est sur l'amélioration des chimiothérapies. Les molécules de chimiothérapie que nous avons sont connues depuis longtemps… mais il y a eu des progrès considérables dans l’identification de la combinaison de chimiothérapie la plus efficace pour le patient : les molécules recommandées, la séquence, la dose, etc.
Il y a aussi eu des avancées scientifiques. Les premiers progrès qui ont été faits, tournent autour de la greffe, un des principaux traitements de la leucémie. Son accessibilité a été grandement améliorée ces dernières années. Quand j'étais jeune médecin, l'âge maximal pour bénéficier d’une greffe, c'était aux alentours de 40 ans, À l’époque, on estimait qu'au-delà, c'était trop toxique pour l'organisme. Aujourd'hui, on peut la faire jusqu'à 70 ans et plus. Comme la médiane d'âge des leucémies de l'adulte est de 65 ans, on peut maintenant soigner davantage de personnes grâce à la greffe de moelle.
Le développement de nouveaux médicaments comme les cellules CAR-T ont aussi changé la donne. Grâce à elles, on soigne le patient en utilisant son propre système immunitaire. On prélève ses lymphocytes pour les modifier au laboratoire. On leur “apprend” à reconnaître les cellules leucémiques et à les attaquer. Une fois que les lymphocytes ont été modifiés, on les réinjecte. Ce traitement a grandement amélioré la prise en charge des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique, mais aussi de lymphomes et de myélomes. Nous n’avons pas encore identifié de cibles pour toutes les leucémies. Néanmoins, cela avance.
Enfin, le dernier point : grâce à des travaux de recherche, on est parvenu à identifier dans les cellules tumorales de la leucémie des "vulnérabilités". C'est-à-dire des gènes ou des protéines qui sont exprimés de manière anormale. Les chercheurs ont repéré les molécules capables de viser spécifiquement telle ou telle anomalie. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Contrairement à la chimiothérapie où le traitement n'est pas du tout sélectif et tue toutes les cellules, bonnes comme mauvaises, les thérapies ciblées vont aller, comme leur nom l'indique, attaquer précisément la cellule d'intérêt leucémique.
La difficulté de cette piste thérapeutique est la même que pour les cellules CAR-T : cela marche bien pour les malades présentant les cibles déjà identifiées. Mais elle n’offre pas de solution pour ceux qui n’ont pas ces cibles. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.
Institut de la leucémie : "16 équipes de recherche, 10 services cliniques et 4 laboratoires d'analyses"
- Quels sont les challenges et difficultés rencontrés par les équipes de recherche sur la leucémie ?
Il y a deux types de recherches : la recherche clinique qui teste de nouveaux médicaments ou de nouvelles approches thérapeutiques (anciens médicaments, nouvelles modalités d'administration), et, à l'autre extrémité du spectre, la recherche fondamentale. Elle travaille en laboratoire à partir de cellules de patients ou des lignées cellulaires. Une des problématiques est que ces deux approches ne travaillent pas beaucoup ensemble et communiquent également peu. L'Institut essaye de changer ça. Il travaille à favoriser le dialogue et les interactions entre l'hôpital et la recherche afin de transformer la prise en charge des patients atteints de leucémies à tous les âges de la vie.
Les échanges entre les équipes existaient déjà, mais ils ont besoin d'être un peu mieux fédérées. Si on veut avancer, il faut des gens avec des compétences différentes en clinique, biologie et recherche qui regardent dans la même direction.
Nous avons aussi besoin de fonds, parce que la recherche coûte cher. La moindre expérience en recherche fondamentale peut coûter des centaines de milliers d'euros et un essai clinique peut grimper à plusieurs millions d'euros.
Pour atteindre ces objectifs, l’institut de la leucémie peut déjà compter sur 16 équipes de recherche, 10 services cliniques et 4 laboratoires d'analyses. Ils sont sur différents sites : Saint-Louis, Robert-Debré, Necker, Avicennes et Cochin. Il y a aussi une équipe à Polytechnique pour les travaux plus mathématiques et une équipe au CEA. Cela fait environ entre 300 et 400 collaborateurs et plus de 1.200 patients pris en charge.
Cancer du sang : "Nous cherchons aussi à avoir les réponses aux questions des patients"
Et quelles sont les recherches les plus prometteuses ?
Un projet de l’institut de la leucémie qui arrive à maturité est DYNHAEMICS, financé par la Fondation ARC et dirigé par le Pr Hugues de Thé. Il essaye de comprendre comment la chimiothérapie intensive fonctionne réellement à l'échelle de la cellule du malade. En effet, c'est tout à fait paradoxal, mais on ne sait pas très bien comment les traitements - aussi bien les chimiothérapies intensives que les non-intensives - marchent réellement. Or, c’est important de bien comprendre l’ensemble des mécanismes. Cela permet de déterminer précisément quels patients sont les plus susceptibles de les recevoir, plutôt que de lancer les cycles de traitement et d’attendre les résultats.
Nous cherchons aussi à avoir les réponses aux questions posées par les patients lors du diagnostic : "Docteur, pourquoi ça m'arrive à moi ?", "Pourquoi j'ai une leucémie ?". Pour le moment, nous ne les avons pas. On connaît des causes, mais dans 90 % des cas, nous ne savons pas l'origine de la maladie. Or, c’est un point important. En plus de pouvoir apporter des explications aux patients, cela donne des moyens pour prévenir la leucémie. Le Pr Marie Sébert travaille, par exemple, sur les facteurs génétiques qui conduisent à développer des leucémies aigües. Les identifier précisément permettrait de surveiller les patients à risque et peut-être de prévenir la maladie.
Pour ma part, je travaille sur la cohorte eTHEMA qui réunit les données cliniques et biologiques de patients atteints de leucémies. C'est intéressant de travailler sur des modèles de souris ou des lignées cellulaires. Mais à un moment, on a besoin de se pencher sur les cellules d'un vrai patient. On a donc créé cette cohorte où nous intégrons les données anonymisées des malades (avec leur accord). Cela contient les cellules restantes et précise le type de leucémie, son évolution, les traitements donnés…. Les chercheurs ont accès à ces prélèvements, mais aussi au devenir des patients. Toutes ces informations vont aider la recherche. Lancée il y a moins de deux ans, la cohorte compte déjà un peu plus de 500 patients avec tous les prélèvements afférents.
Un autre champ de recherche intéressant est le repositionnement de médicaments. Face à la découverte d'une vulnérabilité, vous avez deux possibilités en réalité : aller voir les biochimistes en leur disant : "voilà la serrure que j’ai trouvée, fabriquez la clé s’il vous plait", ou alors consulter le Vidal, c'est-à-dire le dictionnaire des médicaments disponibles, et regarder s’il n'y a pas une clé qui ferait l’affaire parmi les molécules déjà développées.
Cette approche est très pragmatique. Comme ces médicaments sont déjà sur le marché, il n'y a pas besoin de refaire l’ensemble des tests. On connaît déjà ses effets sur l’homme. Ça va plus vite. Toutefois, ce sont souvent des clés imparfaites. Il est mieux de trouver la “clé parfaite”, mais cette méthode a déjà permis des avancées.
Leucémie : "Ce que j'aimerais en fin de carrière, est d’arriver à ma consultation et qu’il n'y ait pas de malade"
Qu'aimeriez-vous avoir atteint en fin de carrière ? Votre rêve absolu ?
Ce que j'aimerais en fin de carrière, est d’arriver à ma consultation et qu’il n'y ait pas de malade. C'est un vœu pieux, il faut bien reconnaître. Mais, je rêve que les progrès permettent de prévenir au maximum la survenue des leucémies, qui sont des maladies terribles. Et si un cancer apparaît, il faudrait qu’on ait systématiquement la clé - non pas pour améliorer la survie du patient ce qu'on arrive déjà à faire dans beaucoup de cas - mais, pour le guérir. Et cela que le malade soit un enfant, un adulte ou une personne de 85 ans. Je ne suis pas certain que je le verrai, mais j'espère que mes collaborateurs connaîtront cela au cours de leur activité.