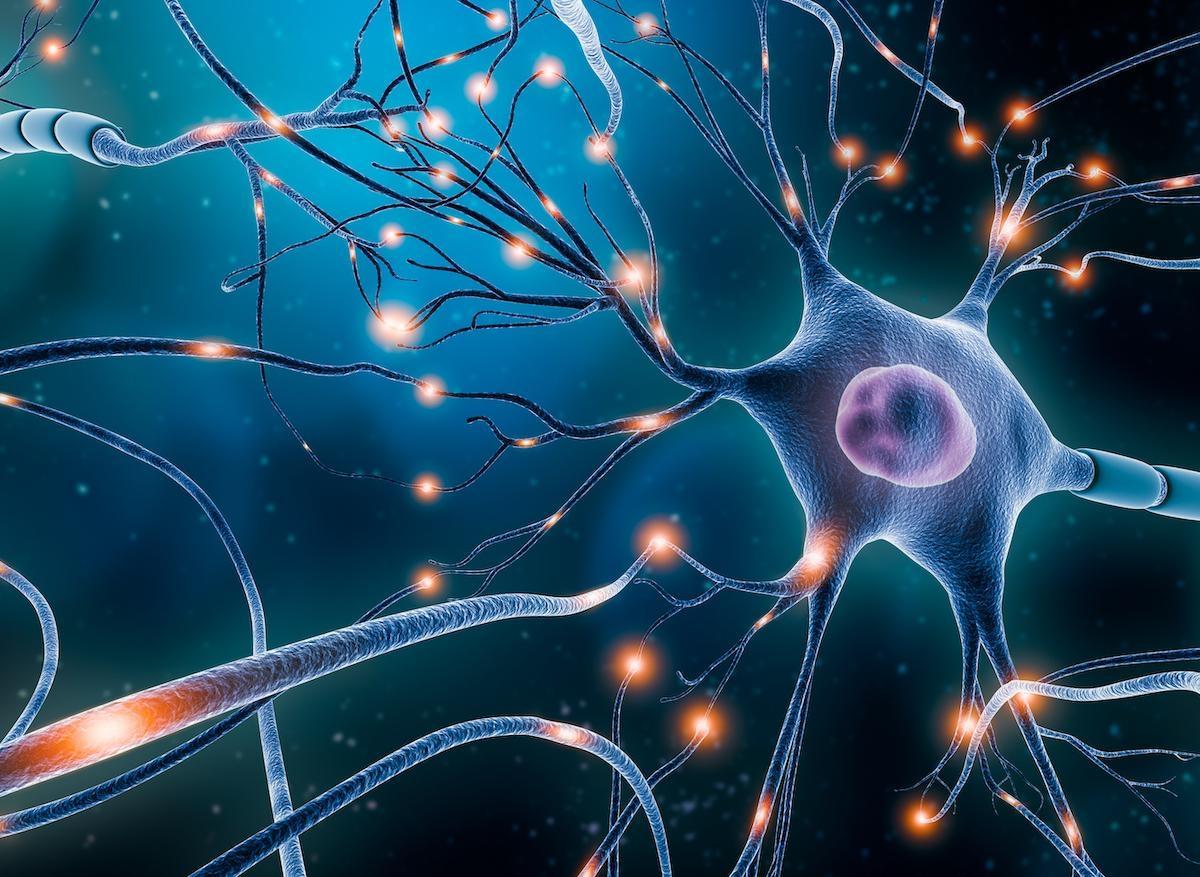Psychiatrie
Dépression saisonnière : le manque de lumière en hiver perçu par certains neurones
Certains neurones permettent au cerveau de s’adapter aux différences de durée d'exposition à la lumière au cours des changements de saisons, ce qui expliquerait notamment, la dépression saisonnière.

- Alexey Yaremenko/iStock
La durée d’exposition à la lumière selon les saisons - des journées plus longues en été, plus courtes en hiver - est depuis longtemps associée à des changements de comportements.
Le sommeil, les habitudes alimentaires, l'activité cérébrale et hormonale, tout est chamboulé et ce serait sous l'influence de l'axe noyau suprachiasmatique (NSC) - noyau paraventriculaire (NVP), qui joue un rôle clé dans le traitement des informations liées à la photopériode. Des variations saisonnières de l'expression des neurotransmetteurs du SCN et du PVN ont ainsi été observées chez l'homme et dans des modèles animaux.
L’exemple de la dépression saisonnière
La dépression saisonnière, ou "Seasonal affective disorder" en est un bon exemple. Ce type de dépression, liée à une exposition réduite à la lumière naturelle, survient généralement pendant les mois d'hiver et est beaucoup plus répandu dans les pays à l’extrême nord, comme en Scandinavie, là où les heures de soleil sont les plus courtes.
La luminothérapie s'est avérée être un traitement efficace pour traiter la dépression saisonnière. Mais jusqu’ici on ne comprenait pas vraiment le mécanisme qui provoque ces changements d’humeur.
Tout se passe au niveau des neurones
Selon une nouvelle étude, publiée dans Science Advances, cela se passerait au niveau de certains neurones. Les chercheurs de l'université de Californie à San Diego ont pu éclairer ce processus grâce à des souris.
Ils ont découvert qu’en réponse aux variations de la durée du jour, certains neurones modifient la manière dont des neurotransmetteurs clés interagissent entre eux. Ce qui déclencherait ensuite des changements de comportement et une modification de l’activité cérébrale.
En pratique, chez la souris, les neurones à neuromédine S (NMS) et à polypeptide intestinal vasoactif (VIP) du SCN auraient une plasticité des neurotransmetteurs induite par la photopériode. L'enregistrement in vivo de la dynamique calcique révèle que les neurones NMS modifient l'activité du réseau PVN en réponse à la photopériode hivernale.
Le rôle du noyau suprachiasmatique
Ces neurones sont nichés dans l'hypothalamus, la partie du cerveau impliquée dans la régulation de fonctions importantes comme la faim, la soif, le sommeil, le comportement sexuel ou les émotions. Plus précisément, dans une petite structure appelée le noyau suprachiasmatique (SCN), composé d'environ 20 000 neurones.
Le SCN serait le chronométreur du corps : il régulerait la plupart des rythmes circadiens - les changements physiques, mentaux et comportementaux qui suivent un cycle de 24 heures. Le SCN fonctionne grâce aux cellules photosensibles de la rétine qui communiquent les changements de lumière et de durée du jour à notre corps. Étant donné son rôle, le SCN pourrait devenir une cible prometteuse pour de nouveaux traitements des troubles associés aux variations saisonnières d'exposition à la lumière.