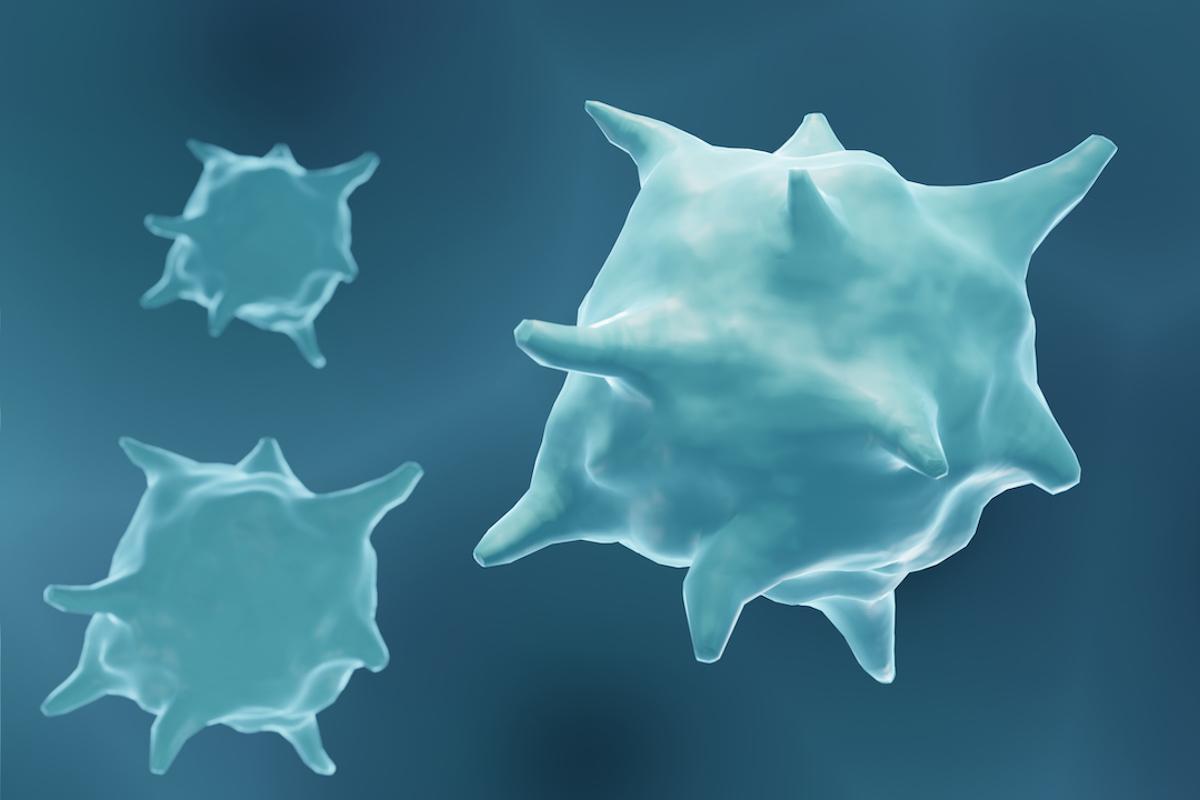Rhumatologie
Polyarthrite rhumatoïde : les oméga-3 alimentaires en réduisent le risque
Dans une large cohorte britannique, un apport plus élevé en oméga-3 à longue chaîne (acides gras polyinsaturés) est inversement et linéairement associé au risque de polyarthrite rhumatoïde (−9 à −10 % par écart-type). En parallèle, l’effet protecteur est majoré chez les sujets à risque génétique élevé, avec des interactions additives antagonistes et des médiations protéiques impliquant CD80 et TNFRSF4.

- samael334/istock
La polyarthrite rhumatoïde (PR), maladie auto-immune chronique, demeure grevée d’un excès de morbidité malgré des progrès majeurs du traitement médical. Les acides gras polyinsaturés (AGPI) dans l’alimentation, notamment les oméga-3 de poissons, modulent l’inflammation ; toutefois, les données prospectives sur l’incidence de PR manquaient.
Exploitant la cohorte UK Biobank, les auteurs ont inclus 188 597 participants indemnes de PR à l’inclusion. Après suivi médian de 9,1 ans, 1 640 cas incidents de PR ont été recensés. Chaque écart-type en plus d’apport en acide stéaridonique (SDA), acide eicosapentaénoïque (EPA), acide docosapentaénoïque (DPA) et acide docosahexaénoïque (DHA) s’accompagne d’une réduction de 9 à 10 % du risque de PR.
L’analyse de composition (qgcomp) désigne la DHA comme principal contributeur, et les taux circulants de DHA (oméga-3 à longue chaîne) confirment l’association. Selon les résultats publiés dans Arthritis & Rheumatology, cette étude prospective cas-témoin confirme un profil dose-effet cohérent, en faveur d’un rôle préventif des oméga-3 à longue chaîne.
Au-delà des acides gras polyinsaturés, l’impact de la génétique et du protéome
Chez les personnes qui ont un haut score polygénique (PRS), des apports plus élevés en n-3 (SDA, EPA, DPA, DHA) sont nettement protecteurs, alors qu’aucune association claire n’émerge chez celles à faible risque génétique (probable manque de puissance). Des interactions additives antagonistes sont observées entre DHA/DPA (et AA pour certaines analyses) et le haut score polygénique, suggérant qu’un apport suffisant en oméga-3 pourrait atténuer une prédisposition génétique défavorable. À noter, l’acide arachidonique (AA, n-6) n’est lié au risque que chez les sujets à haut risque génétique et chez les femmes, reflet possible d’un contexte immuno-hormonal spécifique.
Sur le plan mécanistique, la protéomique Olink met en évidence des voies d’immunité et d’inflammation (interactions cytokines-récepteurs, NF-κB, TNF, adhésion cellulaire, signalisation PI3K-Akt). Les analyses de médiation identifient 55 protéines expliquant en partie l’association n-3 et risque, dont CD80 (co-stimulation T) et TNFRSF4 comme médiateurs clés. L’ensemble renforce la plausibilité biologique d’un effet immunomodulateur des oméga-3.
Un signal protecteur robuste et biologiquement plausible
Il s’agit d’une cohorte prospective bien documentée au plan clinique, environnemental et génétique (UK Biobank) avec estimation des apports alimentaires (questionnaires répétés), modélisation par Cox ajustée de nombreux facteurs confondants, intégration d’un score de haut risque génétique (PRS-P, et une protéomique haute dimension pour cartographier les médiateurs. Les forces résident dans la taille d’échantillon, la durée de suivi et la triangulation apports auto-rapportés / biomarqueurs / protéines. Les limites imposent prudence : données alimentaires à l’inclusion (variations temporelles peu captées), auto-déclaration exposant à un biais de mesure, identification des cas principalement via dossiers hospitaliers (sous-détection des formes moins sévères), résidu de confusion et causalité non démontrée. La généralisabilité concerne surtout des personnes d’âge moyen, britanniques et volontaires : l’extrapolation à d’autres contextes socioculturels doit être validée.
Selon les auteurs, chez des sujets, a fortiori ceux qui sont génétiquement à risque, promouvoir un apport régulier en oméga-3 marins (EPA/DHA, de poisson ou par supplémentation validée) s’inscrit comme un levier prudent et potentiellement protecteur contre la PR, en association avec les mesures de style de vie (arrêt du tabac…). Pour la prévention secondaire et les sujets arthralgiques à auto-immunité latente, la discussion sur la qualité lipidique de l’alimentation est légitime.
Des essais randomisés pragmatiques, stratifiés sur le haut score polygénique et mesurant biomarqueurs lipidiques et protéomiques, sont nécessaires pour confirmer la causalité, préciser la dose optimale et tester l’effet sur des intermédiaires cliniques (auto-anticorps, phase clinique pré-PR). L’intégration de profils protéiques médiateurs (CD80, TNFRSF4) pourrait guider des cibles thérapeutiques et des biomarqueurs de prévention personnalisée.