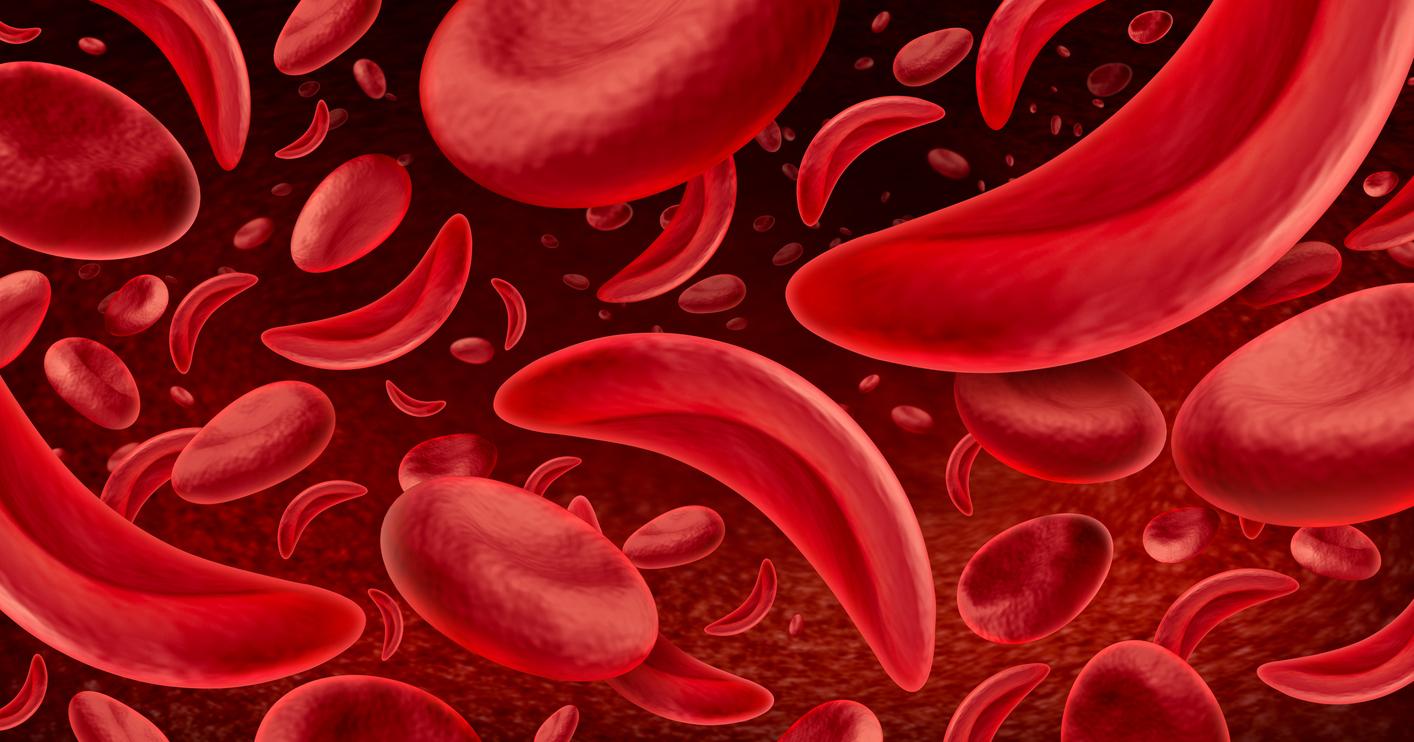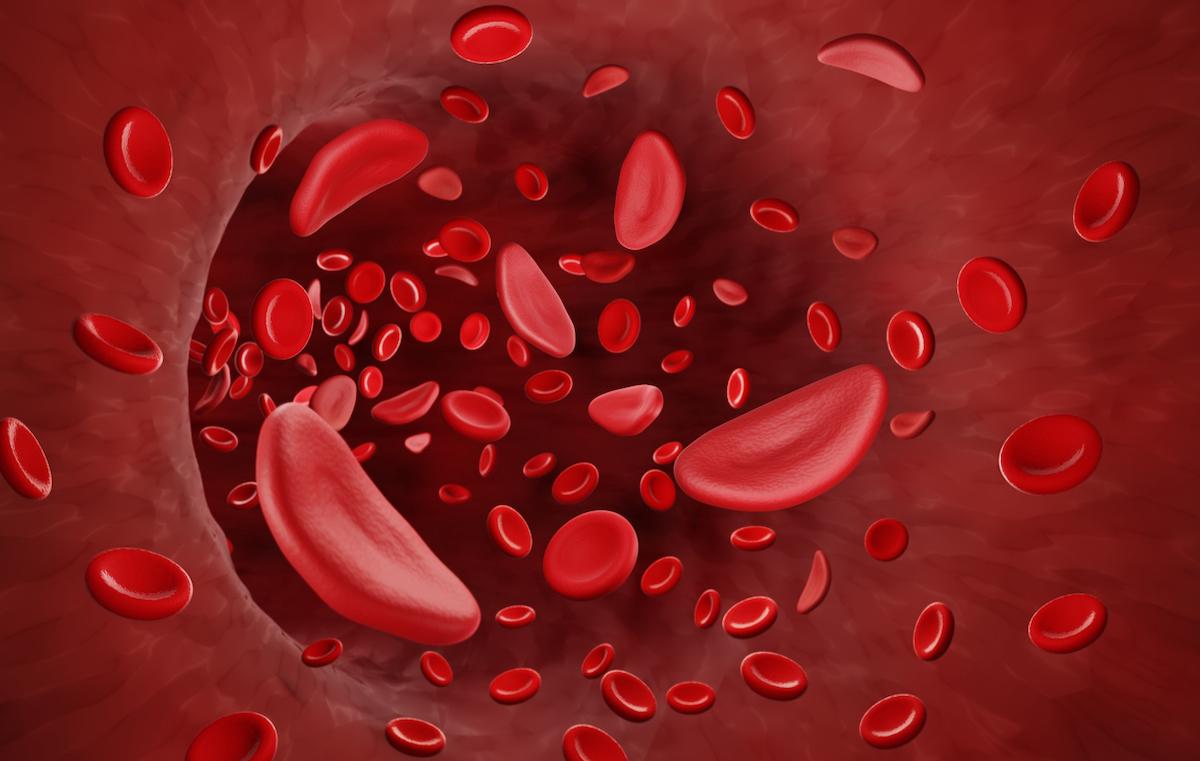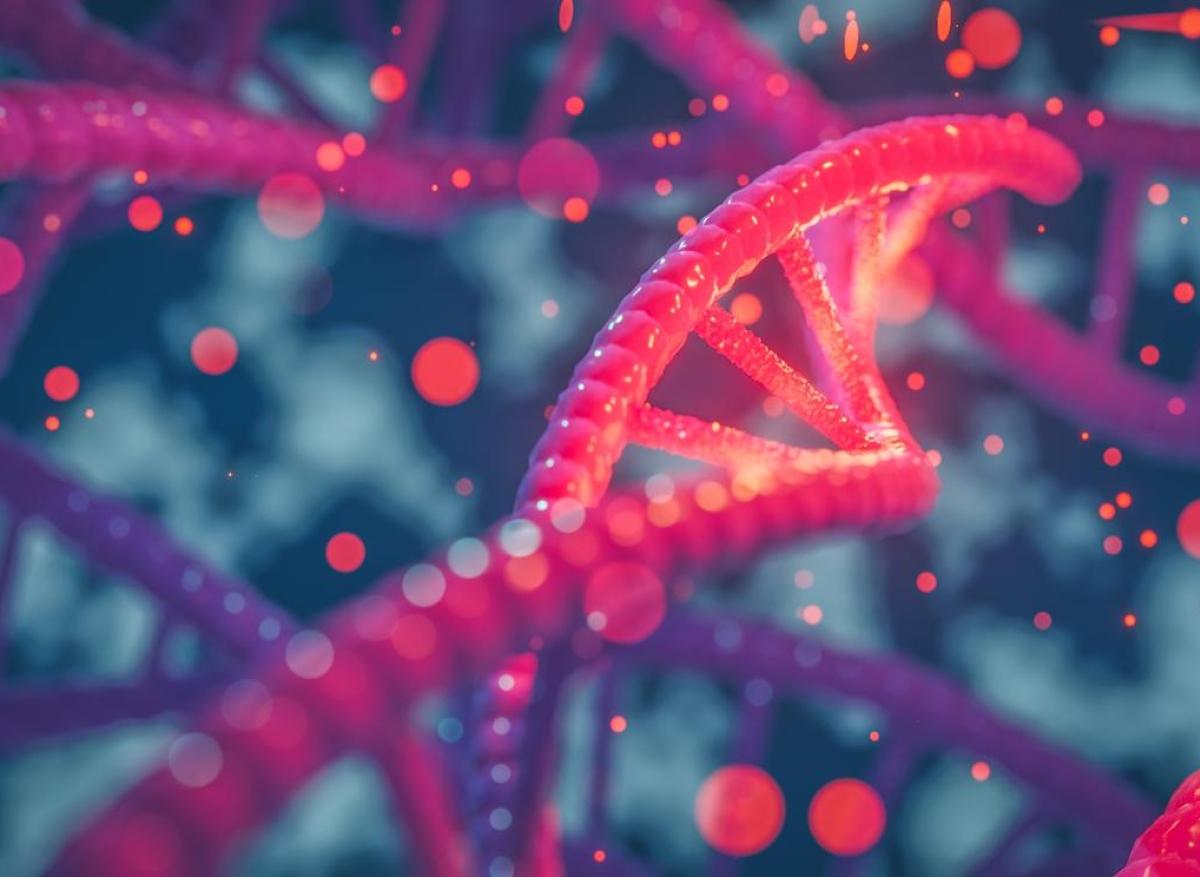Hématologie
Thérapie génique : la CRISPR-Cas9 sans ajout pour réactiver les gènes embryonnaires silencieux
Dans la drépanocytose et la β-thalassémie, en coupant un petit morceau d’ADN (quelques kilobases) situé entre un super-enhancer et les gènes de l’hémoglobine fœtale (HbF), on rapproche physiquement l’interrupteur génétique de son gène-cible : celui-ci se rallume alors qu’il était éteint depuis la naissance. Cette manœuvre, réalisée grâce à la technologie CRISPR-Cas9 sans apporter de gène extérieur, pourrait corriger la drépanocytose et la β-thalassémie en remplaçant l’hémoglobine adulte défectueuse par une hémoglobine fœtale protectrice.
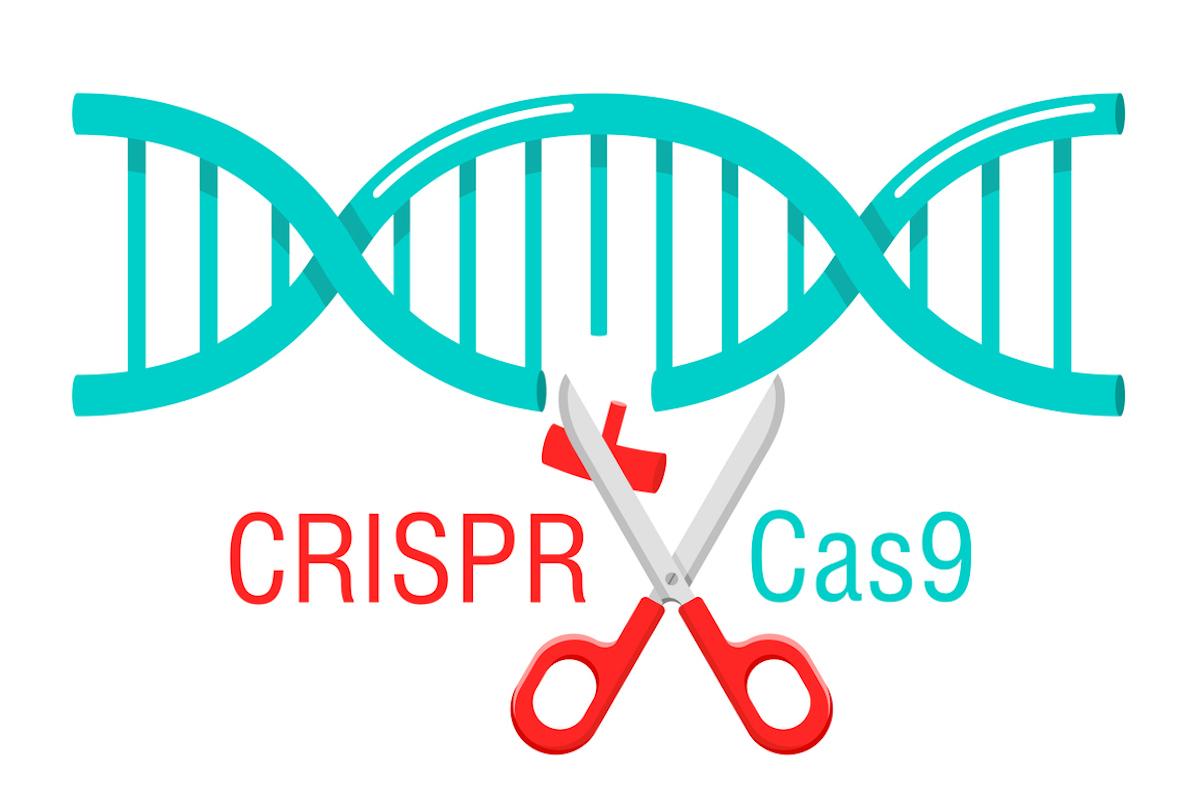
- Dmitry Kovalchuk/istock
Des chercheurs néerlandais ont mis au point une application originale de l’édition génomique : en retirant simplement un petit segment d’ADN non codant entre un super-enhancer et les gènes de l’hémoglobine fœtale (HbF), ils parviennent à réactiver durablement ces gènes silencieux depuis la naissance. Concrètement, la région régulatrice (LCR) du locus β-globine pilote successivement, au cours du développement, les gènes embryonnaires puis fœtaux (HBG) avant de passer la main au gène adulte (HBB) ; chez l’adulte, HBG reste inactif essentiellement parce qu’il se trouve trop loin, en termes de longueur linéaire d’ADN, de cette LCR restée pourtant active.
Une équipe néerlandaise, dans une étude parue dans Blood, démontre que cette répression dépend simplement de l’espacement linéaire : la délétion ou l’inversion de 11 kb d’ADN non régulateur (ADN intercalaire) entre la LCR et HBG dans des cellules souches hématopoïétiques CD34+ adultes rapproche physiquement l’enhancer et réactive puissamment l’HbF. Dans les érythroblastes différenciés, l’ARN HBG bondit de moins de 1 % à 25 à 45 % du total globine, seuil jugé protecteur, et la protéine HbF atteint 30 % du contenu cellulaire. Un résultat équivalent est obtenu sur le locus α-globine : la suppression de 12 kb recrute l’enhancer vers HBZ et restaure son expression, suggérant la portée générale de ce mécanisme dit « delete-to-recruit ».
Drépanocytose : l’édition réduit de 60% la formation d’hématies falciformes sous hypoxie
Dans des modèles issus de cinq patients drépanocytaires, cette édition réduit de 60% la formation d’hématies falciformes sous hypoxie et normalise le flux microcapillaire in vitro, tandis que la proportion d’érythrocytes porteurs d’HbF passe de 12 % à 83 % après différenciation.
Les analyses de sécurité sont rassurantes : moins de 0,3 % des gènes ont une modulation d’expression significative, aucun signal p53 ou inflammatoire n’est activé, les coupures hors cible représentent à peine 0,07 % des lectures et se situent dans des régions intergéniques, la viabilité clonogénique des cellules souches reste supérieure à 90 % et aucun remaniement chromosomique n’a été détecté, plaçant le profil de sécurité au niveau des protocoles d’édition actuellement en essai clinique.
Une cohorte à développer et un suivi à prolonger
Les données, obtenues sur huit donneurs sains, cinq patients et des lignées KU812, doivent évidemment être consolidées par des cohortes plus larges et un suivi dépassant six mois, mais cette approche présente déjà plusieurs atouts face aux thérapies géniques virales ou à l’édition du répresseur BCL11A : absence d’intégration, seule la distance est modifiée, l’empreinte épigénétique est préservée et le coût potentiel réduit. À court terme, des essais de phase I/II chez l’adulte, puis chez l’enfant avec conditionnement non-myéloablatif, sont envisageables.
Selon les auteurs, à plus long terme, le concept pourrait s’appliquer à d’autres maladies où un gène « de secours » embryonnaire peut pallier un défaut de la version adulte. Pour le praticien, cette étude souligne qu’un segment d’ADN apparemment inutile peut, par son seul espacement, contrôler l’accès d’un gène à son interrupteur – et qu’en ajustant cette distance, il devient possible de redonner un avantage fonctionnel aux globules rouges chez les patients drépanocytaires ou thalassémiques. Pour le clinicien, ces résultats rappellent que des segments génomiques apparemment neutres assurent l’isolement fonctionnel des promoteurs : les manipuler offre une nouvelle dimension thérapeutique sans ajout de matériel exogène.