Cardiologie
Fibrillation atriale : l’obésité est bien une cause directe
Une étude où les malades sont randomisés en fonction de leurs facteurs génétiques d’IMC élevé démontre que cette affection est une cause directe de la FA.
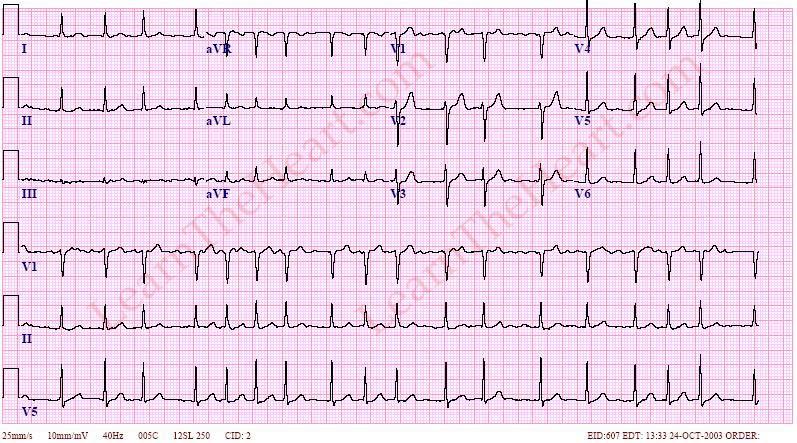
- Healio.com
Dans les méta-analyses ajustées selon l'âge et le sexe, les deux prédicteurs génétiques utilisés dans cette étude sont significativement associés :
• A un IMC élevé (FTO : 0,43 ; IC à 95%, 0,32-0,54 kg/m2 par A-allèle, P <0,001;
• Au score génétique d’un IMC élevé : 1,05 ; IC à 95%, 0,90-1,20 kg/m2 pour une augmentation de 1 U, P <0,001)
• Et à l’apparition d’une FA (FTO, hazard ratio, 1,07 [1,02-1,11] par A-allèle, P = 0,004 ; Score de gène, hazard ratio, 1,11 [1,05-1,18] par 1-U d'augmentation, P <0,001).
Une étude où les malades ont été randomisés en fonction des prédicteurs génétique de l’indice de masse corporelle, l’IMC, permet pour la première fois de démontrer une relation de cause à effet entre un IMC élevé et le risque d’apparition d’une fibrillation atriale. Cette étude est parue dans la revue Circulation.
Une étude de randomisation basée sur la génétique
Les chercheurs ont identifié 51 646 individus d'ascendance européenne sans FA à l’inclusion dans 7 cohortes prospectives de population initiées entre 1987 et 2002 aux États-Unis, en Islande et aux Pays-Bas, avec apparition d’une FA entre 1987 et 2012. Les suivis de cohorte ont varié de 7,4 à 19,2 ans, période au cours de laquelle il y a eu un total de 4178 nouveaux cas de FA.
La randomisation mendélienne a été effectuée avec l'analyse des variables génétiques afin d’estimer un ratio de risque causal spécifique à chaque cohorte pour le lien entre l'IMC et la FA.
Deux prédicteurs génétiques (instruments) ont été utilisés pour l'IMC : le génotype FTO (rs1558902) et un score de gène BMI comprenant 39 polymorphismes à un seul nucléotide, identifiés par des études d'association à l'IMC à l'échelle du génome.
Une relation de cause à effet
Pour l'association causale entre l'IMC et l’apparition d’une FA, les estimations de la variable génétique, ajustées selon l'âge et le sexe, sont un ratio de risque de 1,15 (1,04-1,26) par kg / m2, P = 0,005 (FTO) et 1,11 (1,05-1,17) par kg/m2, P <0,001 (score de gène BMI).
Ces deux estimations sont conformes à l'estimation de la méta-analyse entre l'IMC et la FA observés (rapport de risque ajusté selon l'âge et le sexe, 1,05 [1,04-1,06] par kg/m2, P <0,001).
L'ajustement multivarié ne modifie pas de façon significative ces résultats.
En pratique
Ces résultats sont cohérents avec une relation causale directe entre une IMC élevée et le risque de fibrillation atriale.
Dans la FA, les facteurs de risque cardiovasculaire entrent pour au moins 50% dans le risque de survenue de ce trouble du rythme, l’HTA étant le facteur de risque largement prédominant.
La pondération de l’obésité est moins bien définie, même si des études observationnelles avaient permis d'établir un lien entre un indice de masse corporelle élevé et le risque de survenue d’une fibrillation atriale. L’établissement d’une relation de causalité est cependant impossible à établir à partir d'études observationnelles, en raison de nombreux biais impossibles à éliminer.
Cette étude de randomisation mendélienne a permis de randomiser les personnes en fonction de la possession ou non, de gènes exposant à l’obésité : cela permet justement d’éliminer ces biais liés aux autres facteurs de risque, aux traitements et à l’environnement, et cela permet ici d’affirmer qu’il y a une causalité entre un IMC élevé et la FA.
Cette causalité est claire et c’est un argument supplémentaire en faveur des initiatives de santé publique ciblant l'obésité en prévention primaire, dans la perspective de réduire le risque de FA.
































