Diabétologie
Diabète de type 2 : une physiopathologie hétérogène
Le diabète de type 2 a encore des secrets à révéler ! Cet article permet de faire le point sur les connaissances autour de la physiopathologie du diabète de type 2.
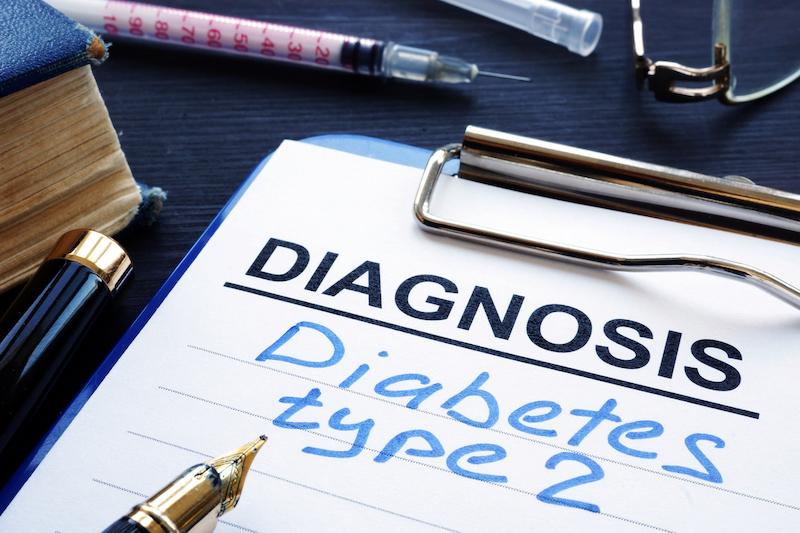
- Istock/designer491
Le diabète de type 2 est classiquement relié au syndrome métabolique, avec entre autre une inflammation de bas grade et un dépôt ectopique de graisses, mais avec des présentations cliniques hétérogènes, surtout lors du diagnostic. Afin de mieux préciser cette part de syndrome métabolique, une équipe munichoise a étudié le phénotype de 485 patients au stade de pré-diabète ou à un stade très précoce du diabète de type 2.
Il en ressort qu’entre 15 et 45 % de ces patients ne présentent aucun élément du syndrome métabolique (en dehors de l’hyperglycémie), malgré une résistance à l’insuline et un déficit relatif de l’insulino-sécrétion.
Des patients diabétiques sans aucun élément du syndrome métabolique
Dans deux cohortes de patients, les auteurs ont comparé trois groupes : des individus contrôles strictement normo-glycémiques (contrôles), des individus pré-diabétiques ou diabétiques sans aucun autre signe du syndrome métabolique parmi le score NCEP ATP3 (Diab0), et des individus (pré-) diabétiques avec au moins un élément du score NCEP ATP3 (Diab≥1). Le score NCEP ATP3 quantifie les mesures anormales de la circonférence abdominale (> 88 et 102cm chez les femmes et les hommes respectivement), des triglycérides (> 1,50 g/L), du HDL cholestérol (< 0,50 et 0,40 g/L chez les femmes et les hommes), et de la tension artérielle (> 130/85 mmHg). De manière intéressante, le groupe Diab0 ne se différenciait pas du groupe contrôle sur aucun autre marqueur du syndrome métabolique mesuré par les chercheurs, et non inclus dans le score NCEP ATP3, tels que l’indice de masse corporelle, le contenu hépatique en gras (mesuré par IRM) ou la CRP ultra-sensible, alors que ces éléments étaient différents dans le groupe Diab≥1.
En revanche, le groupe Diab0, sans aucun élément du syndrome métabolique, présentait à la fois une plus grande résistance hépatique à l’insuline et une moindre sensibilité musculaire à l’insuline. Le taux d’insulinémie était comparable au groupe contrôle, mais les auteurs concluent à un déficit de sécrétion d’insuline relativement à la glycémie non contrôlée.
Deux cohortes d’individus à un stade précoce de dysglycémie
Les auteurs ont analysé les données de patients de deux cohortes :
- la cohorte “Prediction, Prevention and Subclassification of Type 2 Diabetes” (PPSDiab), incluant 138 femmes ayant développé récemment un diabète gestationnel, facteur de risque important de diabète de type 2, comparées à un groupe contrôle de femmes ayant eu une glycémie normale durant leur grossesse ;
- la cohorte Etude Whitehall II, étude prospective de plus de 10.000 individus anglais, avec ici inclusion de tous les nouveaux cas de diabète de type 2 (412 individus), contrôlés avec des individus normoglycémiques appariés sur l’âge et le sexe.
D’éventuels diabète de type 1 ou MODY 2 ont été écartés par dosage des auto-anticorps et séquençage du gène GCK, permettant de poser le diagnostic de « diabète de type 2 ».
Des efforts de phénotypage à poursuivre
Les causes d’une insulino-résistance, à la fois hépatique et musculaire, ne s’intégrant pas dans un syndrome métabolique, restent à éclaircir. Les auteurs rapportent une moindre activité physique dans le groupe Diab0 par rapport au groupe contrôle dans une des cohorte (les données d’activité physique n’étaient pas disponibles dans l’autre cohorte), ce qui pourrait être un des facteurs. Surtout, le rôle du tissu adipeux dans l’apparition d’un trouble de la régulation de la glycémie semble probable, avec une augmentation, dans les deux cohortes, des acides gras non estérifiés (NEFA).
Une meilleure compréhension des éléments déclencheurs d’une hyperglycémie permettra d’identifier des sous-groupes d’individus avec une physiopathologie plus homogène, étape indispensable pour le développement de traitements ne ciblant pas uniquement l’hyperglycémie, mais plutôt les mécanismes causaux.































