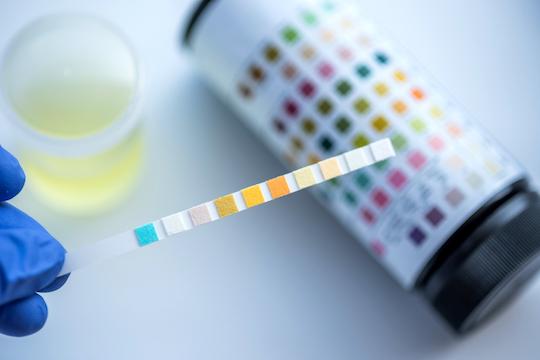Diabétologie
Antidiabétiques : quelle valeur ajoutée pour les aGLP1 et les iSGLT2 ?
Une vaste analyse du BMJ permet de donner une estimation des bénéfices apportés par les agonistes du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2 en fonction du profil de risque initial de chaque patient.

- Engin Ozber/istock
Les très nombreux essais menés au cours de ces dernières années ont démontré de façon formelle les bénéfices cardiovasculaires et rénaux de deux nouvelles classes d’antidiabétiques, les agonistes du GLP-1 et les inhibiteurs du SGLT2.
Ceux-ci sont désormais proposés très tôt dans les recommandations de prise en charge du diabète de type 2. Toutefois, leurs profils d’efficacité et de tolérance ne sont pas totalement superposables, ce qui peut rendre difficile le choix thérapeutique.
Plus de 760 essais cliniques passés à la loupe
C’est dans l’objectif de faciliter la prise de décision des cliniciens, dans le cadre des recommandations rapides du BMJ, qu’est publié un vaste travail d’analyse de la littérature portant sur ces deux classes d’antidiabétiques. Les auteurs de ce travail ont colligé les données de quelques 764 essais cliniques ayant inclus 421 346 patients pour donner une estimation des bénéfices et des effets secondaires de ces traitements pour 1000 patients traités pendant 5 ans.
Cette analyse est réalisée en prenant en compte leur profil de risque initial : très faible (pas de facteurs de risque cardiovasculaire), faible (3 ou plus de ces facteurs), modéré (maladie cardiovasculaire), élevé (maladie rénale chronique) ou très élevé (maladie cardiovasculaire et rénale).
Des bénéfices confirmés et des différences
Cette analyse très fine de toutes les études confirme que les agonistes du GLP-1 et les iSGLT2, prescrits en plus du traitement antidiabétique habituel, réduisent la mortalité globale, les infarctus du myocarde non fatals, les insuffisances rénales et les hyperglycémies sévères.
Elle souligne aussi des différences entre ces deux classes d’ADO, qui n’ont pas été comparés directement dans des essais cliniques : les iSGLT2 réduisent de manière plus marquée les décès de toute cause et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque que les agonistes du GLP-1, tandis que ces derniers diminuent le risque d’accident vasculaire cérébral non fatal, critère sur lequel les iSGLT2 semblent dénués d’effet. Parallèlement, ces deux classes n’ont pas tout à fait le même impact sur le poids et la qualité de vie, les différences étant toutefois assez faibles.
Le profil d’effets indésirables diffère également, les iSGLT2 exposant notamment à un risque accru d’infections génitales, et les agonistes du GLP-1 à des effets gastro-intestinaux.
En fonction du niveau de risque
Surtout, cette vaste analyse montre que les bénéfices absolus du traitement varient selon le profil de risque cardiovasculaire de chaque patient.
Si l’on prend l’exemple du critère mortalité de toutes causes, la baisse des décès apportée par les iSGLT2 comparativement au placebo est respectivement de 5, 15, 25, 34 et 48/1000 patients traités pendant 5 ans selon le niveau de risque cardiovasculaire. Pour les agonistes du GLP-1, ces chiffres sont respectivement de 2, 8, 13, 17 et 24/10000.
Le guide MAGIC
Pour faciliter la décision thérapeutique en fonction du profil patient, le support interactif MAGIC (Making GRADE the irresistible choice) permet, après avoir défini le niveau de risque du patient, d’évaluer l’impact du traitement sur les différents paramètres étudiés : mortalité de toutes causes, mortalité cardiovasculaire, IDM non fatal, AVC non fatal, maladie rénale terminale, insuffisance cardiaque, acidocétose diabétique, infections génitales, troubles gastro-intestinaux sévères, poids, qualité de vie et informations pratiques.