Neurologie
Alzheimer : un nouveau cadre de recherche pour une définition biologique de la maladie
Aux Etats-Unis, le National Institutes of Health a établi un nouveau cadre de recherche dans le cadre d'une « définition biologique » de la maladie d’Alzheimer.
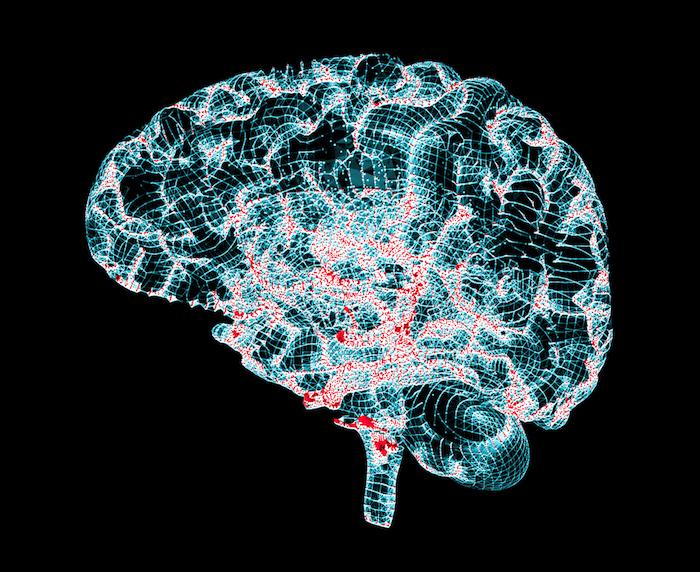
- Naeblys
Une nouvelle « construction biologique » basée sur les modifications cérébrales mesurables, c’est ce que propose le NIH pour faciliter l'étude du processus de la maladie d’Alzheimer et de la séquence des événements qui mènent à la déficience cognitive et à la démence. Cette nouvelle définition de la maladie d’Alzheimer a été publiée dans le NIA (National Institute on Aging, appartenant au National Institutes of Health) le 10 avril 2018.
Cette définition biologique de la maladie a vocation à permettre aux chercheurs d’étudier la maladie d’Alzheimer, depuis ses premiers évènements biologiques jusqu’aux symptômes cliniques comme la perte de mémoire et d’autres symptômes. Le principal objectif est d’aboutir à une approche plus précise et plus rapide pour tester les médicaments et autres interventions possibles.
Les auteurs de cette nouvelle définition expliquent que ce nouveau cadre s’appliquera aux essais cliniques autant qu’aux études d’observation. Le but de ce langage commun est d’unifier les différentes étapes de la maladie afin que les études puissent être facilement comparées et présentées plus clairement à la communauté scientifique, comme au public.
Améliorer les chances d’intervention
Le directeur du NIA a déclaré que « pour aider la communauté scientifique à progresser contre la maladie d’Alzheimer, plus on caractérise le processus pathologique spécifique défini comme la maladie d’Alzheimer, meilleures sont nos chances d’intervenir à n’importe quel stade de ce continuum, de la prévention de la maladie d’Alzheimer au retard de sa progression ».
Le cadre de recherche proposé aujourd’hui se fonde sur la distinction de trois étapes : pré-clinique, déficience cognitive légère, et démence ; en un continuum axé sur les biomarqueurs. Ainsi, ce nouveau cadre se concentre sur les biomarqueurs regroupés en différents processus pathologiques pouvant être mesurés par imagerie et analyse d’échantillon de liquide céphalo-rachidien. Il s’appuie notamment sur un système de notation pour les troubles cognitifs.
Le directeur de la Division des neurosciences de la NIA explique que « nous devons nous concentrer sur des cibles biologiques ou physiques pour cibler les traitements potentiels de la maladie d’Alzheimer. En déplaçant la discussion sur les changements neuropathologiques détectés par les biomarqueurs pour définir la pathologie, comme nous examinons les symptômes sur le développement de la maladie, jevpense que nous avons plus de chances de trouver des thérapies. »
3 groupes de biomarqueurs
Trois groupes généraux de biomarqueurs sont proposés : bêta-amyloïde, tau et neurodégénérescence ou lésion neuronale. La protéine bêta-amyloïde s’agglomère pour former des plaques dans le cerveau. La protéine Tau s’accumule anormalement en formant des enchevêtrements neurofibrillaires qui bloquent la communication entre les neurones. Quant à la neurodégénérescence, elle peut résulter de nombreuses causes, telles que le vieillissement ou le traumatisme, mais pas nécessairement la maladie d’Alzheimer.
Les cliniciens peuvent ainsi caractériser la combinaison de biomarqueurs et « classer » les patients selon 8 profils. De plus, les profils de biomarqueurs peuvent eux-mêmes être classés en 3 catégories plus larges : les biomarqueurs normaux, ceux qui caractérisent la maladie d’Alzheimer et le changement pathologique non lié à cette pathologie.

Crédit : NIA
Les auteurs de cette nouvelle définition précisent toutefois que cette dernière ne constitue ni un critère de diagnostic ni une recommandation pour les cliniciens. De même, cette approche biologique de la maladie d’Alzheimer ne vise pas à supplanter d’autres mesures comme les tests neuropsychologiques qui permettent d’étudier des aspects cognitifs importants de la maladie.
































