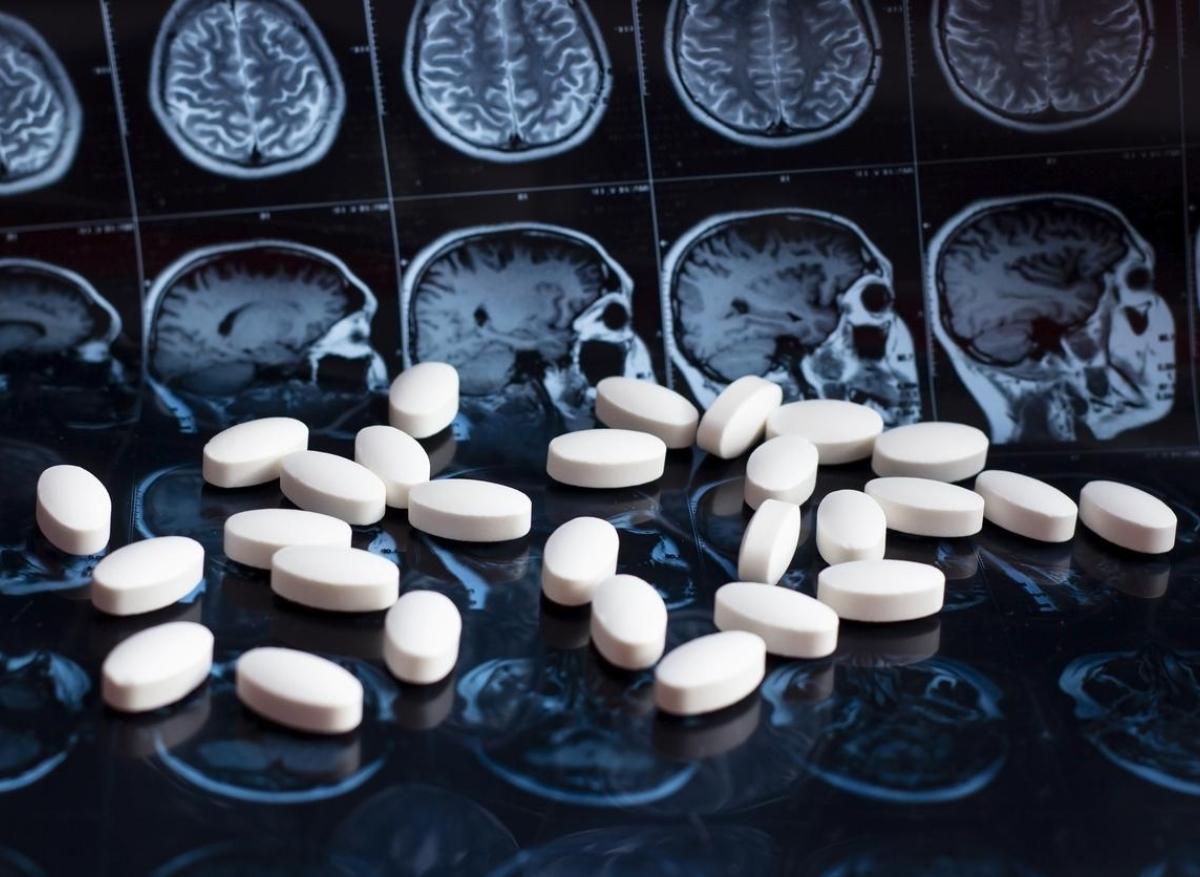Neurologie
Maladie d’Alzheimer : le lithium comme piste thérapeutique inattendue
Une chute précoce du lithium cortical semble ouvrir la voie aux lésions amyloïdes et à l’inflammation dans la maladie d’Alzheimer débutante. Dans des modèles murins, rétablir ce microélément à des doses physiologiques réduirait les plaques bêta-amyloïdes, l’hyperphosphorylation de Tau et la perte mnésique.

- Leamus/istock
Les phases moléculaires précoces de la maladie d’Alzheimer (MA) restent mal définies. Selon les résultats d’une décennie de recherche, des chercheurs de la Harvard Medical School pensent avoir trouvé la clé qui pourrait unifier les nombreuses théories de la maladie d'Alzheimer et du vieillissement cérébral : ce serait le lithium, un métal très commun, déjà utilisé dans le traitement du trouble bipolaire. Il a une marge thérapeutique étroite mais d’autres sels pourraient faire la différence. Les scientifiques émettent l’idée que le lithium orotate, un sel de ce métal très commun, permettre de protéger le cerveau vieillissant contre la maladie d'Alzheimer.
Contexte et signal majeur : du métal trace au modulateur de trajectoire
Dans une série d'expériences rapportées dans la revue Nature, des chercheurs des universités de Harvard et de Rush ont découvert que le lithium (Li) endogène est régulé dynamiquement dans le cerveau, qu’il baisse dès le stade trouble cognitif léger (MCI) et qu’il est piégé dans l’amyloïde. En comparant 27 métaux dans des cerveaux humains, le Li émerge comme le seul élément significativement diminué dans le cerveau au cours de la maladie d’Alzheimer, par rapport aux niveaux sériques, et ce dès le stade de trouble cognitif léger. La spectrométrie de masse de ces cerveaux montre un enrichissement du Li dans les dépôts amyloïdes et un appauvrissement des régions péri-plaques, indiquant une séquestration progressive.
Chez des souris sauvages et dans des modèles amyloïdes, une déplétion alimentaire réduisant d’environ 50 % le Li cortical entraîne une augmentation de l’amyloïde-β, une accumulation de la phosphorylation de tau, une activation microgliale pro-inflammatoire, une perte de synapses, d’axones et de myéline, avec un déclin cognitif accéléré. Une part des effets semble médiée par l’activation de GSK3β. À l’inverse, une supplémentation en lithium orotate prévient ces altérations et la perte mnésique chez les souris Alzheimer et a protégé l’architecture neuronale du vieillissement normal.
Lithium cérébral : premier domino de la cascade amyloïde
Au-delà du signal principal, plusieurs résultats renforcent la plausibilité biologique. D’abord, dans la cohorte humaine, le zinc était augmenté et le cuivre diminué en cas de MA, mais seul le Li chutait en cas de MA ou de MCI, soulignant une vulnérabilité spécifique de l’homéostasie du Li. Ensuite, le profilage transcriptomique single-nucleus révèle que la carence en Li induit, dans plusieurs types cellulaires, des signatures génomiques qui recouvrent celles observées chez les patients MA : gènes de l’architecture et de la conduction neuronales réprimés, microglies pro-inflammatoires avec clairance amyloïde altérée.
Sur le plan pharmacochimique, l’agrégat Aβ, chargé négativement, attire le Li+ à des concentrations physiologiques (micromolaires). Le criblage de 16 sels de lithium a identifié le lithium orotate comme ayant la plus faible conductance et une affinité moindre pour Aβ que le carbonate, ce qui réduirait sa séquestration. Fonctionnellement, chez la souris, l’orotate s’est montré plus efficace que le carbonate pour limiter les dépôts d’Aβ et de phospho-tau, restaurer la phagocytose d’Aβ par des microglies âgées et prévenir les troubles mnésiques. Côté tolérance, les toxicités rénales et thyroïdiennes classiques du carbonate n’ont pas été détectées avec l’orotate dans ces modèles, suggérant un profil de sécurité potentiellement plus favorable, à confirmer chez l’humain : aucune hausse de créatinine ni de TSH après 8 mois (âge murin avancé), contrairement aux toxicités rénales ou thyroïdiennes décrites avec les sels psychiatriques classiques.
Lithium : nouveau biomarqueur, futur traitement médical ?
Ces conclusions reposent sur trois piliers méthodologiques complémentaires : des analyses post-mortem humaines comparant cerveau et sérum (MA, MCI, contrôles) sur plus de 250 cerveaux humains issus de quatre banques neuropathologiques, des manipulations nutritionnelles du Li chez la souris (sauvage et modèles amyloïdes) avec lecture neuropathologique et comportementale, et une résolution cellulaire par single-nucleus RNA-seq. Cette triangulation renforce l’argument causal, mais la représentativité clinique reste limitée : il s’agit essentiellement de données précliniques et de tissus humains, sans essai randomisé chez des patients. Les résultats doivent donc être considérés comme générateurs d’hypothèses. Mais, une cohorte danoise montre déjà une corrélation inverse entre lithium de l’eau potable et incidence de la démence chez l’humain (HR 0,83 pour un gradient de +5 µg l⁻¹).
Selon un éditorial associé, aucune modification immédiate du standard de soins n’est justifiée. Néanmoins, plusieurs implications émergent. Premièrement, le déséquilibre du Li cérébral pourrait constituer un événement très précoce de la MA, ouvrant la voie à des biomarqueurs (imagerie ou dosage du Li périphérique dans le LCR) et à une stratification des patients en MCI. Deuxièmement, la formulation du lithium apparaît déterminante : des sels « évadant l’amyloïde » comme le Lithium orotate pourraient cibler le compartiment cytoplasmique pertinent tout en minimisant la séquestration. Troisièmement, des essais cliniques de phase précoce évaluant lithium orotate dans le MCI ou la MA débutante, avec surveillance rénale/thyroïdienne et endpoints multimodaux (Aβ/tau, neuroinflammation, cognition), sont donc une priorité. Les micro-doses efficaces de lithium (≈0,25 mEq l⁻¹ sériques) restent très inférieures aux posologies psychiatriques, suggérant un large index thérapeutique, à confirmer par des études de phase II ciblant populations à haut risque génétique ou hydrique faible en Li. Enfin, chez les sujets âgés bipolaires, l’amyloïdose liée à l’âge pourrait limiter l’efficacité du carbonate ; la comparaison orotate vs carbonate mérite une évaluation dédiée.
En somme, le lithium endogène passerait du statut de trace « neutre » à celui de modulateur de vulnérabilité dans la maladie d’Alzheimer. La restauration ciblée de son homéostasie, via des sels moins séquestrés par l’amyloïde, constitue une piste thérapeutique crédible, mais encore à valider cliniquement. Les prochaines recherches devront également préciser la fenêtre temporelle optimale d’intervention et la modulation croisée avec les anti-amyloïdes actuellement disponibles.