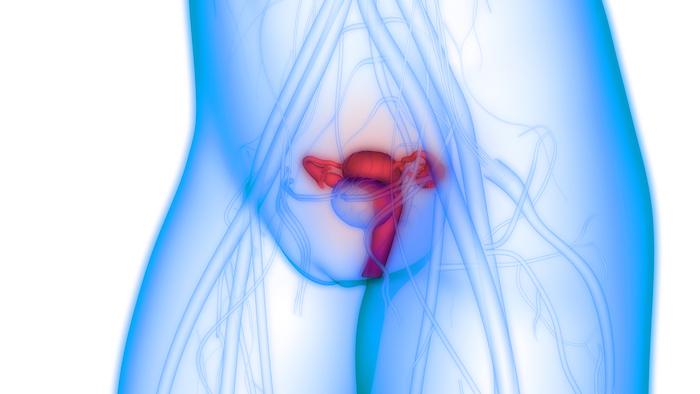Onco-digestif
Cancers du pancréas : pourquoi rechercher le « BRCAness » ?
L’impact des mutations héréditaires en oncologie est de mieux en mieux connu. Elles sont aujourd’hui à mêmes d’orienter tant les stratégies de dépistage que thérapeutiques. Intéressons-nous particulièrement au « BRCAness ».
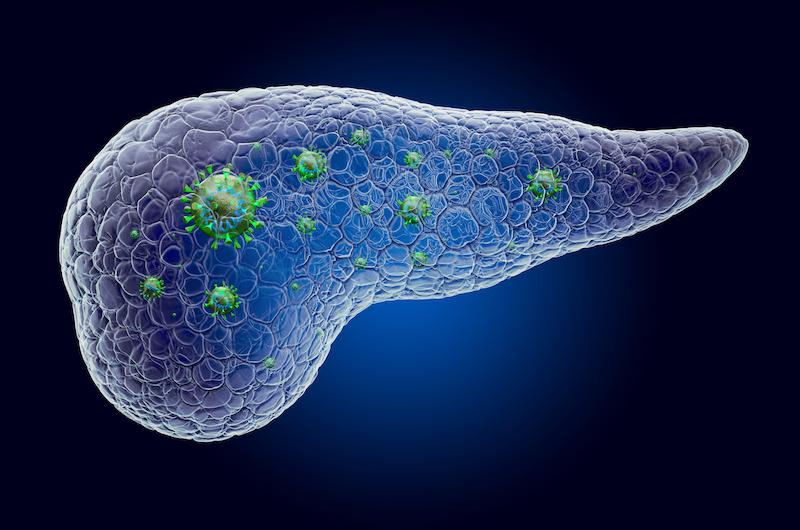
- Istock/AlexLMX
Les mutations héréditaires des gènes BRCA1 et BRCA2, prédisposant aux cancers du sein et de l’ovaire, peuvent également entrainer des adénocarcinomes du pancréas. Ces gènes sont des acteurs essentiels de la voie de la recombinaison homologue (RH), permettant la réparation des cassures double-brin de l’ADN.
Plus récemment, il est apparu que l’inactivation d’autres gènes impliqués dans la voie RH pouvaient également être responsables de certains cancers du pancréas (CaPa), et que la voie RH était fréquemment altérée par des mutations somatiques de gènes de cette famille. L’ensemble de ces anomalies entrainant un défaut de RH définissent le profil « BRCAness », et sont identifiées dans 10 à 15% des CaPa.
Des gènes de prédispositions justifiant un dépistage.
Les mutations germinales de ces gènes concernent 5 à 9% des CaPa, et expliquent 17% des cas d’agrégations familiales de cancer du pancréas. Il est donc recommandé de dépister ces anomalies en cas de survenue de 2 CaPa, ou d’un CaPa et un cancer lobulaire du sein et/ou de l’ovaire chez des apparentés au 1erou 2ème degré.
Les sujets porteurs de ces mutations ont un risque de développer un CaPa multiplié par 2 à 10 selon la mutation (BRCA2 étant la plus à risque) et majoré lorsque l’on retrouve un ou plusieurs cas de CaPa chez les apparentés. Ces patients doivent donc faire l’objet d’un dépistage régulier du CaPa. En 2020, un consortium d’experts internationaux a actualisé ses recommandations concernant ce dépistage:
- il doit être proposé aux sujets porteurs de mutations germinales de BRCA1/2, PALB2 ou ATM et ayant un apparenté au 1er degré atteint d’un CaPa, et/ou 2 apparentés quel que soit le degré si mutation BRCA2.
- il doit débuter 10 ans avant l’âge du cas index et au plus tard entre 50 et 55 ans, puis réalisé sur un rythme annuel
- les modalités, non consensuelles, font généralement appel à l’IRM et/ou l’echoendoscopie,
- Il est essentiel d’insister sur la correction des facteurs de risques évitables chez ces patients (tabac, diabète, obésité).
Inhibiteurs de PARP et mutation germinale de BRCA 1 ou 2 : l’étude POLO
PARP intervient dans la réparation des cassures doubles brins par une autre voie que la RH. Ces 2 voies sont complémentaires et se remplacent mutuellement en cas de dysfonctionnement de l’une ou de l’autre pour assurer la viabilité cellulaire. En revanche, l’inhibition de PARP lorsque la voie RH est déficiente aboutit à la mort de la cellule par apoptose. Ce mécanisme est la base du développement des inhibiteurs de PARP dans différents cancers touchés par des mutations BRCA (ovaire, prostate).
Dans les CaPa, l’olaparib est la première thérapie ciblée à montrer une efficacité pertinente. L’étude POLO a inclu 154 patients porteurs d’une mutation BRCA 1 ou 2, ayant un CaPa avancé stable ou répondeur sous chimiothérapie à base de sels de platine. Les patients ont été randomisés entre placebo (1/3 des patients) ou maintenance par olaparib (300mg 2x par jour, 2/3 des patients). La médiane de survie sans progression est significativement plus longue dans le groupe olaparib que dans le groupe placebo, (médiane 7,4 mois vs 3,8 mois ; HR 0,53 (95 % CI : 0,35 à 0,82; P = 0,004). La survie globale actualisée a été présentée lors du congrès de l’ASCO GI en janvier 2021. Même si l’on ne retrouvait pas de différence significative (médiane 19,2 mois vs 19 mois, HR=0,83, ns), il y avait une tendance en faveur de l’olaparib, avec deux fois plus de patients vivants à 3 ans par rapport au placebo (33,9% vs 17,8%).
Cette étude a permis l’enregistrement de l’olaparib en traitement de maintenance chez les patients atteints de CaPa porteurs d’une mutation germinale de BRCA 1 ou 2, non progressifs après 16 semaines de chimiothérapie de 1ère ligne à base de sels de platines.
Des indications plus larges et des associations innovantes
L’AMM actuelle est restreinte aux patients porteurs de mutations germinales de BRCA 1 ou 2. Cependant, dans d’autres types de cancer, les inhibiteurs de PARP ont aussi montré une efficacité en cas de mutations somatiques de BRCA 1/2 (prostate, ovaire) ou des mutations d’ATM (prostate). Les inhibiteurs de PARP sont actuellement testés dans plusieurs études dédiées aux mutations somatiques d’une vingtaine de gènes de la voie HR, dont l’étude française MAZEPPA-PRODIGE 72 pour les CaPa en maintenance d’une première ligne.
De plus, certaines stratégies proposent de combiner l’inhibition de PARP à l’immunothérapie. En effet, l’instabilité génomique associée à l’inhibition de PARP pourrait augmenter la charge mutationnelle tumorale et donc permettre une meilleure efficacité de l’immunothérapie. Cette stratégie est actuellement testée dans une cohorte dédiée aux CaPa de l’essai GUID2REPAIR, combinant olaparib, durvalumab et tremelimumab. Enfin, la combinaison d’anti-PARP avec des traitements agissant sur d’autres voies de la réparation de l’ADN pourrait permettre une efficacité des antiPARP même en l’absence de défaut de la RH. Certaines molécules sont à des stades précoces de développement.
Les mutations germinales de la voie RH représentant 5 à 9% des cancers du pancréas, doivent être recherchées pour permettre un dépistage précoce, et ont désormais une conséquence thérapeutique avec une AMM de l’olaparib en cas de mutation BRCA 1 ou 2. La recherche de mutations somatiques, pratiquée uniquement dans le cadre d’essais cliniques, pourrait permettre à l’avenir d’étendre les indications des inhibiteurs de PARP à 10-15% des patients atteints de cancer du pancréas.