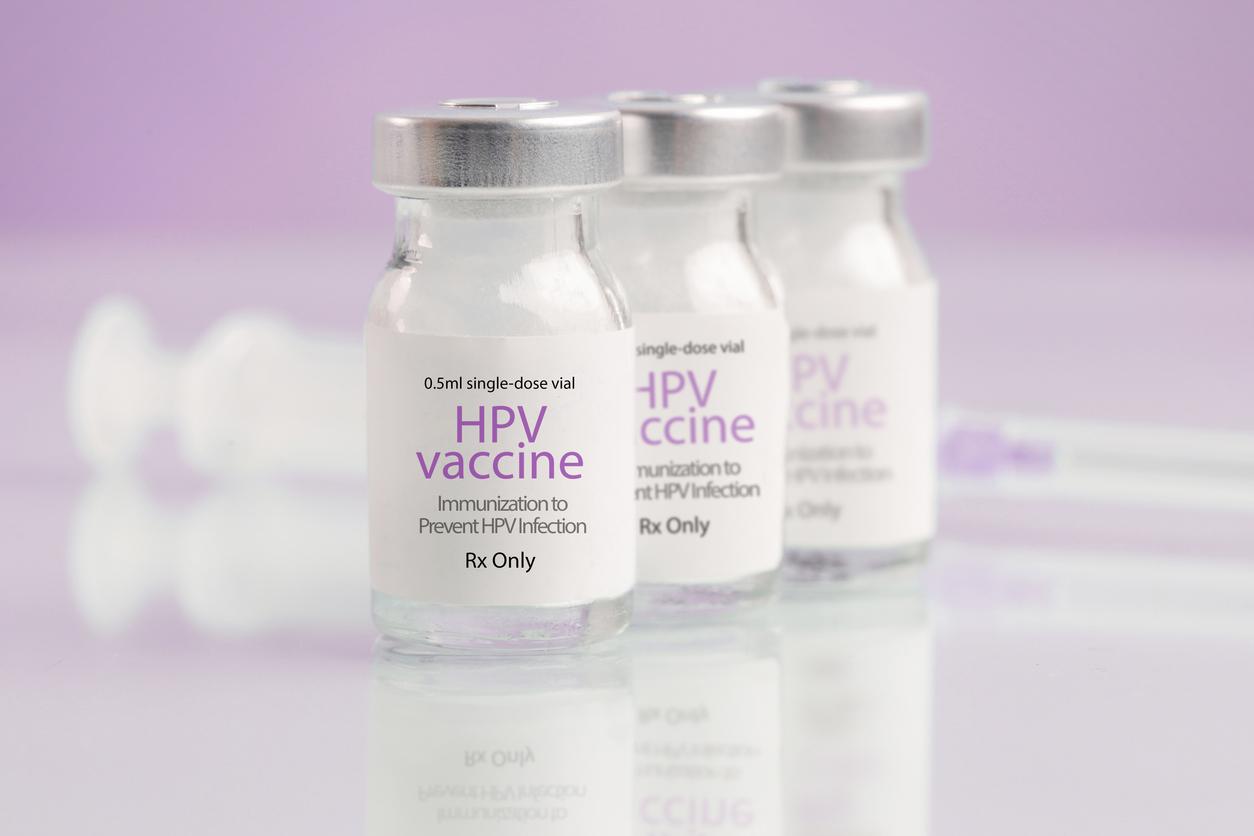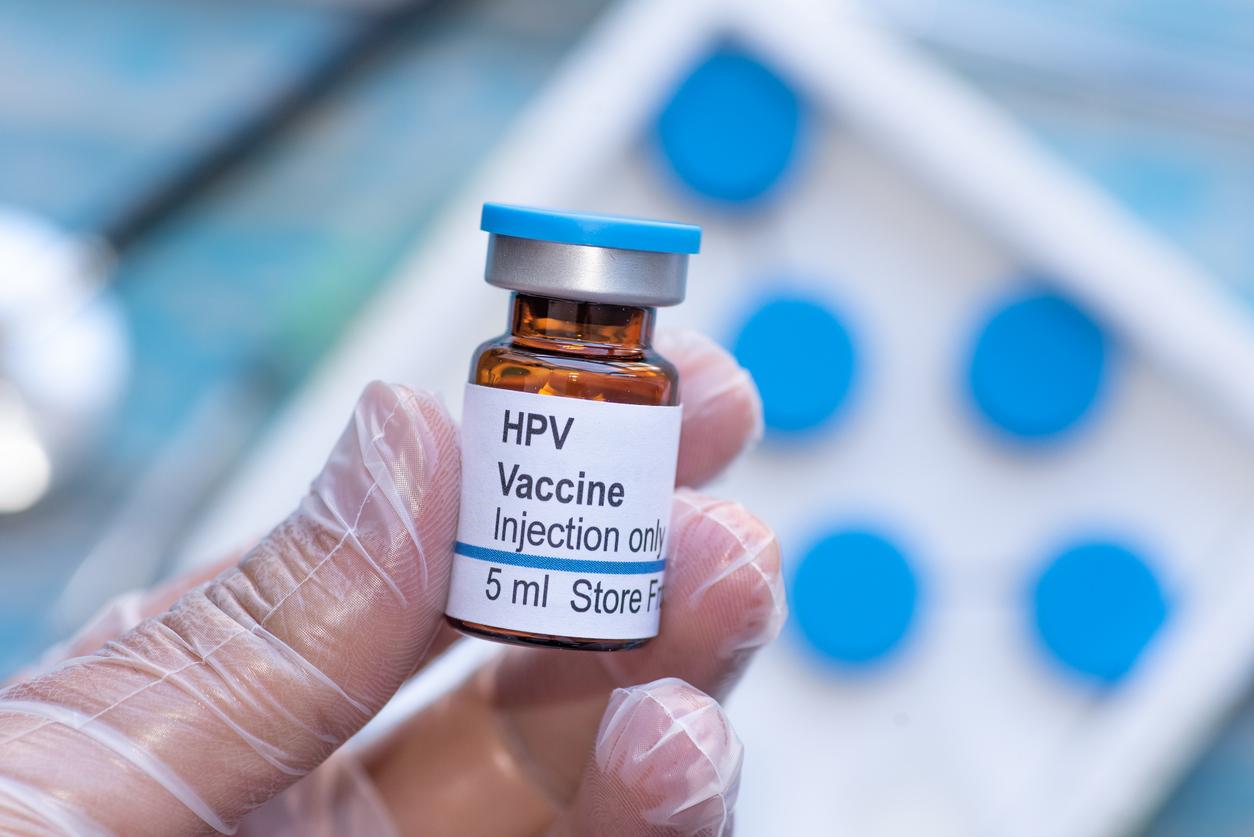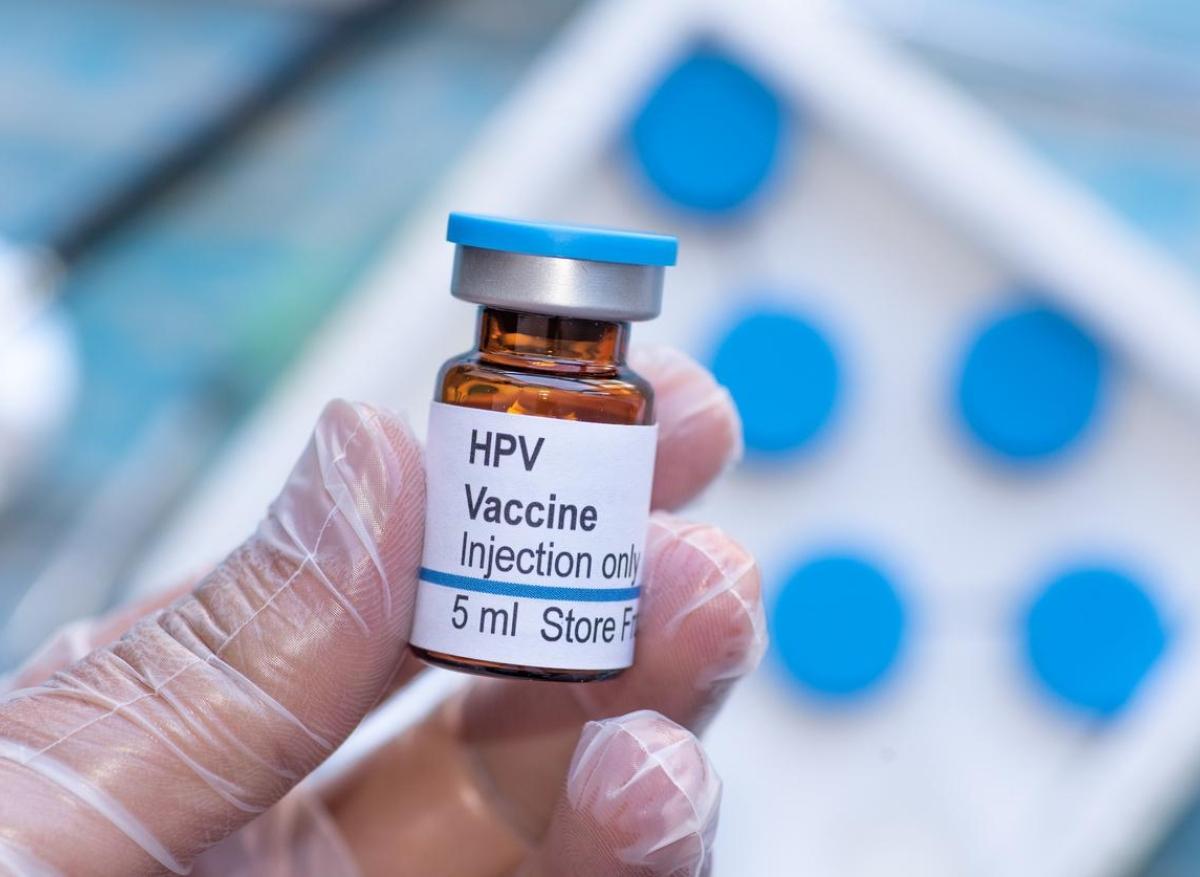Onco-Gynéco
Cancer du col de l’utérus : le vaccin anti-HPV peut réellement le prévenir
Deux nouvelles revues Cochrane, combinant essais cliniques et données en vie réelle, montrent que la vaccination anti-HPV réduit massivement le risque de lésions précancéreuses et de cancer invasif, en particulier lorsqu’elle est réalisée avant 16 ans, et avec un excellent profil de sécurité.

- KTStock/istock
Les papillomavirus humains (HPV) sont impliqués dans les cancers du col de l’utérus, de l’anus, de la vulve, du vagin, du pénis et de l’oropharynx, ainsi que dans les condylomes anogénitaux. Le cancer du col est le quatrième cancer de la femme dans le monde, responsable de plus de 300 000 décès annuels, majoritairement en pays à ressources limitées. Les premières données d’essais randomisés montraient que les vaccins anti-HPV préviennent les infections par HPV à haut risque et les lésions précancéreuses, sans recul suffisant pour observer un effet direct sur le cancer invasif.
La première revue Cochrane a compilé 60 essais randomisés incluant 157 414 participants : tous les vaccins se révèlent efficaces pour réduire les infections à HPV oncogènes, les néoplasies intra-épithéliales de haut grade et le recours à des traitements des lésions liées au HPV, avec un effet particulièrement net chez les adolescents et jeunes adultes vaccinés entre 15 et 25 ans.
Vie réelle : réduction de 80 % du risque de cancer invasif et profil de sécurité rassurant
La seconde revue Cochrane s’appuie sur 225 études observationnelles portant sur plus de 132 millions de personnes. Elle montre que les filles vaccinées à 16 ans ou plus tôt ont un risque de cancer du col réduit d’environ 80 % par rapport aux non vaccinées. Les diminutions de lésions précancéreuses (CIN2+ et CIN3+) et de condylomes sont substantielles, avec un bénéfice maximal lorsque la vaccination est réalisée avant l’exposition au virus. Ces résultats sont cohérents entre pays, types d’études et durées de suivi.
Sur le plan de la tolérance, les essais cliniques comme les grandes bases de données en vie réelle convergent : les effets indésirables sont le plus souvent bénins et transitoires, dominés par la douleur ou le gonflement au point d’injection. Les événements graves sont rares et surviennent à des fréquences comparables dans les groupes vaccinés et non vaccinés. Les auteurs n’identifient aucun lien solide entre vaccination et effets indésirables graves fréquemment relayés sur les réseaux sociaux. Le signal de sécurité global reste donc très favorable, y compris avec un recul désormais long et des effectifs très importants.
Des preuves issues d’essais et de la vie réelle
Les deux revues reposent sur une méthodologie robuste et complémentaire : essais randomisés contrôlés d’un côté, permettant de démontrer la capacité des vaccins à prévenir infections et lésions précancéreuses, et grandes études observationnelles de l’autre, capables de montrer l’impact sur le cancer invasif après plusieurs années. Les limites tiennent principalement au fait que la majorité des études proviennent de pays à hauts revenus où les programmes de dépistage cervical sont bien établis, ce qui peut limiter l’extrapolation aux pays à faibles ressources, pourtant les plus concernés par la mortalité par cancer du col. Par ailleurs, le recul reste plus court pour les autres cancers HPV-induits (vulve, pénis, oropharynx), dont l’incidence maximale survient plus tardivement.
Selon la Cochrane Collaboration, ces données renforcent les recommandations de vacciner systématiquement les filles et les garçons, idéalement avant 16 ans et en tout cas avant le début de la vie sexuelle, afin d’optimiser la protection individuelle et l’immunité de groupe. Elles justifient aussi de rassurer les parents et les adolescents sur la sécurité du vaccin et d’intégrer la vaccination anti-HPV comme un axe majeur de réduction de l’incidence des cancers liés au HPV, en complément du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses. Ce constat positionne cette vaccination comme pilier de la prévention des cancers HPV-induits.