Onco-digestif
Cancers gastriques : la percée de l’immunothérapie dès la première ligne
Après avoir été confinée en 3ème et 2ème ligne des cancers gastrique avancés, l'immunothérapie démontre son intérêt en première ligne, en association à la chimiothérapie.
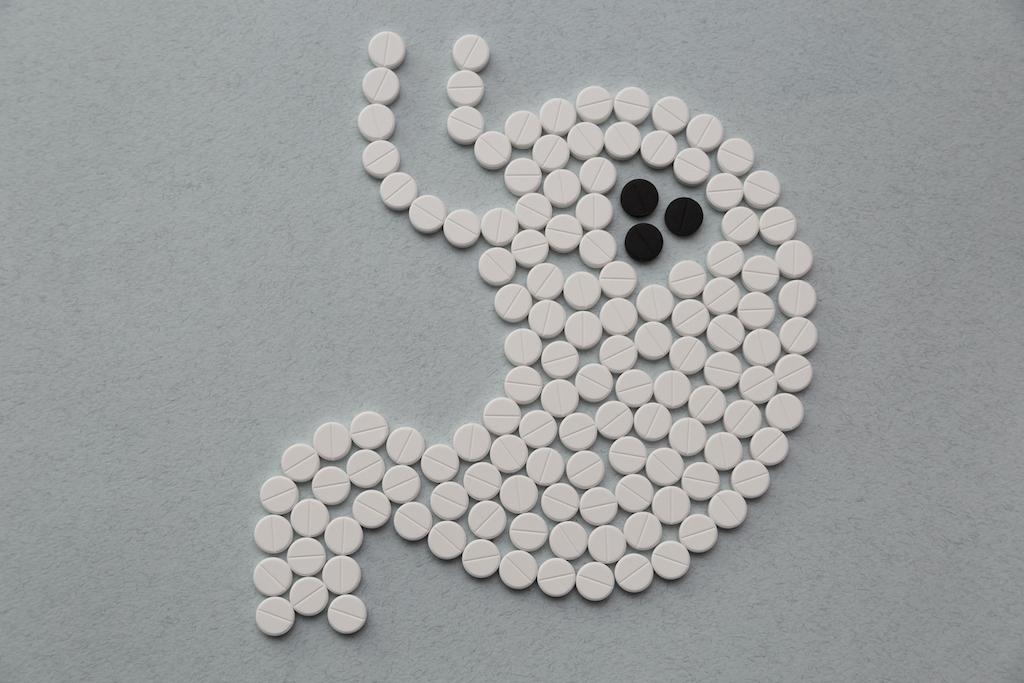
- Istock/AlinaTraut
L’utilisation des anticorps inhibiteurs de checkpoint immunitaires (ICI) représente une des avancées majeures de ces dernières décennies en cancérologie. Cependant, la place de ces traitements dans la prise en charge des cancers gastriques est discutée depuis longtemps. Plusieurs études présentées à l'ESMO démontrent l'intérêt de l'immunothérapie associée à la chimiothérapie en première ligne des cancers en stade avancé de la jonction œso-gastrique. Les résultats de l’essai Keynote-062 ont récemment été publiés dans la revue JAMA oncology
La percée des immunothérapies
Depuis quelques années, les ICI, en particulier les anti-Programmed cell Death-1 (PD-1) montrent quelques signaux d’activités dans les cancers gastriques, sans toutefois convaincre formellement.
Deux premiers essais ont d’abord montré une efficacité des anticorps anti-PD-1 après échec des chimiothérapies classiques. Le nivolumab et le pembrolizumab ont été approuvé respectivement au Japon et aux Etats-Unis, en monothérapie chez des patients prétraités sur la base d’une étude de phase III asiatique (ATTRACTION 2) et d’une étude de phase II internationale (KEYNOTE-059). Cependant, ces espoirs ont été déçus par les résultats négatifs des deux essais de phase III KEYNOTE-061, comparant le pembrolizumab au paclitaxel en 2ème ligne, et JAVELIN Gastric 300 comparant l'avélumab (anti-PD-L1) à une chimiothérapie de 3ème ligne.
Une étude d’immunothérapie en 1ère ligne
L’étude de phase III KEYNOTE-062 est une étude multicentrique internationale menée dans 29 pays, chez des patients avec un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique avancé avec une surexpression de PD-L1, définie par un score CPS ≥ 1. Ce score CPS était ≥ 10 chez 34% des patients. Les patients avec une surexpression de HER-2 étaient exclus.
Cet essai a inclus 763 patients, qui recevaient :
- soit du pembrolizumab seul (200 mg toutes les 3 semaines) (n=256),
- soit une chimiothérapie toutes les 3 semaines par cisplatine (80 mg/m2 J1) et 5-fluorouracile (800 mg/m2 J1-J5) ou capécitabine (2000 mg/m2/j de J1-J14) (n=250) ;
- soit une combinaison de pembrolizumab et de chimiothérapie (n=257).
Les critères de jugement principaux sont la survie globale des patients avec score CPS ≥ 1 (soit l’ensemble de la population de l’étude) et de ceux avec score CPS≥ 10, ainsi qu’à la survie sans progression. Il est à noter que le plan d’analyse statistique était complexe, mêlant des hypothèses de non-infériorité et de supériorité....
Des résultats différents selon les sous-populations
Le pembrolizumab en monothérapie démontrait, dans l’ensemble de la population, une non-infériorité en SG (SG médiane : 10,6 mois versus 11,1 mois; HR: 0,91 ; IC99,2%=0,69-1,18 ; borne supérieure pour la non infériorité de 1,2 non franchie), et un taux de survie à 2 ans, supérieur : 26,5% versus 19,2%.
En revanche, le pembrolizumab était associé à une moins bonne survie sans progression (SSP) (médiane : 2,0 mois versus 6,4 mois) et un taux de réponse plus faible (14,8 % versus 37,2%), mais les patients en réponse avaient une durée de réponse prolongée avec le pembrolizumab.
Enfin, dans cette population, la combinaison pembrolizumab + chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule n’améliorait pas la SG (médiane : 12,5 mois versus 11,1 mois ; HR : 0,85; IC95%= 0,70-1,03 ; p=0,05).
Comme pour l’immunothérapie
Dans cette population représentant 1/3 des patients de l’étude, les résultats sont complexes à interpréter. En effet, la combinaison chimiothérapie + pembrolizumab n’améliorait pas la SG comparée à la chimiothérapie seule (SG médiane : 12,3 mois versus 10,8 mois ; HR : 0,85 ; IC95%= 0,62-1,17 ; p=0,16). Pourtant, le pembrolizumab seul, lui, paraissait supérieur à la chimiothérapie (médiane : 17,4 mois versus 10,8 mois ; HR : 0,69 ; IC95%= 0,49-0,97)). Cependant, la significativité de ce résultat ne peut être formellement affirmée, puisque la comparaison statistique de la monothérapie n’était prévue qu’en cas de supériorité de la combinaison par rapport à la chimiothérapie. Par ailleurs, une analyse exploratoire montrait un net bénéfice de l’immunothérapie chez les patients avec une tumeur MSI-H (HR : 0.29 pour la SG).
Conclusion & perspectives
Cette étude montre donc, comparé à la chimiothérapie, la non-infériorité du pembrolizumab en 1ère ligne de traitement des adénocarcinomes gastriques avancés, mais ne retrouve de supériorité ni du pembrolizumab, ni de la combinaison pembrolizumab + chimiothérapie. Étant donné le coût de l’immunothérapie, il est peu probable que cette non-infériorité permette une utilisation prochaine. Le pembrolizumab en monothérapie montre un profil de toxicité favorable (taux d’effets indésirables de grades 3 à 5 de 17%) comparé à la chimiothérapie (69%) et à la combinaison (73%).
Mais le résultat le plus intéressant pour la communauté médicale est sans doute la supériorité de l’immunothérapie par rapport à la chimiothérapie dans la population CPS ≥ 10. Paradoxalement, ce résultat ne peut être formellement affirmé, en raison d’un plan d’analyse statistique déroutant.
Ces résultats peuvent être revus à la lumière de la communication récente de deux essais, testant la combinaison chimiothérapie + Nivolumab (anti-PD-1). L’étude Checkmate 649 est positive sur ses 2 critères principaux, avec une SG et une SSP significativement améliorée par le nivolumab chez les patients avec un score CPS≥5. L’étude ATTRACTION-4 (asiatique) n’est positive que pour la SSP, dans une population non sélectionnée sur le CPS, mais vient tout de même renforcer les résultats de Checkmate-649, et conforter l’intérêt du nivolumab en 1ère ligne de traitement des cancers œsogastriques. Ces deux essais ont donc promu le nivolumab dans les cancers œsogastriques avancés avec un score PD-L1 CPS≥5, dès la première ligne, en association avec la chimiothérapie. Il est difficile de les extrapoler à la population PD-L1 CPS entre 1 et 5, ou <1, sous-groupes pour lesquels les résultats n’ont pas été présentés individuellement pour le moment.
On retiendra de ces essais que des designs statistiques à critères composites et mêlant plusieurs populations d’analyses, dont le but est sans doute de poser plusieurs questions peuvent rendre les résultats difficilement interprétables. Les phases III positives récentes devraient malgré tout permettre de positionner les anticorps anti-PD-1 chez des patients ayant une tumeur avec une expression élevée de PDL-1, en combinaison avec la chimiothérapie. Leur utilisation en monothérapie pourrait se discuter chez des patients avec un score PDL-1 très élevé (CPS≥10).
































