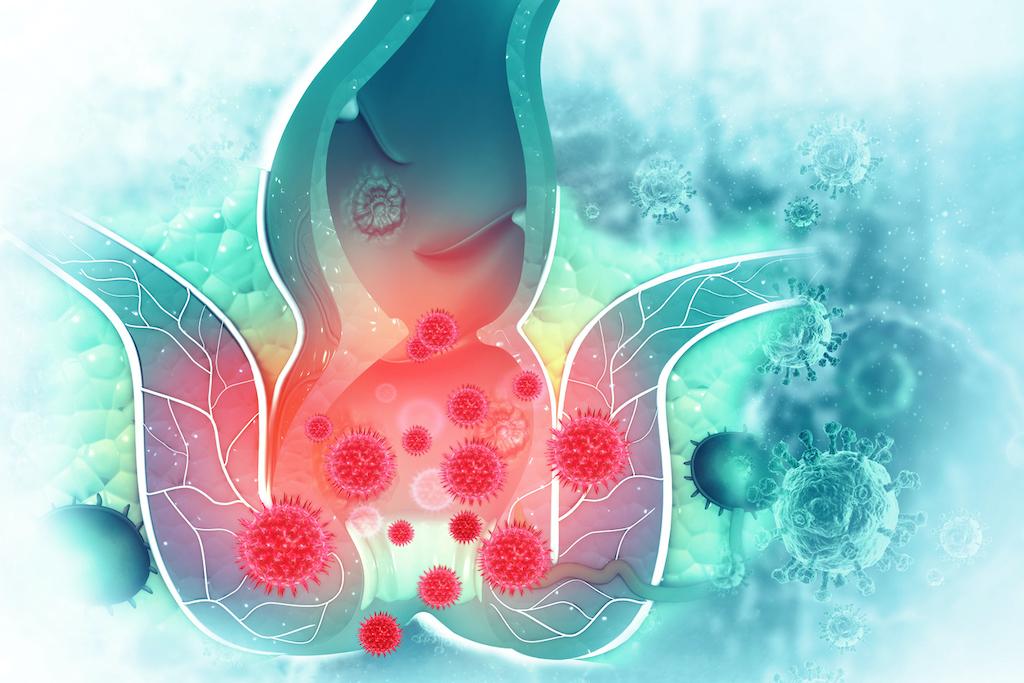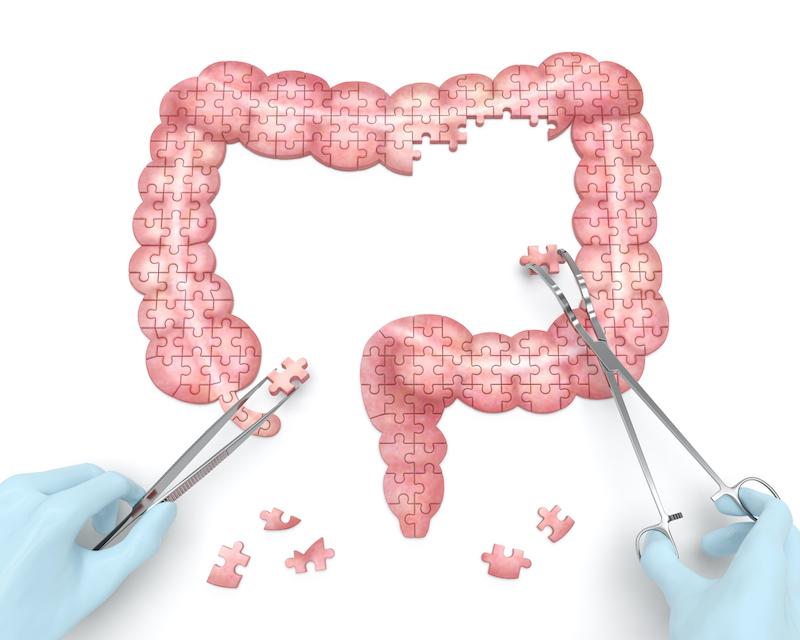Onco-digestif
Cancers du rectum : l’IRM après traitement peut-elle aider à mieux sélectionner les bons candidats à la préservation d’organe ?
Il est actuellement bien établi que la séquence RCT suivie d’une proctectomie carcinologique, qui est utilisée chez la majorité des malades ayant un cancer du rectum localement évolué est associée à des risques de séquelles digestives, génitourinaires et une détérioration de la qualité de vie. Chez les malades qui ont un cancer du rectum cT2 ou petit T3, la question qui se pose est celle de comment éviter cette association et limiter la toxicité ? soit en proposant une chirurgie d’emblée sans RCT préopératoire soit en proposant une stratégie de préservation rectale associant RCT suivie d’une exérèse locale. Actuellement, aucun essai contrôlé n’a comparé ces deux approches dans cette situation précise et c’est précisément ce que proposent les investigateurs de l’essai TAUTEM.

- Istock/Gumpanat
Lors du congrès américain de cancérologie ASCO 2022, ont été présenté les résultats préliminaires de l’essai contrôlé de phase III TAUTEM évaluant une stratégie de préservation rectale pour les petits cancers du rectum.
Préservation d’organe oui mais avec quelle technique d’imagerie, IRM ou échoendoscopie ?
Dans cette étude, la stratégie de préservation utilisait un processus de sélection de malades au départ, malades ayant une tumeur de petite taille (tumeur cT2-T3 < 40mm, N0) traités soit par une exérèse rectale d’emblée sans traitement préopératoire soit par une radiochimiothérapie (RCT) conventionnelle (CAP50) suivie d’une exérèse locale par voie transanale endoscopique (TEM) 7 semaines après la fin du traitement, stratégie de préservation rectale. Il s’agissait d’un essai de non infériorité de la séquence RCT-TEM par rapport à la proctectomie d’emblée sans traitement. Le critère principal de l’étude était le taux de récidive locale à deux ans. Dans cette étude, les auteurs ont analysé les performances de l’echoendoscopie et de l’IRM pour prédire le stade histologique post traitement (ypTN) dans le groupe préservation. De 2010 à 2021, 173 malades ont été inclus et randomisés pour avoir soit la séquence RCT-TEM (n=86), soit une proctectomie sans traitement préopératoire (n=87). Il s’agissait en majorité de malades ayant un cancer du rectum cT2 (70%) et les caractéristiques des malades étaient similaires entre les 2 groupes. Dans le groupe RCT-TEM, la quasi-totalité des malades ont pu recevoir l’intégralité du traitement (99%) et près de 30% ont présenté des effets indésirables dont la majorité était non graves (grade 1-3). Après réévaluation à l’issue du traitement, une proctectomie a été nécessaire pour 6 malades. La durée opératoire et les pertes sanguines étaient significativement réduites dans le groupe préservation par rapport à la stratégie classique de même que la morbidité postopératoire globale (51% vs 21% respectivement, p<0,01). Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes en ce qui concerne la morbidité sévère (14% pour le groupe proctectomie vs 9% pour le groupe préservation, p = 0,33). L’analyse des résultats anatomopathologiques de l’exérèse locale des malades du groupe préservation a montré que 44% des malades avaient une tumeur classée ypT0 donc en réponse complète, 23% avaient une tumeur ypT1. ll s’agit des résultats préliminaires de l’essai qui montrent que les deux approches sont faisables et que la stratégie de préservation rectale est associée à une réduction de la morbidité globale. Il faut cependant noter que dans cette étude, ce bénéfice en termes de morbidité se fait au dépend des complications mineures mais que, de façon assez surprenante, il n’y a pas de différence sur la morbidité majeure. On aurait attendu une différence plus marquée en faveur du groupe préservation. Est-ce que cette absence de différence pourrait s’expliquer par une morbidité accrue chez les malades qui ont nécessité une proctectomie de rattrapage dans le groupe chirurgie d’emblée ? cette hypothèse ne peut pour le moment pas être confirmée dans la mesure où l’analyse des données de ces malades n’a pas été présentée.
Le critère principal de cette étude de non infériorité, taux de récidive locale à deux ans, n’a pour le moment pas été analysé et rapporté à l’occasion de cette première communication. Il sera également très intéressant de connaître les données de fonction digestive, génitourinaire et de qualité de vie dans cet essai qui pose vraiment la bonne question pour ces petites tumeurs entre chirurgie d’emblée sans irradiation et irradiation pelvienne suivie d’une stratégie de préservation, approche qui est donc assez différente de celle de l’essai GRECCAR2.
Dans cette étude, le taux de réponse complète ou quasi complète après RCT (autour de 65%) sur des petits cancers du rectum est en accord avec les données d’essai précédemment rapportés, GRECCAR 2 notamment. C’est un élément supplémentaire en faveur de la faisabilité de l’approche.
Des précisions diagnostiques similaires mais une mauvaise valeur prédictive négative
La précision diagnostique de l’echoendoscopie et de l’IRM était de 62,5% et de 63,8% respectivement pour prédire le pT2-T3N0 de la tumeur à partir des données des malades ayant eu une proctectomie d’emblée avec une bonne sensibilité pour les deux examens (>90%) mais une mauvaise spécificité (<10%) et une mauvaise valeur prédictive négative (autour de 30%). La performance diagnostique globale de l’IRM pour prédire le stade post traitement parmi les malades du groupe préservation était de 70% pour le ypT0 et de 57% pour le stade ypT0T1. Les données concernant le résultat oncologique n’étaient pas matures et seront présentées ultérieurement.
Ces résultats sont en accord avec la littérature existante sur le sujet mais dans cette étude l’analyse relativement précoce de la réponse en imagerie a pu contribuer à sous-estimer la réponse (persistance de phénomène inflammatoire lié à l’irradiation).