Médecine interne
Maladies auto-immunes : une nouvelle classification mécanistique prometteuse
Au-delà des atteintes d’organes, une classification mécanistique des maladies auto-immunes, selon leur profil cytokinique et les « déterminants tissulaires », permet d’envisager une amélioration de leur compréhension et de leur traitement.
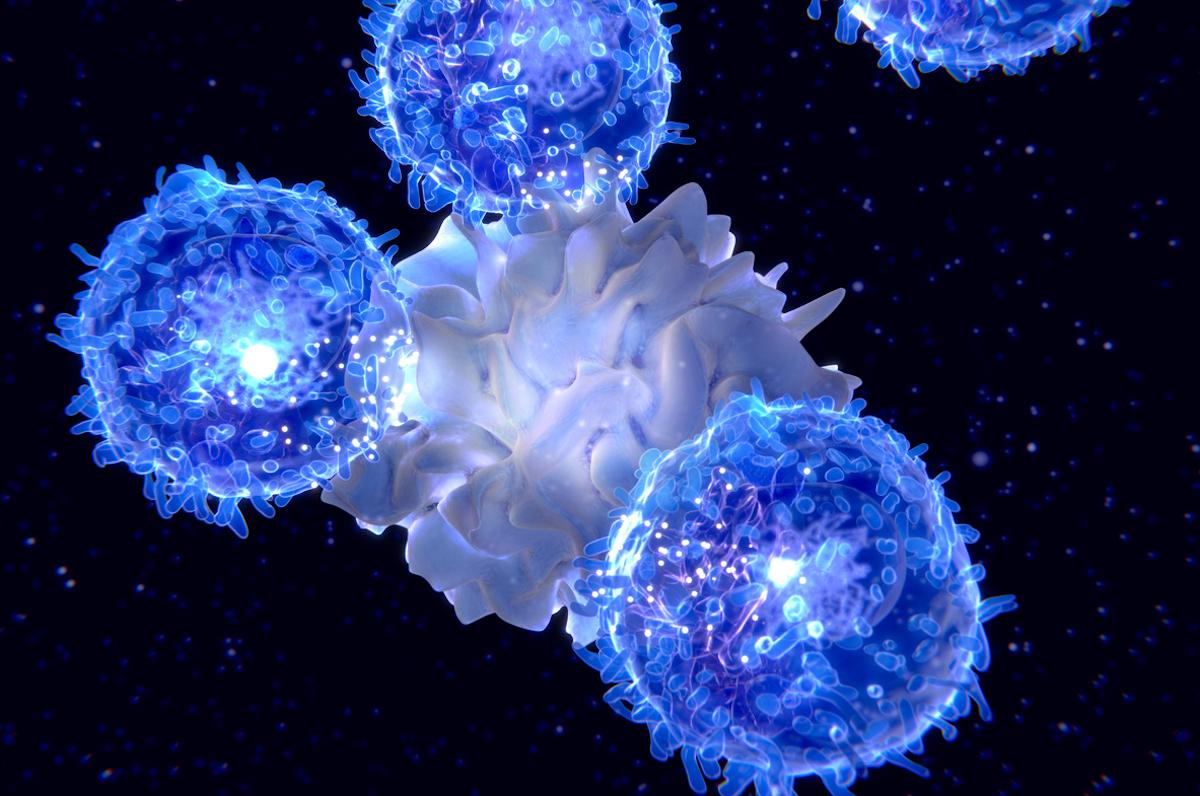
- selvanegra/istock
Les maladies auto-immunes (MAI) constituent un groupe hétérogène de maladies caractérisées par une inflammation chronique et des lésions d'organes qui sont traditionnellement classées en fonction de l'organe atteint de façon prédominante.
L'amélioration de la caractérisation pathogénique des maladies auto-immunes devrait cependant permettre une compréhension mécanistique plus fine de ces affections et rendre possible le développement d'une classification basée sur les mécanismes moléculaires. Par rapport à une classification basée sur le type d'organe, la classification moléculaire permet de mieux prendre en compte les points communs physiopathologiques entre les maladies auto-immunes qui affectent différents organes, mais aussi les différences mécanistiques observées entre les MAI qui affectent le même organe.
Un remarquable article du New England Journal of Medicine fait le point sur ce concept prometteur et nous en donnons une synthèse… un peu longue vu la complexité du sujet.
Inflammation et barrières de l'organisme
La peau, en tant que barrière externe de l'organisme, et les barrières internes, comme l'intestin et les articulations, semblent particulièrement sujettes aux maladies auto-immunes, car ces structures sont nécessaires au maintien de l'homéostasie tissulaire dans des sites exposés à des expositions microbiennes, chimiques et mécaniques répétées.
Une charge élevée en profils moléculaires associés aux agents pathogènes (« pathogen-associated molecular patterns » ou PAMP) pourrait ainsi déclencher une activation immunitaire permanente. Par conséquent, ces barrières sont équipées de systèmes de régulation sophistiqués qui contrôlent, suppriment et résolvent l'inflammation grâce à des cytokines anti-inflammatoires, des médiateurs lipidiques et des cellules immuno-régulatrices.
Points communs et différenciant des MAI
Les classifications basées sur le type d'organe ne permettent pas de séparer utilement les maladies auto-immunes affectant les articulations de celles affectant l'intestin, la polyarthrite rhumatoïde et les MICI partageant plusieurs caractéristiques. Premièrement, leur pathogenèse repose sur une combinaison de loci de susceptibilité génétique (gènes du complexe majeur d'histocompatibilité [CMH] et gènes non-CMH) et de déclencheurs environnementaux (tabagisme, stress mécanique ou modifications du microbiome).
Deuxièmement, l'apparition clinique des deux maladies auto-immunes repose sur des réponses immunitaires exubérantes persistantes qui infiltrent les tissus-cibles avec des cellules immunitaires activées. Troisièmement, les deux troubles ont une évolution chronique caractérisée par des poussées itératives de la maladie alternant avec des phases quiescentes mais avec un faible potentiel de résolution spontanée.
Quatrièmement, le caractère inflammatoire systémique de ces troubles peut entraîner des complications, comme un risque accru de maladies oculaires inflammatoires (« uvéite » ou « sclérite ») ou de lésions cutanées (psoriasis, érythème noueux ou pyodermite), de maladies cardiovasculaires et d'ostéoporose prématurée. Enfin, ces 2 types de maladies auto-immunes, pourtant d’aspects clinique différents, réagissent paradoxalement plutôt bien toutes les 2 aux anti-TNF.
En dépit de ces similitudes, les maladies auto-immunes sont remarquablement hétérogènes à de multiples niveaux et présentent des différences en termes de caractéristiques génétiques, de pathogenèse immunitaire et de réponses aux traitements.
Types de réponse aux traitements conventionnels
Les réponses aux traitements médicamenteux classiques diffèrent selon les maladies auto-immunes. Le meilleur exemple est probablement celui des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont efficaces dans la spondylarthrite axiale et le rhumatisme psoriasique mais moins dans la polyarthrite rhumatoïde. A l’opposé, dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ils peuvent avoir des effets indésirables en rapport avec l'altération de la barrière épithéliale.
Les traitements de fond conventionnels ont une efficacité variable dans certaines maladies auto-immunes, mais il a toujours été difficile de relier ces médicaments à des modèles d'expression cytokiniqes puisque leur mode d'action est basé sur l'inhibition de plusieurs voies inflammatoires différentes et n'est pas véritablement axé sur la pathogenèse initiale. En outre, le sous-groupe de patients hyper-répondeurs à ces traitements de fond classiques est limité, ce qui suggère que les voies de contrôle prédominantes ne sont pas vraiment ciblées.
Le paradoxe du TNF-α
Le facteur de nécrose tumorale α (TNF-α) a été la première cytokine-clé ciblée dans le traitement de polyarthrite rhumatoïde et de nombreuses autres maladies auto-immunes. L'inhibition du TNF-α s'est avérée très efficace dans la polyarthrite rhumatoïde, ce qui a conduit à une re-conceptualisation de la pathogenèse des maladies auto-immunes : un processus inflammatoire complexe peut donc dépendre en grande partie d'une seule cytokine-régulatrice maîtresse. Le TNF-α représente donc probablement une voie effectrice commune qui agit plutôt assez en aval dans le processus inflammatoire.
Le large effet anti-inflammatoire de l'inhibition du TNF-α est principalement basé sur son effet activateur des cellules myéloïdes, qui est commun à de nombreuses maladies auto-immunes. Néanmoins, il existerait des différences importantes dans la réactivité au TNF-α entre la polyarthrite rhumatoïde et les MICI. Ainsi, bien que le TNF-α soit une cytokine-régulatrice majeure dans les maladies auto-immunes, les voies de signalisation spécifiques diffèrent selon les entités pathologiques, avec des implications cliniques importantes.
Différentes signatures cytokiniques
La caractéristique pathognomonique de la polyarthrite rhumatoïde est la « synovite ». La maladie se développe sur la base d'une rupture de la tolérance immunitaire impliquant les cellules dendritiques, les cellules T helper folliculaires (Tfh) ou périphériques (Tph) et les cellules B, à la fois dans les ganglions lymphatiques et la membrane synoviale. Ce processus conduit à la différenciation des plasmocytes et à la production d'auto-anticorps (Facteur Rhumatoïde), ainsi qu'à l'activation des synoviocytes de type fibroblastique avec libération d'interleukine-6.
La rectocolite hémorragique se caractérise par une « cryptite ». Les cellules dendritiques et les macrophages de la paroi intestinale produisent des quantités accrues d'interleukine-23, IL-23 qui active les cellules T helper (Th) de types 17 (Th17) et 9 (Th9). En outre, les cellules Th2 sont plus nombreuses dans la rectocolite hémorragique et induisent les éosinophiles par l'interleukine-13.
La maladie de Crohn se caractérise, elle, par la formation de « granulomes intestinaux ». En association avec les mutations de la protéine NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2), les cellules dendritiques et les macrophages produisent des quantités accrues d'interleukine-23 dans la paroi iléale et colique, aidés par l'activation des cellules Th1 et Th17.
Le rhumatisme psoriasique est caractérisé par une « enthésite » et est étroitement associé au psoriasis cutané comme source d'interleukine-23. En outre, des lipides pro-inflammatoires tels que la prostaglandine E2 (PGE2) sont produits dans le contexte d’une mécano-inflammation dans les enthèses. L'interleukine-23 et la PGE2 induisent la production d'interleukine-17A par les cellules T17 (composées de cellules CD4+ Th17 et CD8+ Tc17 [cellules T17 cytotoxiques]), les cellules lymphoïdes innées de type 3 (ILC3) et les cellules T γ/δ.
La spondylarthrite axiale se caractérise par une « spondylite ». Elle dépend de la production soutenue de lipides pro-inflammatoires (par exemple, PGE2) par la cyclo-oxygénase 2 (COX-2), qui stimule la production d'interleukine-17A par les cellules T17, ILC3 et T γ/δ, indépendamment de l'interleukine-23.
Profil cytokinique et déterminants tissulaires
Une phase effectrice commune à ces cinq maladies inflammatoires auto-immunes est l'activation des macrophages dérivés de la moelle osseuse, des polynucléaires neutrophiles et des fibroblastes aux sites de l'inflammation, associée à la production de quantités accrues de facteur de nécrose tumorale α (TNF-α), ce qui explique leur réponse commune aux anti-TNF.
Par contre, les réponses au ciblage des cytokines dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique contredisent le concept d'un axe strict « interleukine-23-interleukine-17A », puisque l'inhibition de l'interleukine-23 est bénéfique dans ces MAI, alors que l'inhibition de l'interleukine-17A peut exacerber l'inflammation intestinale. Cette différence dans la réponse au traitement montre que les profils d’activation cytokinique sont dépendants des tissus où ils se produisent (« déterminants tissulaires ») et peuvent donc varier considérablement en fonction des organes atteints.
Limites de l’inhibition isolée d'une cytokine
Même si l’inhibition de l’IL-6 parait plus logique dans la polyarthrite rhumatoïde, elle n’est pas réellement supérieure à l’inhibition du TNF : la seule différence est qu’il est possible d’utiliser les anti-IL6 en monothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde alors que les anti-TNF sont plutôt utilisés en association au méthotrexate.
Donc, bien qu'actuellement les stratégies thérapeutiques dans les maladies auto-immunes soient plutôt centrées sur le blocage d’une seule cytokine, l'identification de phénomènes de « cytokines codépendantes », comme observé dans les MICI, permettrait d'envisager des stratégies d'inhibition multiple de cytokines pour augmenter les réponses thérapeutiques.
Sur la base de ce concept, le ciblage de cytokines multiples avec des anticorps bispécifiques paraissait prometteur, mais les données cliniques seraient jusqu'à présent décevantes, peut-être parce qu’il existe également une certaine dynamique de la réponse cytokinique.
Bloquer les cytokines codépendantes
Les inhibiteurs de JAK, qui bloquent la signalisation de plusieurs cytokines, sont efficaces dans un large éventail de maladies auto-immunes, y compris les polyarthrites et les colites, comme les anti-TNF.
Plusieurs des systèmes cytokiniques concernés dans les maladies auto-immunes, émettent des signaux par l'intermédiaire des JAK, notamment JAK1/2 (interleukine-6) et tyrosine kinase 2 (interleukine-6 et interleukine-23), ce qui explique leur efficacité dans les maladies auto-immunes concernées.
Cependant, les inhibiteurs de JAK sont également efficaces dans la spondylarthrite axiale, qui implique le TNF-α et l'interleukine-17A, des cytokines qui ne nécessitent pas la signalisation JAK. Ce résultat initialement surprenant peut s'expliquer par l'importance d'autres cytokines codépendante, sensibles à l'inhibition de JAK, et qui n'ont pas encore été reconnues comme jouant un rôle pathogénique dans la spondylarthrite axiale.
En pratique
Le ciblage mono-cytokinique en thérapeutique a éclairé la physiopathologie des maladies auto-immunes qui affectent les articulations et l'intestin. Ces données remettent en question le concept traditionnel de classification des maladies auto-immunes basée sur les organes-cibles et devraient ouvrir la voie à une compréhension mécanistique plus fine des maladies auto-immunes.
En outre, les données sur les réponses aux traitement anticytokiniques ont promu de nouveaux concepts, tels que les « déterminants tissulaires », qui sont essentiels pour façonner la fonction locale des cytokines, et les phénomènes de « cytokines codépendantes », afin de positionner des traitements face à des profils cytokiniques spécifiques associés à une maladie donnée.
Facteur de complexité supplémentaire, les profils cytokiniqes peuvent également « changer au fil du temps ou au cours d'un traitement anticytokinique », ce qui met en évidence la notion selon laquelle les profils de cytokines représentent des « cibles dynamiques » au cours de l'évolution des maladie auto-immunes.
L'analyse détaillée des profils cytokiniques au moyen des technologies moléculaires modernes peut être un progrès nécessaire à l'amélioration des réponses cliniques et à l'identification de profils moléculaires (« pathotypes ») différents au sein d'une maladie cliniquement définie. Ainsi, un pathotype de la maladie de Crohn dépendant de l'interleukine-23 pourrait être plus proche d'un pathotype de rhumatisme psoriasique dépendant de l'interleukine-23 que d'un autre pathotype distinct de la maladie de Crohn.
































