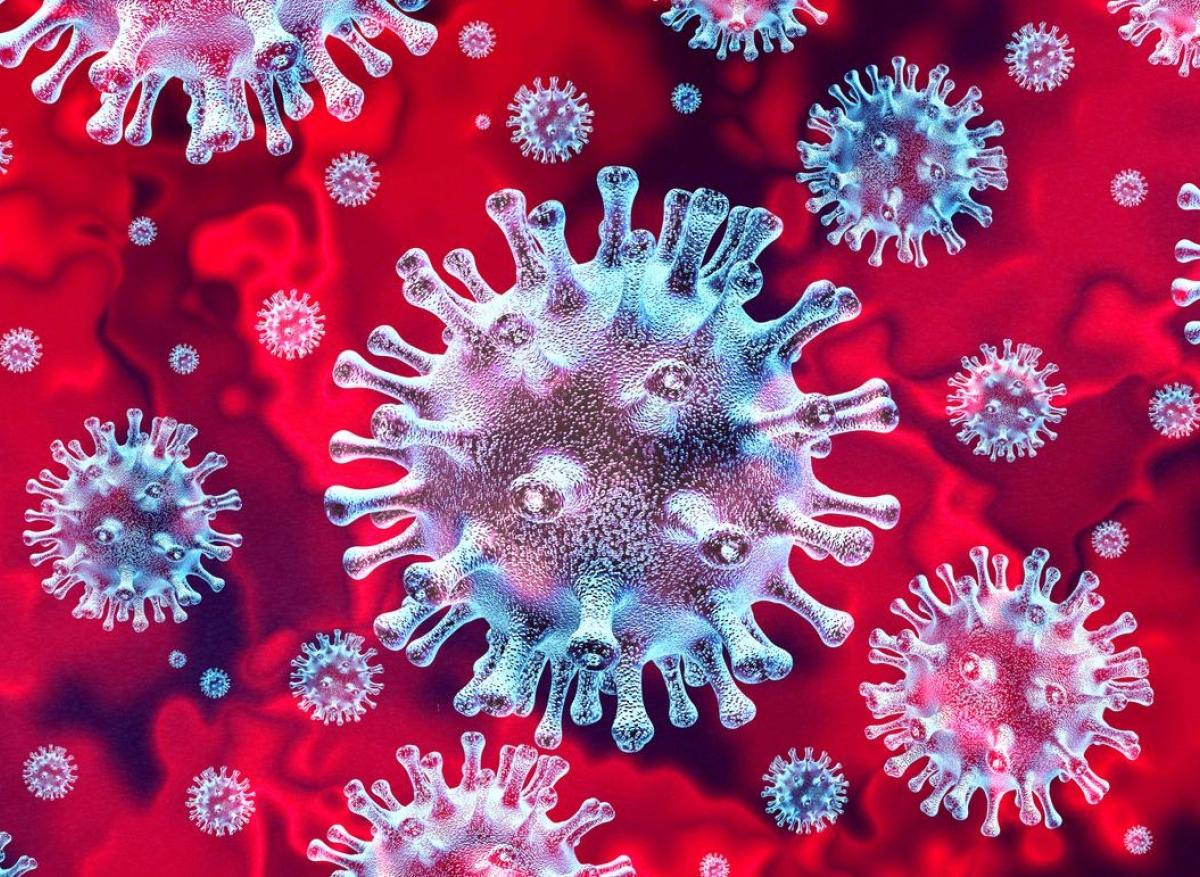Infectiologie
SARS-CoV-2 : la mutation D614G pourrait avoir rendu la 2ème vague plus explosive
L'augmentation de la fréquence de la mutation D614G de la protéine Spike du SARS-CoV-2, qui sert à l’attachement du virus sur la cellule respiratoire, correspondrait à un avantage sélectif précoce qui ne serait pas associé à une gravité plus importante de l'infection, mais à une contagiosité plus forte.

- rommma/istock
Au fur et à mesure que le SARS-CoV-2 a diffusé pour atteindre l’ensemble du monde, il est apparu des altérations aléatoires de sa séquence génétique, ou mutations. Mais une mutation D614G, qui s’est produite au début de la pandémie, pourrait être responsable de la différence de contagiosité observée actuellement.
De nombreuses études suggèrent que la plus forte contagiosité qui serait associée à cette mutation D614G de la protéine Spike aiderait le virus à contaminer plus facilement les cellules d'une personne et faciliterait la transmission à une autre personne, rendant la pandémie désormais plus difficile à arrêter. C’est ce qui ressort d’une étude britannique parue dans Cell qui montre des charges virales plus importantes et une atteinte plus fréquente des personnes jeunes.
Une étude comparative
Les données recueillies par l'équipe britannique ont permis d'observer de façon comparative la croissance des différents clusters comprenant différents variants du SARS-CoV-2, dont le D614G qui concerne la protéine Spike, responsable de l'attachement du virus sur la cellule respiratoire. C'est un peu comme une course de chevaux.
Relativement aux infections impliquant la variante ancestrale, les infections dues au variant D614G du SARS-CoV-2 se développent plus rapidement. Le taux précis reste incertain, mais la valeur la plus probable donnerait au variant 614G du SARS-CoV-2 un avantage d'environ 20% avec un taux de croissance plus rapidement exponentiel.
Un avantage sélectif
La dispersion mondiale et la fréquence croissante de la variante D614G du génome codant pour la protéine Spike du SARS-CoV-2 suggèrent un avantage sélectif mais peuvent également être dues à un effet fondateur d’origine aléatoire. Une équipe de recherche britannique a étudié cette hypothèse de la sélection positive de la mutation de la protéine Spike D614G au Royaume-Uni à partir de la plus large biobanque au monde sur les séquences génétiques des coronavirus : elle contient plus de 25 000 séquences du génome entier du SARS-CoV-2.
Les chercheurs ne trouvent aucune indication que les patients infectés par le variant Spike D614G ont une mortalité liée à la Covid-19 ou une gravité clinique plus élevées, mais le variant D614G de la protéine Spike (de pointe) est associé à une charge virale plus élevée et à un âge plus jeune des patients.
Une 2ème vague plus violente
La mutation, connue sous le nom de D614G, a été identifiée pour la première fois dans l'est de la Chine en janvier et s'est ensuite rapidement répandue en Europe, et en particulier en Italie, puis à New York. Si au printemps, c’est le variant initial (déjà très contagieux) qui était le plus représenté en France, en quelques mois, le variant D614G a diffusé dans une grande partie du monde, remplaçant les autres variants, y compris en France au cours de cette 2ème vague.
Depuis des mois, les scientifiques débattent férocement du pourquoi de cette sur-représentation du variant D614G et de ses conséquences. En mai, des chercheurs américains de Los Alamos avaient affirmé que ce variant avait probablement augmenté la capacité du coronavirus à infecter de manière plus efficace les personnes. Beaucoup de scientifiques restaient cependant sceptiques sur ce qui n’était qu’une hypothèse, arguant que la variante D614G pouvait être simplement apparue par hasard et sans conséquence clinique aucune, comme cela se produit généralement lors de toutes les grandes épidémies.
Un faisceau d’arguments
Il ressort donc du travail présenté dans Cell, et dans les études de ces derniers mois, que ce variant aurait été naturellement sélectionné en raison de sa plus forte contagiosité et qu’il aurait ainsi remplacé les autres variants. Désormais, plusieurs d’études, et notamment des analyses génétiques approfondies, ainsi que des travaux de contagiosité en laboratoire sur des hamsters et des tissus pulmonaires humains, semblent accréditer l'idée que le coronavirus porteur de la mutation D614G a en fait un avantage en termes de contagiosité : il infecterait plus facilement les gens que la variante initialement détectée à Wuhan, en Chine.
Actuellement, cependant, rien ne prouve que les coronavirus porteurs de la mutation D614G provoquent des symptômes plus graves, tuent plus de malades ou compliquent le développement des vaccins.
Il faut suivre les mutations
Il faut rester prudent car de nombreuses mutations, qui seraient susceptibles de rendre différents virus plus contagieux in vitro, se produisent régulièrement, sans que cela ne se traduise par des conséquences cliniques évidentes : il en a ainsi été du virus Ebola, lors de l’épidémie de 2013 en Afrique (plus contagieux in vitro mais pas in vivo).
Si ces résultats sont confirmés par d’autres travaux, cela voudrait dire que la mutation du début de l’épidémie aurait joué un rôle majeur dans le fait que la pandémie ait été si difficile à arrêter ensuite. Par contre, cette découverte ne change rien à la réalité des faits, à savoir que les endroits qui ont rapidement et agressivement mis en place des mesures de confinement et encouragé des mesures telles que la distanciation sociale et les masques ont obtenu de bien meilleurs résultats que les régions (ou états) qui ne l'ont pas fait. Le virus va continuer à muter et il faut donc continuer à le surveiller.
A noter qu'une étude phylogénétique récente, parue dans Nature Communication, ne retrouve pas cette association.