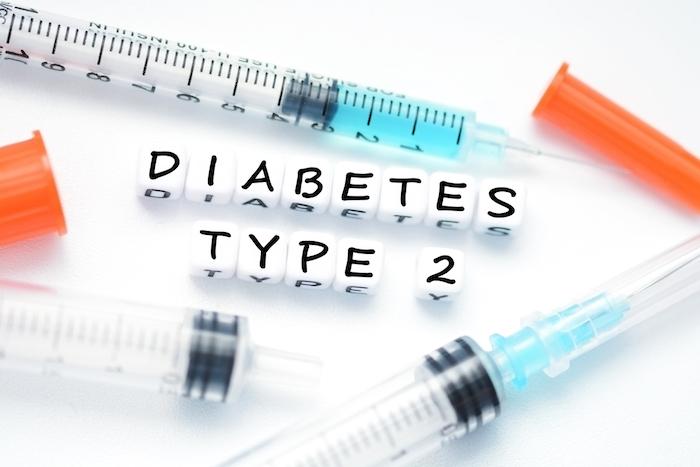Diabétologie
Diabète de type 2 : privilégier certains traitements en cas de risque cardiovasculaire
Changement radical dans les nouvelles recommandations sur la gestion du risque cardiovasculaire au cours du diabète : avant il fallait baisser la glycémie au maximum, désormais il faut surtout privilégier les médicaments qui réduisent spécifiquement le risque cardiovasculaire.

- nyvltart/istock
Les sociétés américaine et européenne du diabète, viennent de publier leurs recommandations communes concernant la prise en charge du diabète de type 2. De nouvelles données sur l’efficacité et la tolérance des traitements avaient rendu cette mise à jour nécessaire. L’idée principale de ce nouveau consensus est d’adapter la stratégie thérapeutique non pas en fonction de la seule glycémie, mais en fonction du risque cardiovasculaire absolu du patient. Il ne s’agit plus de se focaliser sur le niveau glycémique à atteindre, mais plutôt sur la manière d’atteindre un objectif glycémique en privilégiant des molécules qui ont un bénéfice avéré sur le risque cardiovasculaire.
Différences entre les molécules
Cela fait maintenant plusieurs années que le bénéfice de la réduction de la glycémie et relativisé en termes de réduction du risque cardiovasculaire. S’il faut, en effet, baisser le niveau de glycémie, la normalisation de l’HbA1c a été associée dans certaines études à une surmortalité paradoxale. Depuis 2008, la Food and drug administration (FDA) exige une étude d’innocuité cardiovasculaire de deux ans minimum pour tout nouveau traitement mis sur le marché. L’Agence européenne du médicament (EMA) a aussi exigé de telles études dès 2010, pour une durée minimale de trois ans. Les demandes de la FDA et de l’EMA font suite à la controverse sur l’élévation des événements cardiovasculaires par la rosiglitazone, qui a été retirée du marché dans de nombreux pays.
Ces études ont démontré que toutes les molécules n’ont pas le même bénéfice pour le cœur. Certaines ont un effet néfaste, comme certaines glitazones, voire les sulfamides hypoglycémiants, d’autres seraient plus neutres comme les inhibiteurs du DPP-4 et la metformine, bien que dans UKPDS, on avait observé une réduction du risque et d’autre encore ont un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire. Par contre, il y a 2 profils, certains analogues du GLP1, comme le liraglutide ou le semaglutide ont un effet démontré sur le risque et la mortalité cardiovasculaire d’origine athéroscléreuse, alors que les inhibiteurs du SGLT2 réduisent le risque et la mortalité cardiovasculaire liés à l’insuffisance cardiaque.
Un changement des stratégies
L’évaluation de l’état cardiovasculaire du patient sera ainsi prise en compte et pas seulement la glycémie. Et, en fonction du score, et des autres caractéristiques, différents algorithmes thérapeutiques seront proposés. En cas d’échec du traitement de première ligne, qui reste la metformine, ces recommandations conseillent de choisir chez les patients avec maladie athéromateuse, un agoniste du GLP-1 en priorité ou une gliflozine (en cas de contre-indication ou d’indisponibilité). Bien sûr, en cas d’insuffisance cardiaque, la priorité de choix des traitements de 2e ligne est inversée.
Pour les patients qui ont un risque cardiovasculaire absolu modéré, les recommandations conseillent de mieux prendre en compte les préférences des malades dans la perspective d’améliorer l’observance au traitement. Il pourra s’agir de préoccupations prédominantes sur le poids, le risque d’hypoglycémie, les modalités d’administration (injection ou voie orale)... Les comorbidités, comme l’insuffisance rénale, et l’âge du malade devront également être prises en compte.
D’après le Dr François Diévart, interviewé lors des journées de l’HTA, « il est plus que légitime et quasiment obligatoire d’intégrer ces nouveaux consensus parce que l’on a désormais la preuve que l’on peut diminuer le risque cardiovasculaire ».
Interview du Dr François Diévart, cardiologue à Lille (interview réalisé lors des 38 Journées de l’Hypertension Artérielle)