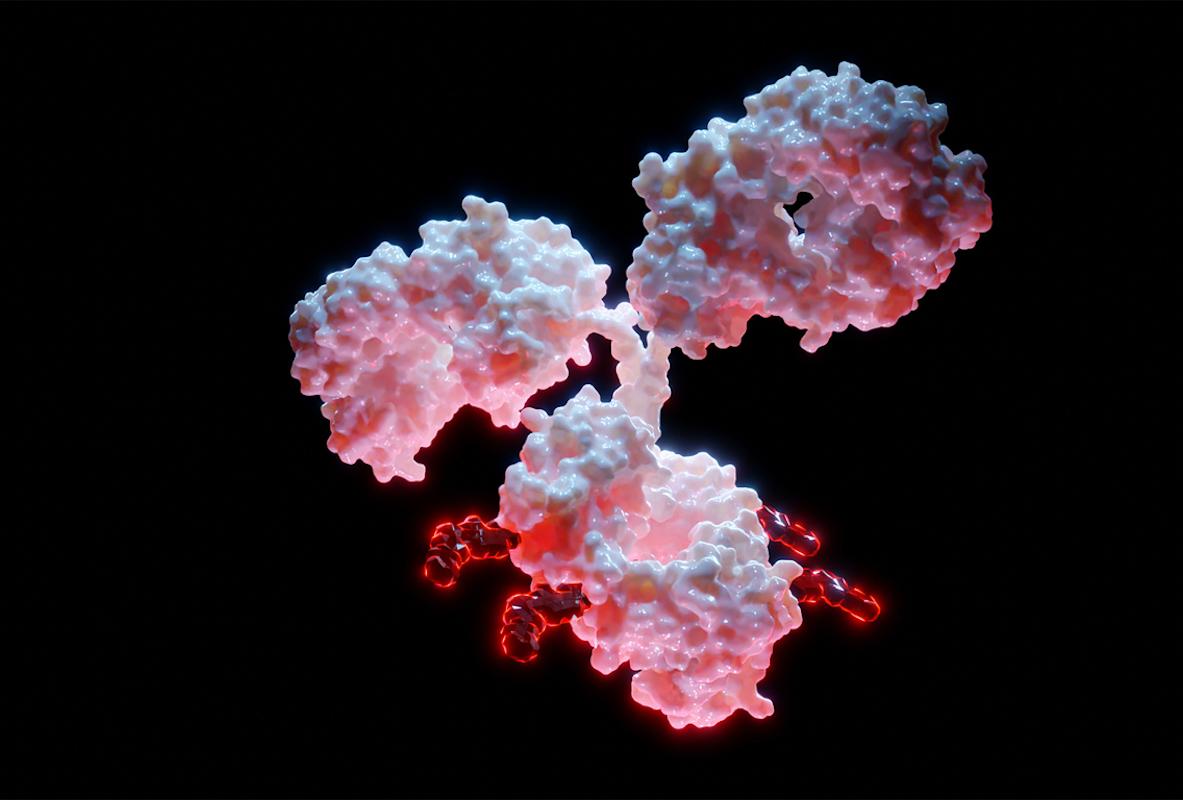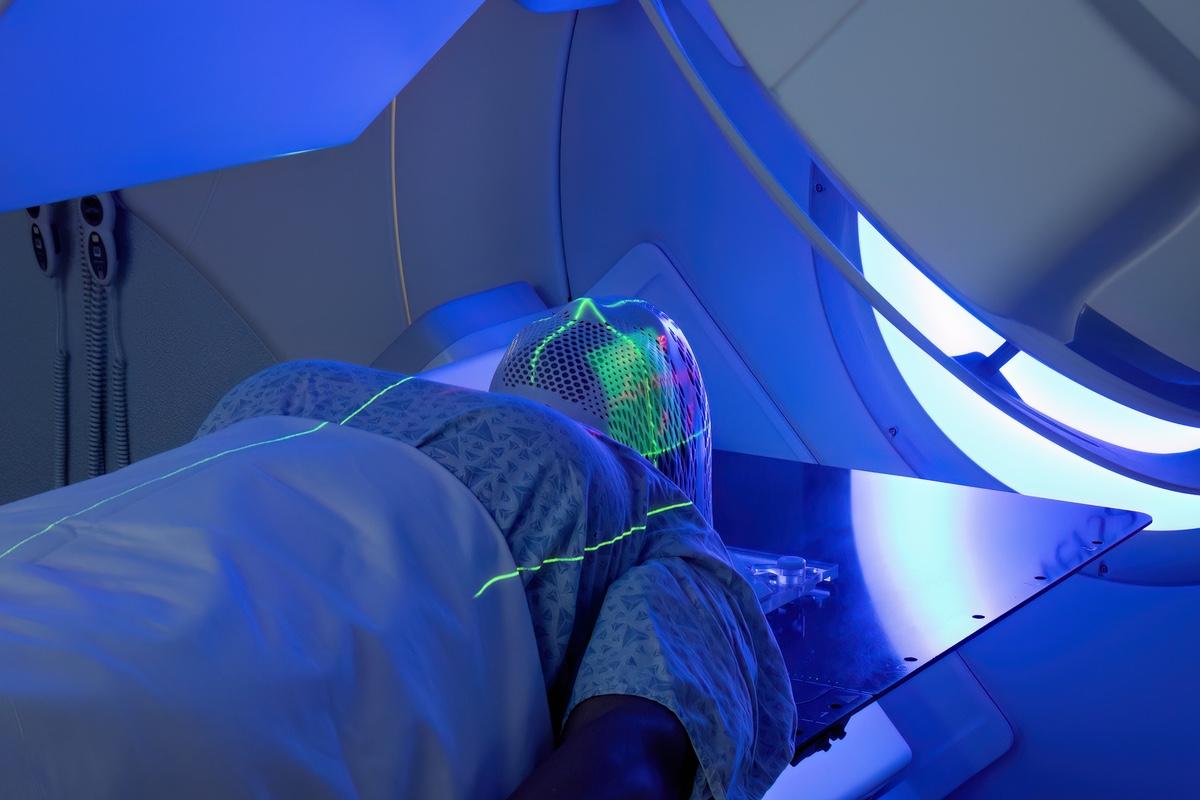Onco-Sein
Cancer du sein à risque intermédiaire : la radiothérapie post-mastectomie remise en cause
Chez les patientes atteintes d’un cancer du sein RH+ à risque intermédiaire, la radiothérapie du thorax post-mastectomie n’apporte aucun bénéfice en survie globale à 10 ans. Après avoir supprimé la radiothérapie adjuvante chez les femmes à faible risque, l’étude SUPREMO dans un contexte de désescalade thérapeutique interpelle désormais sur les risques intermédiaires.

- Valerii Apetroaiei/istock
Historiquement, les essais danois et canadiens (années 1990) et la méta-analyse EBCTCG 2014 soutenaient la radiothérapie post-mastectomie (PMRT) chez les patientes avec 1 à 3 ganglions positifs. Mais ces travaux reposaient sur des traitements adjuvants désormais considérés comme suboptimaux. Alors que la mastectomie est désormais le traitement de référence pour un tiers des cancers du sein de stades I ou II, la place de la radiothérapie post-mastectomie chez les patientes à risque intermédiaire restait débattue.
L’essai international de phase III SUPREMO (BIG 2-04) a abordé la question dans une population dite à « risque intermédiaire » : pT1N1, pT2N1, pT3N0, ou pT2N0 avec grade 3 et/ou invasion lymphovasculaire, toutes mastectomisées avec geste axillaire et traitement systémique. Les patientes (n=1607), RH+ pour plus des 3/4, ont été randomisées entre irradiation de paroi (40–50 Gy ; n=808) ou absence d’irradiation (n=799).
Selon les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine, après un suivi médian de 9,6 ans, la survie globale à 10 ans est de 81,4 % avec radiothérapie post-mastectomie contre 81,9 % sans radiothérapie (HR = 1,04 ; IC à 95 % 0,82–1,30 ; p=0,80). Autrement dit, dans cette ère de traitements systémiques efficaces, l’irradiation pariétale n’apporte pas de bénéfice de survie à 10. Ces données remettent en cause les bénéfices historiques attribués à l’irradiation post-mastectomie dans cette population.
Une réduction modeste des récidives locorégionales, sans bénéfice sur la survie
La radiothérapie permet de réduire les récidives thoraciques isolées : 9 cas (1,1 %) versus 20 (2,5 %) sans irradiation, soit une réduction absolue de 1,4 point (HR 0,45 ; IC à 95 : 0,20–0,99), avec un nombre nécessaire à traiter de 71 pour prévenir une récidive. En revanche, la survie sans récidive (76,2 % vs 75,5 % ; HR 0,97) et la survie sans métastase (78,2 % vs 79,2 % ; HR 1,06) ne différent pas.
Aucun signal de surmortalité liée à la radiothérapie n’a été observé. Ces résultats doivent être mis en balance avec les complications connues de l’irradiation, notamment en cas de reconstruction mammaire immédiate, pour laquelle l’exposition aux rayons augmente le risque d’échec et de reconstruction retardée.
Un essai de désescalade en phase avec l’évolution des pratiques
L’étude SUPREMO a été menée entre 2006 et 2013, avec des patientes traitées par curage axillaire systématique, une pratique aujourd’hui en déclin au profit de la biopsie du ganglion sentinelle. Cette évolution des standards limite la généralisabilité des résultats aux patientes ne recevant plus de curage. Par ailleurs, la fréquence remarquablement basse des récidives locorégionales (moins de 2 %) souligne l’efficacité des traitements systémiques actuels et interroge sur la pertinence d’un surtraitement locorégional.
Selon un éditorial associé, la question cruciale reste celle de l’innocuité de l’omission conjointe du curage axillaire et de la radiothérapie post-mastectomie. Deux essais en cours (T-REX, Tailor RT) visent à répondre à cette incertitude. D’ici là, une évaluation personnalisée du risque, intégrée à une discussion multidisciplinaire, demeure indispensable pour ajuster la stratégie thérapeutique sans compromettre la sécurité oncologique.


-1761035855.jpg)
-1760622840.jpg)