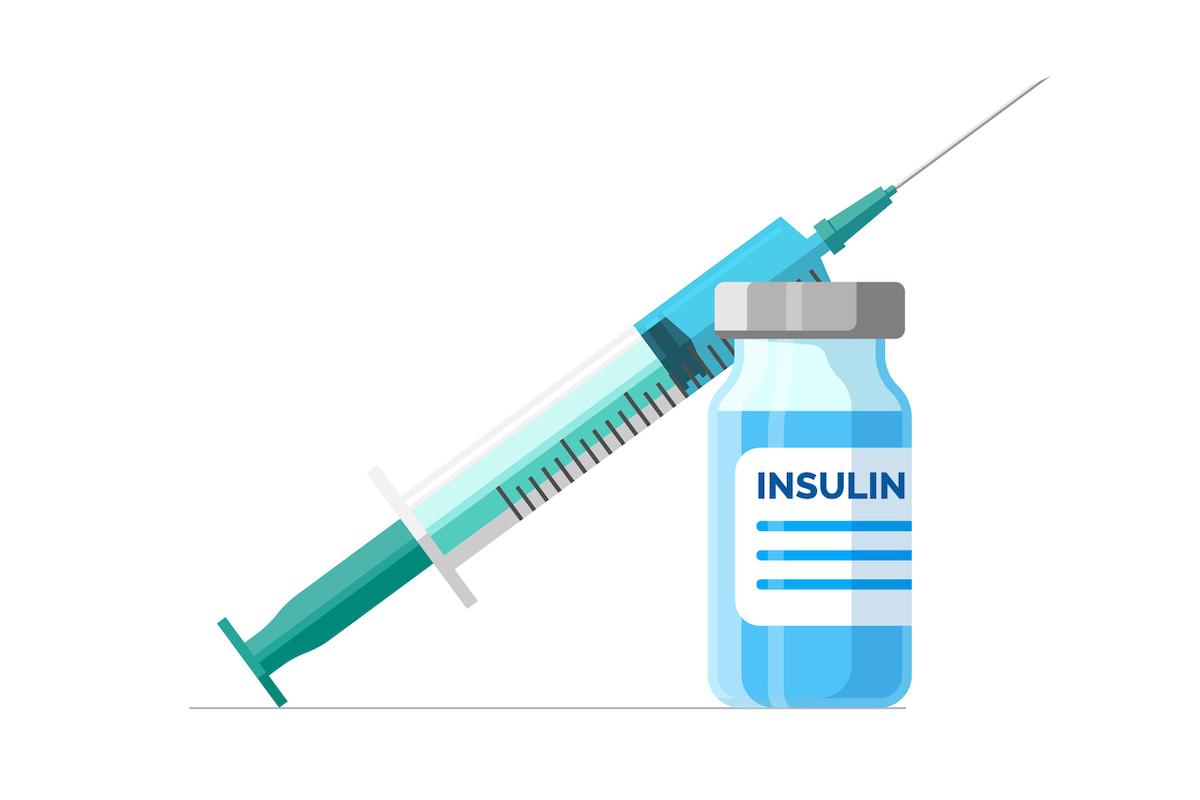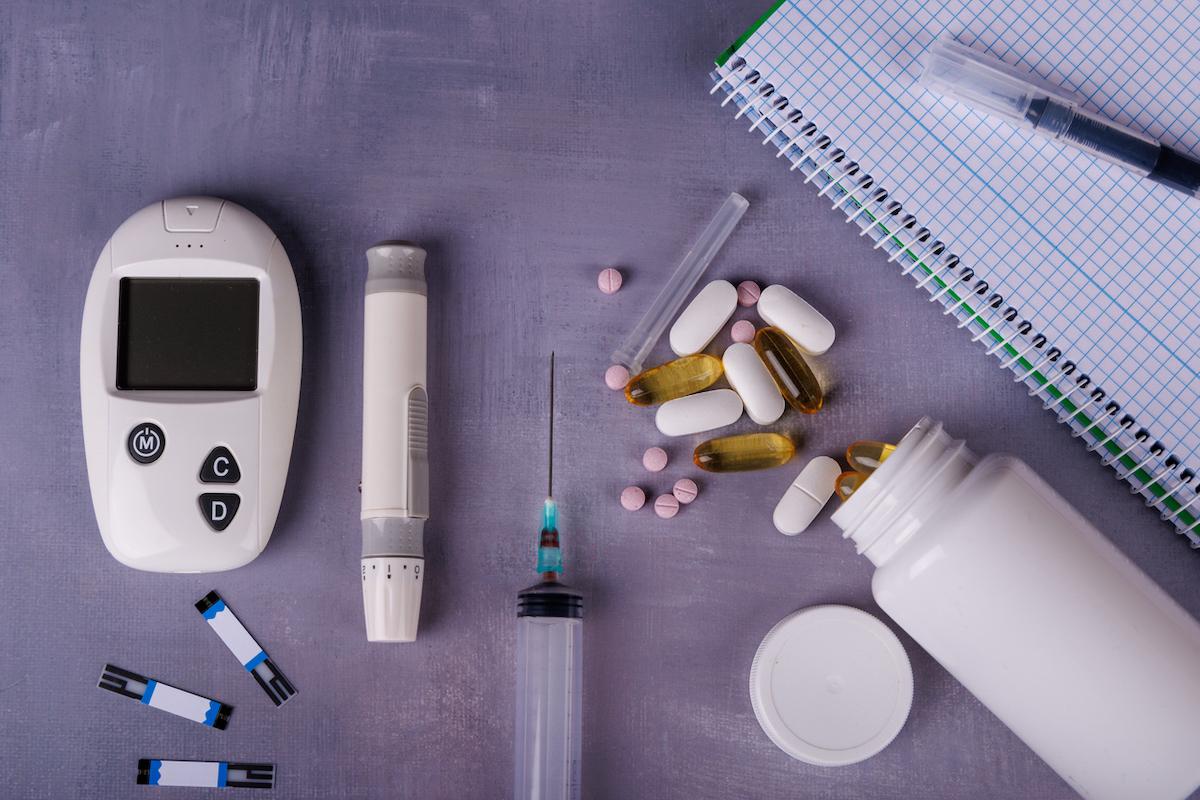Diabétologie
Diabète de type 2 : peut-on parler de rémission sous traitement ?
Le diabète de type 2 est-il toujours une maladie chronique irréversible, ou peut-il désormais être considéré comme rémissible ? Depuis quelques années, le mot « rémission » a fait irruption dans la littérature médicale, suscitant enthousiasme et débats.

- Ake Ngiamsanguan/istock
Depuis quelques années, le mot « rémission » a fait irruption dans la littérature médicale, suscitant enthousiasme et débats. Un consensus international a tenté de fixer les règles : une rémission est définie par le retour à une HbA1c < 6,5 % pendant au moins trois mois, en l’absence de tout traitement antidiabétique.
Cette définition, stricte et volontairement conservatrice, repose sur un principe clair : seule l’arrêt total de la pharmacothérapie peut confirmer que le métabolisme du patient est revenu à un état « non diabétique ». Mais cette approche, pertinente dans un contexte où les options thérapeutiques étaient limitées, semble aujourd’hui en décalage avec les progrès spectaculaires apportés par les nouvelles classes pharmacologiques.
Quand les traitements dépassent la logique du « palliatif glycémique »
L’arrivée des analogues du GLP-1, des agonistes doubles GIP/GLP-1 comme le tirzépatide, et bientôt des agonistes triples, a changé la donne. Ces molécules ne se contentent pas de corriger la glycémie. Elles modifient profondément le terrain métabolique : perte de poids durable, amélioration de la sensibilité à l’insuline, réduction des risques cardiovasculaires et rénaux.
Dans les essais cliniques comme dans la pratique quotidienne, de nombreux patients voient leurs paramètres biologiques redevenir strictement normaux, tant qu’ils poursuivent leur traitement. La question est alors légitime : un patient qui présente une HbA1c < 6 %, un poids redevenu normal et une amélioration globale de son profil métabolique, mais qui reste sous tirzépatide ou sémaglutide, est-il toujours un diabétique « contrôlé », ou peut-on parler d’une forme de rémission ?
La tentation d’une « rémission pharmacologique »
Plusieurs experts proposent d’introduire une distinction.
• La rémission stricte resterait réservée aux patients normalisés sans aucun traitement, par perte de poids ou chirurgie métabolique.
• La rémission pharmacologique qualifierait les patients qui retrouvent un profil biologique non diabétique grâce à un traitement moderne qui agit comme un modulateur physiologique, et non comme un simple hypoglycémiant.
Cette sémantique aurait l’avantage de refléter l’impact transformateur des nouvelles thérapeutiques. Elle permettrait aussi de valoriser la réussite des patients qui, sans être « guéris », ont franchi un cap décisif vers un métabolisme durablement rééquilibré.
Les risques d’un glissement sémantique
Reste que l’usage du mot « rémission » n’est pas sans risque. Sur le plan scientifique, diluer la définition brouille les comparaisons d’études et compromet la robustesse des données épidémiologiques. Sur le plan clinique, le danger est encore plus concret : un patient à qui l’on parle de rémission peut être tenté d’arrêter son traitement, persuadé d’être guéri. L’enthousiasme peut alors se transformer en rechute brutale, avec tout ce que cela comporte comme déception et perte de confiance dans la relation médecin-patient.
À l’inverse, refuser obstinément ce terme entretient une vision figée du diabète, comme d’une fatalité inéluctable. Or les médecins voient bien qu’il existe aujourd’hui des trajectoires positives, où la maladie peut être mise en sommeil, parfois durablement.
Quelle position adopter en pratique ?
Face à cette tension, les cliniciens se trouvent souvent contraints d’adopter un discours nuancé. La rémission stricte, telle que définie par les consensus, doit rester la référence scientifique. Mais ignorer la transformation métabolique induite par les GLP-1 ou le tirzépatide, c’est refuser de nommer ce que l’on constate en consultation : des patients qui, objectivement, ne présentent plus aucun signe biologique de diabète.
Certains diabétologues choisissent alors d’utiliser, dans l’échange avec le patient, une expression intermédiaire : « contrôle optimal » ou « normalisation métabolique ». D’autres n’hésitent plus à évoquer la notion de « rémission pharmacologique », en précisant aussitôt qu’elle reste conditionnée à la poursuite du traitement.
Un enjeu médical, mais aussi sociétal
Derrière ce débat terminologique, se profile un enjeu plus large. Reconnaître officiellement la rémission sous traitement aurait des conséquences considérables :
- sur le plan de la communication publique (comment parler d’une maladie « réversible » sans banaliser la prévention ?),
- sur le plan économique (les autorités de santé seraient-elles prêtes à financer massivement des traitements coûteux qui permettent une « rémission » plutôt qu’un simple contrôle ?),
- et sur le plan de la recherche (les futurs essais devront-ils intégrer cette catégorie intermédiaire pour évaluer l’efficacité des molécules ?).
La rémission du diabète de type 2 reste aujourd’hui officiellement définie comme l’absence de traitement associée à une normalisation de l’HbA1c. Mais cette définition, cohérente hier, semble de plus en plus réductrice face à l’impact métabolique des nouvelles thérapeutiques.
Entre prudence scientifique et reconnaissance des avancées, la médecine se trouve à la croisée des chemins. La « rémission pharmacologique » n’est pas encore consacrée par les textes, mais elle s’impose déjà dans les esprits. Reste à savoir si, dans les prochaines années, la communauté médicale acceptera de redéfinir collectivement ce mot lourd de sens, qui ne se contente pas de décrire une évolution biologique mais transforme aussi la façon dont patients et médecins conçoivent la maladie.
Les générations d’agonistes incrétines
- Agonistes simples (GLP-1)
- Exemple : liraglutide, sémaglutide.
- Action : stimulent la sécrétion d’insuline, ralentissent la vidange gastrique, diminuent l’appétit.
- Effets : amélioration de l’HbA1c, perte de poids de 5 à 15 %, bénéfices cardiovasculaires et rénaux.
- Agonistes doubles (GLP-1 + GIP)
- Exemple : tirzépatide.
- Action : associent le GLP-1 au GIP, qui potentialise l’effet insulinotrope et renforce la perte de poids.
- Effets : perte de poids de 15 à 20 %, contrôle glycémique supérieur aux GLP-1 seuls.
- Agonistes triples (GLP-1 + GIP + glucagon)
- Exemple : rétatrutide (en développement).
- Action : ajout de l’agonisme du récepteur du glucagon, qui augmente la dépense énergétique et favorise la combustion des graisses.
- Effets attendus : pertes de poids spectaculaires (> 20 %), amélioration métabolique proche de la chirurgie bariatrique.
En résumé : chaque génération ajoute une cible hormonale supplémentaire pour amplifier la perte de poids et la normalisation métabolique.
1) Repères de définition et de suivi
Le consensus international ADA/EASD/Endocrine Society/Diabetes UK (2021) retient « rémission » si HbA1c < 6,5 % pendant au moins 3 mois, en l’absence de tout traitement hypoglycémiant. Le document précise comment documenter la rémission quand l’HbA1c est peu fiable (hémoglobinopathie, anémie) et recommande une surveillance régulière (HbA1c, complications, poids), même en rémission. PMCPubMedEndocrine
Points pratiques
- confirmer avec une HbA1c ≥ 3 mois après l’arrêt de tout antidiabétique; si HbA1c non interprétable, recourir à la glycémie à jeun/OGTT, voire données CGM. PMC
- maintenir au minimum un contrôle annuel (HbA1c, lipides, rein, rétinopathie, neuropathie), la rémission n’étant pas une « guérison ». PMC
2) rémission induite par perte de poids en soins primaires: direct
Le programme DiRECT (régime très hypocalorique puis réintroduction alimentaire + suivi en médecine générale) établit la preuve que la perte pondérale précoce peut conduire à la rémission.
- à 1 an, ~46 % en rémission; à 2 ans, ~36 %; le maintien d’une perte >10 kg est le meilleur prédicteur (81 % en rémission chez ceux qui gardent >10 kg à 2 ans). PubMed
- à 5 ans, la rémission persiste chez une minorité; les chiffres publiés montrent un effritement notable malgré un accompagnement diététique de faible intensité, illustrant la nécessité d’une stratégie de maintien du poids. The LancetWiley Online Library
Implication clinique
- viser tôt un objectif de perte pondérale cliniquement significatif (≥10 kg quand c’est réaliste) et organiser un suivi de maintien à long terme; sans cela, la rémission régresse souvent. The Lancet
3) chirurgie métabolique: effet durable mais non absolu
La chirurgie apporte les taux les plus élevés de rémission prolongée, au prix d’une sélection des indications et d’un suivi nutritionnel.
- à 10 ans, méta-analyses et séries montrent environ 31 % de rémission complète, 15 % de rémission partielle, avec des rechutes tardives non rares. PMC
Implication clinique
- proposer la chirurgie chez les candidats éligibles (obésité sévère ou critères métaboliques), en insistant sur le suivi à vie et le risque de récidive tardive. PMC
4) pharmacothérapies modernes: normalisation sous traitement
Les agonistes GLP-1 et l’agoniste dual GIP/GLP-1 tirzépatide reconfigurent l’histoire naturelle en combinant baisse de l’HbA1c, perte de poids et bénéfices cardio-rénaux. Ils n’entrent toutefois pas, stricto sensu, dans la définition actuelle de la « rémission » puisqu’elle exige l’absence de traitement.
- surpass-2 (tirzépatide vs sémaglutide 1 mg): supériorité sur HbA1c et poids; proportion élevée de patients atteignant des cibles glycémiques strictes. New England Journal of Medicine PubMed
- surmount-1 (obésité sans diabète): pertes pondérales majeures et données d’extension à 3 ans montrant une réduction du passage au diabète chez les sujets avec prédiabète; utile pour la prévention et l’argument du « terrain métabolique ». New England Journal of Medicine PubMed
Implication clinique
- sous ces traitements, beaucoup de patients présentent des paramètres « non diabétiques » tant que la thérapie est poursuivie. scientifiquement, cela relève d’un contrôle optimal; cliniquement, l’idée de « rémission pharmacologique » peut aider à valoriser l’engagement du patient tout en soulignant la condition de poursuite. PMC
5) comment parler de rémission sans perdre la main sur l’adhésion
- garder la définition officielle pour la recherche, les certificats et l’épidémiologie; privilégier « normalisation métabolique » ou « contrôle optimal » sous traitement dans les courriers. PMC
- si arrêt d’un antidiabétique est envisagé (après perte pondérale importante, chirurgie, ou contrôle très strict prolongé), planifier un sevrage encadré, avec recontrôle HbA1c/GJ à 3 mois et plan de reprise si besoin. PMC
- expliquer au patient qu’une rémission n’efface ni la mémoire métabolique ni le risque de rechute; organiser un suivi annuel des complications, même en rémission. PMC
6) zones d’incertitude et messages de prudence
- durabilité: les taux chutent avec le temps si la perte pondérale n’est pas maintenue; les soins de support sont déterminants. The LancetWiley Online Library
- sémantique: élargir « rémission » au contrôle sous traitement brouillerait les comparaisons inter-études; le terme « rémission pharmacologique » peut être utile en clinique, à condition de rester explicite sur la dépendance au traitement. PMC
- prévention: les données de surmount-1 (prévention du passage au diabète) plaident pour une stratégie agressive de prise en charge précoce de l’obésité; mais ces essais ne testent pas la rémission du diabète établi sans traitement. PubMed
7) en trois phrases pour la pratique
- la seule rémission « officielle » est sans traitement, HbA1c < 6,5 % pendant ≥ 3 mois, avec suivi régulier. PMC
- la perte pondérale précoce reste la voie la plus documentée vers la rémission; la chirurgie en offre la plus grande durabilité, avec rechutes possibles. The LancetPMC
- les analogues GLP-1 et le tirzépatide produisent une normalisation métabolique profonde sous traitement; c’est un contrôle optimal, pas une rémission stricte, mais cela change déjà la trajectoire des patients.